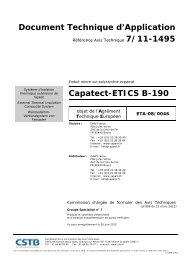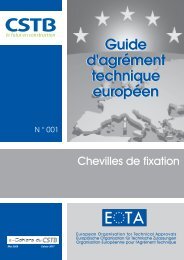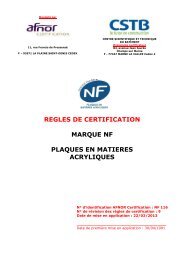Fissuration des mortiers - CSTB
Fissuration des mortiers - CSTB
Fissuration des mortiers - CSTB
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Prise en compte du couplage hydratation-séchage pour la modélisation du retrait de<br />
<strong>des</strong>siccation<br />
• Ea l’énergie d’activation [J/mol] qui traduit l’importance de la thermoactivation<br />
• R la constante <strong>des</strong> gaz parfaits (8,314 J/mol.K)<br />
• T la température [K]<br />
Cette équation empirique, était à l’origine, <strong>des</strong>tinée à décrire <strong>des</strong> systèmes chimiques homogènes<br />
simples pour lesquels n’intervient qu’une seule réaction chimique au maximum.<br />
Or, le ciment est connu pour être un système multiphasique et conséquemment multi-réactif.<br />
Néanmoins, elle s’avère en réalité très robuste pour simuler, de manière globale, <strong>des</strong> processus<br />
aussi complexes que l’hydratation <strong>des</strong> matériaux cimentaires (Regourd et coll. 1980 [107]).<br />
L’objectif de la modélisation s’inscrit dans la problématique du retrait de <strong>des</strong>siccation. L’approche<br />
consiste avant tout à utiliser <strong>des</strong> phénomènes et <strong>des</strong> concepts microscopiques afin d’enrichir<br />
une <strong>des</strong>cription qui se situe à l’échelle <strong>des</strong> déformations mesurées (échelle macroscopique).<br />
Ce postulat de départ nous écarte <strong>des</strong> modèles microscopiques. Ces derniers sont certes, très<br />
performants, mais ne permettent d’accéder à <strong>des</strong> données qu’à l’échelle considérée. Ceci rend<br />
particulièrement difficile le couplage avec les gradients de séchage à l’échelle d’une éprouvette.<br />
Par conséquent, c’est vers une approche plutôt globale du processus d’hydratation que nous<br />
nous tournons. Nous avons vu que le modèle d’Avrami n’est pas le plus précis pour simuler<br />
la réaction dans sa globalité. Par ailleurs, ce modèle ne prend pas en compte l’élévation de<br />
température et sa conséquence sur l’accélération de l’hydratation. C’est l’équation d’Arrhenius<br />
qui a été choisie comme base pour le modèle décrivant l’hydratation du ciment CEM I 4 qui a<br />
été utilisé dans notre étude.<br />
2.2 Aspect thermique et identification de l’affinité chimique<br />
2.2.1 Mesure du dégagement de chaleur<br />
Il existe plusieurs techniques de calorimétrie permettant de suivre l’élévation de température<br />
au cours de l’hydratation et ainsi accéder au degré d’avancement de la réaction au cours<br />
du temps. La plus couramment employée est la calorimétrie isotherme. Il s’agit de mesurer<br />
l’énergie électrique nécessaire au maintien d’une température constante (généralement<br />
20 ˚ C) dans une cellule à l’intérieur de laquelle se trouve un échantillon de pâte de ciment/mortier/béton<br />
en train de s’hydrater. Les conditions adiabatiques à respecter nécessitent<br />
d’utiliser une cellule isolée thermiquement. Le dispositif requiert également un système d’asservissement,<br />
calibré sur l’élévation de température de l’échantillon, afin de maintenir la<br />
température constante à l’intérieur du calorimètre. Une autre technique, plus facile à mettre en<br />
place, consiste à mesurer l’élévation de température d’un échantillon placé dans un récipient calorifugé,<br />
dont les déperditions sont relativement faibles : c’est la calorimétrie semi-adiabatique.<br />
Seule la température à l’intérieur du calorimètre (généralement un vase Dewar ou une bouteille<br />
de Langavant) est mesurée. En connaissant le coefficient de déperdition du récipient, il est facile<br />
de retrouver le dégagement de chaleur, qui est la somme de la chaleur emmagasinée et<br />
<strong>des</strong> déperditions, comme il est proposée dans la norme NF P 15-436 (AFNOR 1988 [109]) (cf.<br />
équation 6.4).<br />
Qm = Ct<br />
θ +<br />
mc<br />
1<br />
t<br />
αcθdt (6.4)<br />
mc 0<br />
4 Notons qu’il aurait fallu prendre en compte plusieurs énergies d’activation dans le cas d’un ciment contenant<br />
<strong>des</strong> ajouts pouzzonaliques comme la fumée de silice par exemple. En effet, la température agit différemment sur<br />
les cinétiques <strong>des</strong> réactions (Scrivener et Wieker 1992 [108])<br />
116