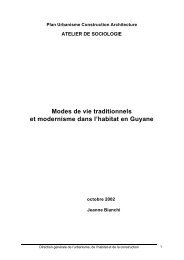L'évaluation des politiques publiques urbaines. - Centre de ...
L'évaluation des politiques publiques urbaines. - Centre de ...
L'évaluation des politiques publiques urbaines. - Centre de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Au terme <strong>de</strong> ce colloque, parmi les acquis qui ont nourri toutes les réflexions ultérieures sur<br />
l’évaluation, on peut souligner, parmi les avancées significatives :<br />
- Une clarification sur le rôle <strong>de</strong> l’évaluation qui permet <strong>de</strong> privilégier l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
résultats par rapport au contrôle du respect <strong><strong>de</strong>s</strong> règlements afin d’encourager l’initiative et la<br />
productivité, <strong>de</strong> favoriser la transparence et d’éclairer le jugement ce qui permet <strong>de</strong><br />
promouvoir <strong><strong>de</strong>s</strong> comportements plus rationnels, d’améliorer les connaissances et <strong>de</strong><br />
favoriser la réflexion collective et le dialogue, <strong>de</strong> développer un processus d’apprentissage, <strong>de</strong><br />
favoriser le changement en bousculant <strong><strong>de</strong>s</strong> mécanismes lourds et sclérosés.<br />
- Une meilleure perception <strong>de</strong> ses spécificités et <strong>de</strong> ses limites : l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>politiques</strong> trouve moins son originalité dans les métho<strong><strong>de</strong>s</strong> qu’elle utilise, que dans la<br />
combinaison <strong>de</strong> ces métho<strong><strong>de</strong>s</strong> dans le champ particulier auquel elle s’applique valablement<br />
et dans sa confrontation avec la logique politique <strong>de</strong> ce champ : un <strong><strong>de</strong>s</strong> points les plus<br />
sensibles <strong>de</strong> l’évaluation apparaît lorsqu’on la compare avec les étu<strong><strong>de</strong>s</strong> a priori, à savoir son<br />
caractère ex post : nombre d’évaluations/étu<strong><strong>de</strong>s</strong> a priori ne se transforment pas en projet,<br />
alors que l’évaluation a posteriori apparaît plus opérationnelle et peut susciter <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
changements dans l’orientation et la conduite <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>politiques</strong>, voire même suggérer <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
formes nouvelles d’intervention publique.<br />
- L’importance reconnue au rôle <strong>de</strong> l’expérimentation, entendue comme application<br />
d’une mesure particulière à un groupe déterminé, enregistrement <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats obtenus, et,<br />
sur la base <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats, extension éventuelle à l’ensemble <strong>de</strong> la nation.<br />
Même si tous les domaines <strong>de</strong> l’action publique n’en sont pas également justiciables, le<br />
caractère graduel et pragmatique <strong>de</strong> la démarche d’expérimentation, sa souplesse,<br />
l’apprentissage qu’elle réalise, son aptitu<strong>de</strong> à favoriser les initiatives locales et à mettre en<br />
évi<strong>de</strong>nce les cas particuliers, en font un instrument important <strong>de</strong> l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>politiques</strong> <strong>publiques</strong> qui, par ailleurs, doit être pluraliste et ne pas relever du monopole<br />
d’une seule catégorie d’acteurs <strong>de</strong> la vie publique et dont les résultats doivent être<br />
largement accessibles.<br />
Dès 1984, il était donc clair que l’évaluation-expérimentation pouvait permettre <strong>de</strong> sortir <strong>de</strong><br />
l’extrême difficulté <strong>de</strong> mener <strong><strong>de</strong>s</strong> expériences <strong>de</strong> <strong>politiques</strong> <strong>publiques</strong> en France. Sur ce sujet,<br />
le Conseil d’Etat adopte, en effet, généralement une attitu<strong>de</strong> négative au nom du principe<br />
d’égalité <strong>de</strong>vant le service public, l’expérimentation apparaissant dans cette optique étroite<br />
comme porteuse d’injustice en réduisant certains citoyens au rang <strong>de</strong> cobayes. Or « même<br />
si tous les domaines <strong>de</strong> l’action publique n’en sont pas également justiciables, le caractère<br />
graduel et pragmatique <strong>de</strong> la démarche d’expérimentation, sa souplesse, l’apprentissage<br />
qu’elle réalise, son aptitu<strong>de</strong> à favoriser les initiatives locales et à mettre en évi<strong>de</strong>nce les cas<br />
particuliers, constituent <strong><strong>de</strong>s</strong> atouts... ».<br />
En effet, l’expérimentation permet <strong>de</strong> laisser subsister durant quelques temps<br />
plusieurs solutions à un même problème, plusieurs expériences pilotes précisant la<br />
faisabilité <strong><strong>de</strong>s</strong> projets, plusieurs modalités vivantes ayant chacune leur avantage<br />
spécifique. Ce maintien effectif <strong>de</strong> la diversité et d’une certaine richesse d’aptitu<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
permet d’éclairer - grâce à une évaluation collective contradictoire - les choix et les<br />
décisions <strong><strong>de</strong>s</strong> élus et <strong><strong>de</strong>s</strong> déci<strong>de</strong>urs.<br />
METHODES D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES :<br />
14