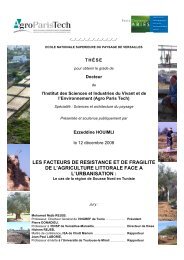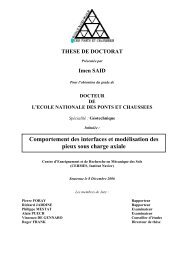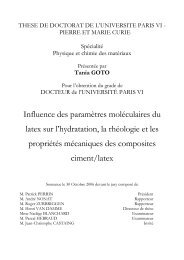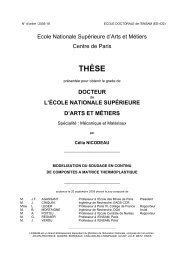interactions des fondations et des sols gonflants : pathologie ... - Pastel
interactions des fondations et des sols gonflants : pathologie ... - Pastel
interactions des fondations et des sols gonflants : pathologie ... - Pastel
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pour c<strong>et</strong>te raison, si <strong>des</strong> cations de calcium, de sodium, d’aluminium, de sodium,<br />
d’hydrogène, <strong>et</strong>c. sont attirés à la surface du paqu<strong>et</strong>, les paqu<strong>et</strong>s élémentaires<br />
s’uniront facilement en micro-agrégats (granules) assez résistants à l’eau<br />
(Berezantsev <strong>et</strong> al., 1961 ; Filliat <strong>et</strong> al., 1981).<br />
La charge surfacique négative du granule « g » <strong>et</strong> celle <strong>des</strong> cations fortement liés <strong>et</strong><br />
immobiles qui l’entourent forment la double couche électrique. La théorie de la<br />
double couche électrique a été développée par Gouy (1910, 1917) <strong>et</strong> par Chapman<br />
(1913), cités par Nerpin <strong>et</strong> Bondarenko (1966). Les charges <strong>des</strong> cations de la<br />
première couche (1, figure 9) ne suffisent pas à équilibrer les charges de la surface<br />
<strong>des</strong> granules. C’est pourquoi, lorsque l’on s’éloigne de la surface de séparation ont<br />
trouve encore une couche (2, figure 9) dans laquelle <strong>des</strong> cations se trouvent, bien<br />
que dans une moindre mesure, sous l’influence de l’attraction <strong>des</strong> charges négatives.<br />
Le potentiel électrique total s’atténue progressivement, à mesure que l’on s’éloigne<br />
de la surface du granule, <strong>et</strong> les cations de la seconde couche, appelée couche<br />
diffuse, sont fixés moins fortement au granule <strong>et</strong> possèdent une certaine mobilité.<br />
Le noyau minéral (du granule « g », figure 9), entouré par la couche <strong>des</strong> cations fixes<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> molécules d’eau fortement liées (1), constitue la particule argileuse<br />
élémentaire.<br />
La particule argileuse élémentaire avec sa couche diffuse (2) est appelée micelle.<br />
La particule d’argile <strong>et</strong> les cations qui l’entourent se trouvent dans un milieu dispersif<br />
aqueux <strong>et</strong>, dans la mesure où la composition <strong>des</strong> cations adsorbés ne reste pas<br />
constante lorsque la concentration <strong>et</strong> la composition en sels du milieu aqueux varie, il<br />
se produit <strong>des</strong> échanges d’ions.<br />
La molécule d’eau est globalement neutre mais, dans la mesure où les atomes<br />
d’oxygène <strong>et</strong> d’hydrogène ne sont pas disposés de façon symétrique <strong>et</strong> possèdent<br />
<strong>des</strong> charges opposées, les molécules d’eau constituent <strong>des</strong> dipôles (figure 10).<br />
Lorsqu’ils tombent dans le champ d’action du potentiel électrique d’une particule<br />
d’argile ou d’un cation, les dipôles d’eau sont attirés par leur surface. Il se produit ce<br />
qu’on appelle l’hydratation <strong>des</strong> particules <strong>et</strong> <strong>des</strong> cations avec adsorption d’une<br />
enveloppe hydratée.<br />
Figure 9 Structure du grain minéral<br />
25