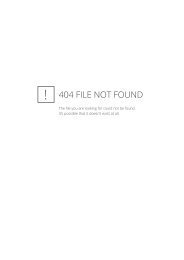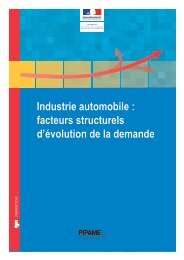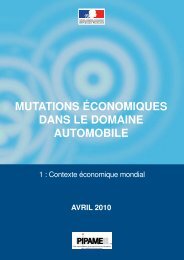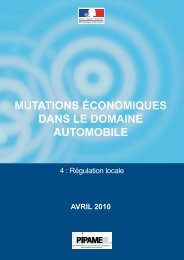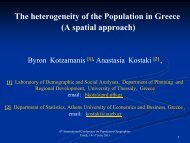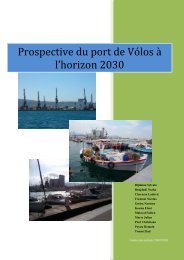Cahier du lipsor (pays basque 2010).indd - La prospective
Cahier du lipsor (pays basque 2010).indd - La prospective
Cahier du lipsor (pays basque 2010).indd - La prospective
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cette préoccupation générale est ici renforcée par la conscience qu’une désertification des<br />
vallées de la Soule ou de la Basse Navarre mettrait en péril la culture <strong>basque</strong>, dont nous avons<br />
vu qu’elle était avant tout rurale.<br />
BAB, cette agglomération bayonnaise – de taille modeste si on la compare à ses consoeurs de<br />
l’« Arc atlantique », à commencer par la grande voisine, Bordeaux – est un pôle d’attraction<br />
majeur, dont les Basques aimeraient réussir à maîtriser la croissance. Ce qui n’est pas facile.<br />
Michel Godet rappelait, lors des études préalables que « <strong>La</strong> dynamique des villes comme<br />
Bayonne a toujours été déconnectée des campagnes. Du temps de sa splendeur au XVI e<br />
siècle, Bayonne était surtout animée par des bourgeois béarnais, et aussi les commerçants<br />
juifs <strong>du</strong> quartier Saint-Esprit, chassés d’Espagne en 1492, et dont le réseau d’affaires<br />
couvrait toute l’Europe <strong>du</strong> Nord. L’atout <strong>du</strong> Pays <strong>basque</strong> de France était d’être la vitrine et<br />
la porte d’entrée de l’Europe <strong>du</strong> Nord pour l’Espagne » (Godet, M., 1991). <strong>La</strong> relation<br />
complexe entre l’agglomération et les structures <strong>du</strong> Pays <strong>basque</strong> (nous reparlerons<br />
longuement des Conseils de développement et des élus) ne date pas d’hier.<br />
2 – Économie : une région semblable à beaucoup d’autres<br />
Le Pays <strong>basque</strong>, en ce début des années 1990, n’a rien d’une zone sinistrée. Certes, son taux<br />
de chômage est supérieur de deux points au taux moyen national mais paradoxalement c’est<br />
plutôt un signe de bonne santé : la zone littorale, active et attractive, attire plus de population<br />
active qu’elle ne peut en absorber. Il y a donc un problème d’ajustement, mais rien de grave,<br />
structurellement. De plus, dans certains des secteurs les plus dynamiques (tourisme, services<br />
marchands aux particuliers) une partie importante des emplois sont saisonniers et les<br />
employeurs « pratiquent une gestion externalisée de leur main d’œuvre », selon la belle<br />
formule <strong>du</strong> représentant de l’INSEE (Diagnostic, décembre 1993, p.118). Les caractéristiques<br />
de l’emploi ne diffèrent pas sensiblement des moyennes nationales, à deux exceptions près :<br />
le secteur primaire (agriculture, pêche) est surreprésenté, avec 8,5% de la population<br />
employée, contre 5,7% France entière, et l’in<strong>du</strong>strie sous-représentée, avec 16,7% contre<br />
22,8%. Pour le reste, on est proche des chiffres nationaux : les deux tiers des emplois sont<br />
tertiaires, et 8% des actifs sont employés dans le bâtiment.<br />
En quinze ans (1975-1990), depuis le début de ce que l’on appelait encore « la crise », la<br />
population active ayant un emploi a augmenté de 13,5%, passant de 80 500 à 91 300<br />
personnes. Les évolutions suivent les tendances nationales, avec les particularités locales <strong>du</strong>es<br />
à la situation géographique et climatique. L’emploi in<strong>du</strong>striel régresse 18 , les services se<br />
développent. C’est le tourisme qui a le plus développé l’emploi (+ 40%) ainsi que les services<br />
marchands aux particuliers (+ 70%) et aux entreprises (+117%). Le commerce a progressé de<br />
20%, tout comme les services non marchands.<br />
L’emploi in<strong>du</strong>striel a diminué de 4,5% en quinze ans, ce qui n’est pas considérable compte<br />
tenu des glissements statistiques déjà mentionnés. Il faut quand même souligner<br />
l’effondrement de l’in<strong>du</strong>strie <strong>du</strong> cuir et de la chaussure, qui a vu ses effectifs divisés par trois<br />
pendant cette période. Les bourgs de l’intérieur, comme Hasparren ou Mauléon, sont<br />
particulièrement touchés par cette évolution. De son côté, l’aéronautique, l’une des in<strong>du</strong>stries<br />
(de transport, de communications) sont tournés vers un point central. <strong>La</strong> métropolarisation fait donc converger<br />
fortement hommes et activités vers les métropoles.<br />
18 Cette appréciation et les chiffres qui l’illustrent sont à prendre avec précaution. On sait que la mode<br />
stratégique <strong>du</strong> « recentrage sur le cœur de métier » et les phénomènes d’externalisation qui en découlent<br />
transforment allègrement des emplois in<strong>du</strong>striels en services aux entreprises … sans aucun changement dans le<br />
contenu réel des activités.<br />
13