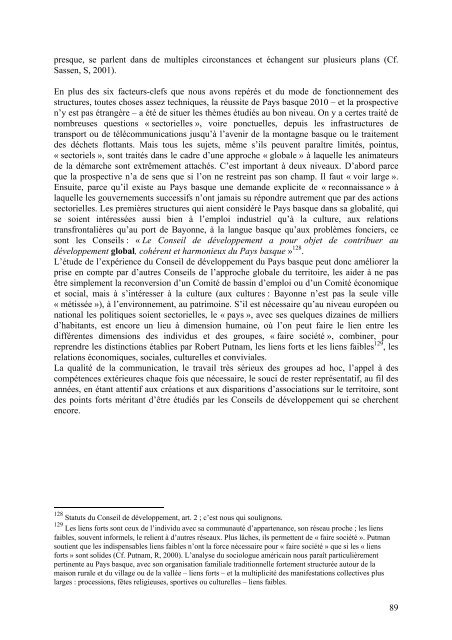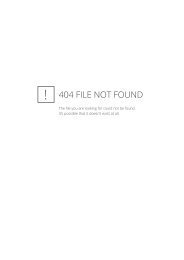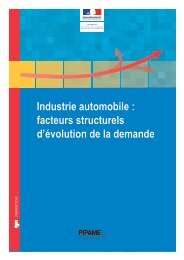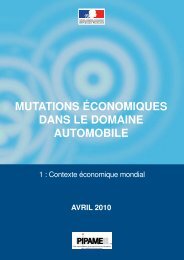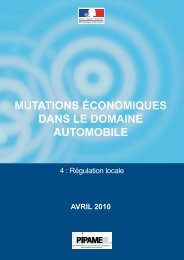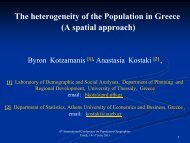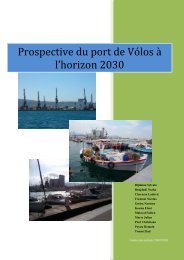Cahier du lipsor (pays basque 2010).indd - La prospective
Cahier du lipsor (pays basque 2010).indd - La prospective
Cahier du lipsor (pays basque 2010).indd - La prospective
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
presque, se parlent dans de multiples circonstances et échangent sur plusieurs plans (Cf.<br />
Sassen, S, 2001).<br />
En plus des six facteurs-clefs que nous avons repérés et <strong>du</strong> mode de fonctionnement des<br />
structures, toutes choses assez techniques, la réussite de Pays <strong>basque</strong> <strong>2010</strong> – et la <strong>prospective</strong><br />
n’y est pas étrangère – a été de situer les thèmes étudiés au bon niveau. On y a certes traité de<br />
nombreuses questions « sectorielles », voire ponctuelles, depuis les infrastructures de<br />
transport ou de télécommunications jusqu’à l’avenir de la montagne <strong>basque</strong> ou le traitement<br />
des déchets flottants. Mais tous les sujets, même s’ils peuvent paraître limités, pointus,<br />
« sectoriels », sont traités dans le cadre d’une approche « globale » à laquelle les animateurs<br />
de la démarche sont extrêmement attachés. C’est important à deux niveaux. D’abord parce<br />
que la <strong>prospective</strong> n’a de sens que si l’on ne restreint pas son champ. Il faut « voir large ».<br />
Ensuite, parce qu’il existe au Pays <strong>basque</strong> une demande explicite de « reconnaissance » à<br />
laquelle les gouvernements successifs n’ont jamais su répondre autrement que par des actions<br />
sectorielles. Les premières structures qui aient considéré le Pays <strong>basque</strong> dans sa globalité, qui<br />
se soient intéressées aussi bien à l’emploi in<strong>du</strong>striel qu’à la culture, aux relations<br />
transfrontalières qu’au port de Bayonne, à la langue <strong>basque</strong> qu’aux problèmes fonciers, ce<br />
sont les Conseils : « Le Conseil de développement a pour objet de contribuer au<br />
développement global, cohérent et harmonieux <strong>du</strong> Pays <strong>basque</strong> » 128 .<br />
L’étude de l’expérience <strong>du</strong> Conseil de développement <strong>du</strong> Pays <strong>basque</strong> peut donc améliorer la<br />
prise en compte par d’autres Conseils de l’approche globale <strong>du</strong> territoire, les aider à ne pas<br />
être simplement la reconversion d’un Comité de bassin d’emploi ou d’un Comité économique<br />
et social, mais à s’intéresser à la culture (aux cultures : Bayonne n’est pas la seule ville<br />
« métissée »), à l’environnement, au patrimoine. S’il est nécessaire qu’au niveau européen ou<br />
national les politiques soient sectorielles, le « <strong>pays</strong> », avec ses quelques dizaines de milliers<br />
d’habitants, est encore un lieu à dimension humaine, où l’on peut faire le lien entre les<br />
différentes dimensions des indivi<strong>du</strong>s et des groupes, « faire société », combiner, pour<br />
reprendre les distinctions établies par Robert Putnam, les liens forts et les liens faibles 129 , les<br />
relations économiques, sociales, culturelles et conviviales.<br />
<strong>La</strong> qualité de la communication, le travail très sérieux des groupes ad hoc, l’appel à des<br />
compétences extérieures chaque fois que nécessaire, le souci de rester représentatif, au fil des<br />
années, en étant attentif aux créations et aux disparitions d’associations sur le territoire, sont<br />
des points forts méritant d’être étudiés par les Conseils de développement qui se cherchent<br />
encore.<br />
128 Statuts <strong>du</strong> Conseil de développement, art. 2 ; c’est nous qui soulignons.<br />
129 Les liens forts sont ceux de l’indivi<strong>du</strong> avec sa communauté d’appartenance, son réseau proche ; les liens<br />
faibles, souvent informels, le relient à d’autres réseaux. Plus lâches, ils permettent de « faire société ». Putman<br />
soutient que les indispensables liens faibles n’ont la force nécessaire pour « faire société » que si les « liens<br />
forts » sont solides (Cf. Putnam, R, 2000). L’analyse <strong>du</strong> sociologue américain nous paraît particulièrement<br />
pertinente au Pays <strong>basque</strong>, avec son organisation familiale traditionnelle fortement structurée autour de la<br />
maison rurale et <strong>du</strong> village ou de la vallée – liens forts – et la multiplicité des manifestations collectives plus<br />
larges : processions, fêtes religieuses, sportives ou culturelles – liens faibles.<br />
89