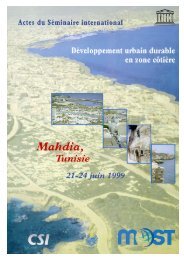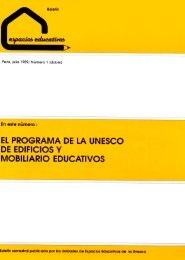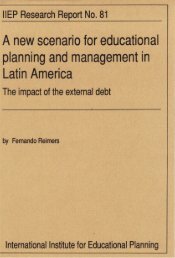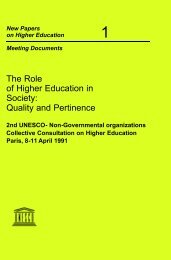L'ABC du droit d'auteur - Unesco
L'ABC du droit d'auteur - Unesco
L'ABC du droit d'auteur - Unesco
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Quelles sont les caractéristiques principales des <strong>droit</strong>s moraux ?<br />
Les <strong>droit</strong>s moraux des auteurs<br />
Les <strong>droit</strong>s moraux sont par leur nature même liés à la personnalité de leur auteur – ce ne sont pas des<br />
<strong>droit</strong>s de propriété. En conséquence, les <strong>droit</strong>s moraux appartiennent aux auteurs même s’ils ont cédé leurs<br />
<strong>droit</strong>s patrimoniaux à quelqu’un d’autre. De plus, et contrairement aux <strong>droit</strong>s patrimoniaux, les <strong>droit</strong>s moraux<br />
sont inaliénables. Les auteurs ne peuvent céder leurs <strong>droit</strong>s moraux à quelqu’un d’autre, alors qu’ils peuvent<br />
vendre leurs <strong>droit</strong>s patrimoniaux. Par exemple, un auteur peut avoir cédé à un éditeur le <strong>droit</strong> de repro<strong>du</strong>ire<br />
et de distribuer son roman, mais cela n’a pas d’incidence sur le destin des <strong>droit</strong>s moraux, qui continuent<br />
d’appartenir à l’auteur, lequel peut donc revendiquer la paternité <strong>du</strong> roman. De plus, l’éditeur ne peut pas<br />
supprimer son nom en tant qu’auteur de l’œuvre ou le remplacer par un autre. Cependant, certains pays, en<br />
particulier ceux qui adhèrent au système de common law, autorisent la renonciation aux <strong>droit</strong>s moraux sous<br />
certaines conditions.<br />
Quelle doit être la <strong>du</strong>rée de la protection des <strong>droit</strong>s moraux ? Cette question est traditionnellement source de<br />
controverse. Alors que les pays de common law, en règle générale, tendent à stipuler que les <strong>droit</strong>s moraux<br />
cessent d’être protégés à la mort de l’auteur, la tradition de <strong>droit</strong> romain considère généralement les <strong>droit</strong>s<br />
moraux comme perpétuels : dans ce cas, les <strong>droit</strong>s en question peuvent être exercés après la mort de l’auteur<br />
par ses héritiers ou, comme le prévoient certaines lois nationales, par certains organismes publics ou privés<br />
dans l’intérêt <strong>du</strong> patrimoine culturel <strong>du</strong> pays. La Convention de Berne contient un compromis selon lequel les<br />
<strong>droit</strong>s accordés au titre de l’article 6bis sont maintenus au moins jusqu’à l’extinction des <strong>droit</strong>s patrimoniaux.<br />
Aujourd’hui, de nombreux Etats parties ont adopté cette règle et prévoient la même <strong>du</strong>rée de protection<br />
pour les <strong>droit</strong>s moraux et pour les <strong>droit</strong>s patrimoniaux. En vertu des normes internationales, la <strong>du</strong>rée de la<br />
protection des <strong>droit</strong>s patrimoniaux est de 50 ans à compter de la mort de l’auteur, mais certains pays prévoient<br />
une <strong>du</strong>rée de 70 ans.<br />
Que représente le <strong>droit</strong> d’attribution (ou <strong>droit</strong> de paternité) ?<br />
Le <strong>droit</strong> d’attribution est l’un des <strong>droit</strong>s moraux que prévoit l’article 6bis de la Convention de Berne. Il est<br />
souvent appelé <strong>droit</strong> de « paternité », ce qui fait allusion au lien de parenté spirituelle entre l’œuvre et son<br />
créateur, bien que cette terminologie puisse aujourd’hui paraître datée.<br />
En vertu <strong>du</strong> <strong>droit</strong> d’attribution, les auteurs ont le pouvoir exclusif de décider d’associer ou non leur nom à<br />
l’œuvre et de déterminer quand l’œuvre sera publiée ou mise d’une autre manière à la disposition <strong>du</strong> public.<br />
C’est donc le <strong>droit</strong> de revendiquer la paternité de l’œuvre, ainsi que le <strong>droit</strong> de rester dans l’anonymat. L’auteur<br />
peut aussi utiliser un nom d’emprunt (un pseudonyme), comme l’auteur d’ « Alice au pays des merveilles »,<br />
né Charles Lutwige Dodgson mais connu sous le nom de Lewis Carroll, ou bien se servir d’un acronyme<br />
(comme le célèbre « AD » <strong>du</strong> peintre allemand <strong>du</strong> début <strong>du</strong> XVIe siècle Albrecht Dürer). A cette prérogative<br />
33