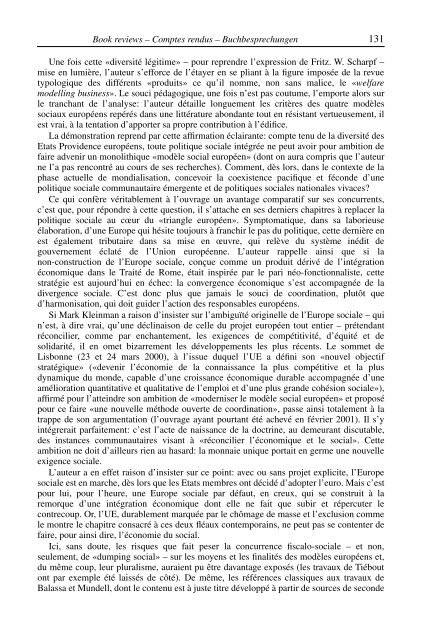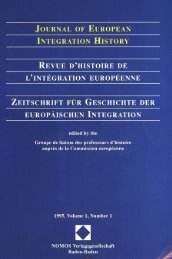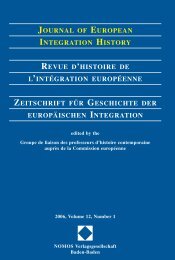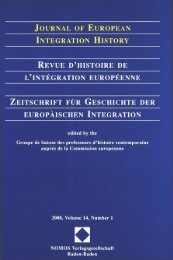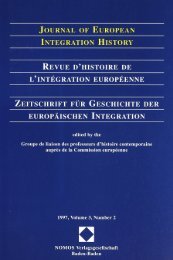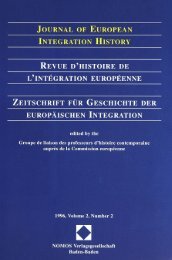journal of european integration history revue d'histoire de l ...
journal of european integration history revue d'histoire de l ...
journal of european integration history revue d'histoire de l ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Book reviews – Comptes rendus – Buchbesprechungen 131Une fois cette «diversité légitime» – pour reprendre l’expression <strong>de</strong> Fritz. W. Scharpf –mise en lumière, l’auteur s’efforce <strong>de</strong> l’étayer en se pliant à la figure imposée <strong>de</strong> la <strong>revue</strong>typologique <strong>de</strong>s différents «produits» ce qu’il nomme, non sans malice, le «welfaremo<strong>de</strong>lling business». Le souci pédagogique, une fois n’est pas coutume, l’emporte alors surle tranchant <strong>de</strong> l’analyse: l’auteur détaille longuement les critères <strong>de</strong>s quatre modèlessociaux européens repérés dans une littérature abondante tout en résistant vertueusement, ilest vrai, à la tentation d’apporter sa propre contribution à l’édifice.La démonstration reprend par cette affirmation éclairante: compte tenu <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong>sEtats Provi<strong>de</strong>nce européens, toute politique sociale intégrée ne peut avoir pour ambition <strong>de</strong>faire advenir un monolithique «modèle social européen» (dont on aura compris que l’auteurne l’a pas rencontré au cours <strong>de</strong> ses recherches). Comment, dès lors, dans le contexte <strong>de</strong> laphase actuelle <strong>de</strong> mondialisation, concevoir la coexistence pacifique et fécon<strong>de</strong> d’unepolitique sociale communautaire émergente et <strong>de</strong> politiques sociales nationales vivaces?Ce qui confère véritablement à l’ouvrage un avantage comparatif sur ses concurrents,c’est que, pour répondre à cette question, il s’attache en ses <strong>de</strong>rniers chapitres à replacer lapolitique sociale au cœur du «triangle européen». Symptomatique, dans sa laborieuseélaboration, d’une Europe qui hésite toujours à franchir le pas du politique, cette <strong>de</strong>rnière enest également tributaire dans sa mise en œuvre, qui relève du système inédit <strong>de</strong>gouvernement éclaté <strong>de</strong> l’Union européenne. L’auteur rappelle ainsi que si lanon-construction <strong>de</strong> l’Europe sociale, conçue comme un produit dérivé <strong>de</strong> l’intégrationéconomique dans le Traité <strong>de</strong> Rome, était inspirée par le pari néo-fonctionnaliste, cettestratégie est aujourd’hui en échec: la convergence économique s’est accompagnée <strong>de</strong> ladivergence sociale. C’est donc plus que jamais le souci <strong>de</strong> coordination, plutôt qued’harmonisation, qui doit gui<strong>de</strong>r l’action <strong>de</strong>s responsables européens.Si Mark Kleinman a raison d’insister sur l’ambiguïté originelle <strong>de</strong> l’Europe sociale – quin’est, à dire vrai, qu’une déclinaison <strong>de</strong> celle du projet européen tout entier – prétendantréconcilier, comme par enchantement, les exigences <strong>de</strong> compétitivité, d’équité et <strong>de</strong>solidarité, il en omet bizarrement les développements les plus récents. Le sommet <strong>de</strong>Lisbonne (23 et 24 mars 2000), à l’issue duquel l’UE a défini son «nouvel objectifstratégique» («<strong>de</strong>venir l’économie <strong>de</strong> la connaissance la plus compétitive et la plusdynamique du mon<strong>de</strong>, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’uneamélioration quantitative et qualitative <strong>de</strong> l’emploi et d’une plus gran<strong>de</strong> cohésion sociale»),affirmé pour l’atteindre son ambition <strong>de</strong> «mo<strong>de</strong>rniser le modèle social européen» et proposépour ce faire «une nouvelle métho<strong>de</strong> ouverte <strong>de</strong> coordination», passe ainsi totalement à latrappe <strong>de</strong> son argumentation (l’ouvrage ayant pourtant été achevé en février 2001). Il s’yintégrerait parfaitement: c’est l’acte <strong>de</strong> naissance <strong>de</strong> la doctrine, au <strong>de</strong>meurant discutable,<strong>de</strong>s instances communautaires visant à «réconcilier l’économique et le social». Cetteambition ne doit d’ailleurs rien au hasard: la monnaie unique portait en germe une nouvelleexigence sociale.L’auteur a en effet raison d’insister sur ce point: avec ou sans projet explicite, l’Europesociale est en marche, dès lors que les Etats membres ont décidé d’adopter l’euro. Mais c’estpour lui, pour l’heure, une Europe sociale par défaut, en creux, qui se construit à laremorque d’une intégration économique dont elle ne fait que subir et répercuter lecontrecoup. Or, l’UE, durablement marquée par le chômage <strong>de</strong> masse et l’exclusion commele montre le chapitre consacré à ces <strong>de</strong>ux fléaux contemporains, ne peut pas se contenter <strong>de</strong>faire, pour ainsi dire, l’économie du social.Ici, sans doute, les risques que fait peser la concurrence fiscalo-sociale – et non,seulement, <strong>de</strong> «dumping social» – sur les moyens et les finalités <strong>de</strong>s modèles européens et,du même coup, leur pluralisme, auraient pu être davantage exposés (les travaux <strong>de</strong> Tiéboutont par exemple été laissés <strong>de</strong> côté). De même, les références classiques aux travaux <strong>de</strong>Balassa et Mun<strong>de</strong>ll, dont le contenu est à juste titre développé à partir <strong>de</strong> sources <strong>de</strong> secon<strong>de</strong>