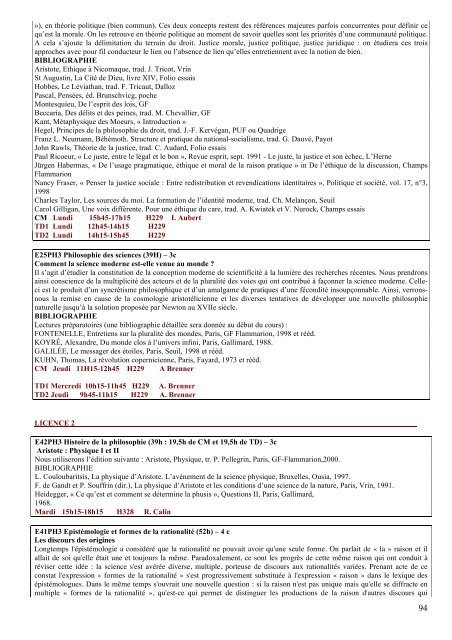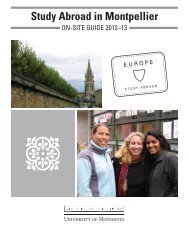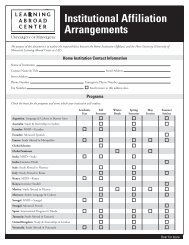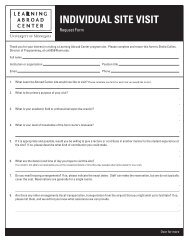04 67 79 15 42 2012-2013 SEMEST - University of Minnesota
04 67 79 15 42 2012-2013 SEMEST - University of Minnesota
04 67 79 15 42 2012-2013 SEMEST - University of Minnesota
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
»), en théorie politique (bien commun). Ces deux concepts restent des références majeures parfois concurrentes pour définir ce<br />
qu’est la morale. On les retrouve en théorie politique au moment de savoir quelles sont les priorités d’une communauté politique.<br />
A cela s’ajoute la délimitation du terrain du droit. Justice morale, justice politique, justice juridique : on étudiera ces trois<br />
approches avec pour fil conducteur le lien ou l’absence de lien qu’elles entretiennent avec la notion de bien.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Vrin<br />
St Augustin, La Cité de Dieu, livre XIV, Folio essais<br />
Hobbes, Le Léviathan, trad. F. Tricaut, Dalloz<br />
Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, poche<br />
Montesquieu, De l’esprit des lois, GF<br />
Beccaria, Des délits et des peines, trad. M. Chevallier, GF<br />
Kant, Métaphysique des Moeurs, « Introduction »<br />
Hegel, Principes de la philosophie du droit, trad. J.-F. Kervégan, PUF ou Quadrige<br />
Franz L. Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme, trad. G. Dauvé, Payot<br />
John Rawls, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Folio essais<br />
Paul Ricoeur, « Le juste, entre le légal et le bon », Revue esprit, sept. 1991 - Le juste, la justice et son échec, L’Herne<br />
Jürgen Habermas, « De l’usage pragmatique, éthique et moral de la raison pratique » in De l’éthique de la discussion, Champs<br />
Flammarion<br />
Nancy Fraser, « Penser la justice sociale : Entre redistribution et revendications identitaires », Politique et société, vol. 17, n°3,<br />
1998<br />
Charles Taylor, Les sources du moi. La formation de l’identité moderne, trad. Ch. Melançon, Seuil<br />
Carol Gilligan, Une voix différente. Pour une éthique du care, trad. A. Kwiatek et V. Nurock, Champs essais<br />
CM Lundi <strong>15</strong>h45-17h<strong>15</strong> H229 I. Aubert<br />
TD1 Lundi 12h45-14h<strong>15</strong> H229<br />
TD2 Lundi 14h<strong>15</strong>-<strong>15</strong>h45 H229<br />
E25PH3 Philosophie des sciences (39H) – 3c<br />
Comment la science moderne est-elle venue au monde ?<br />
Il s’agit d’étudier la constitution de la conception moderne de scientificité à la lumière des recherches récentes. Nous prendrons<br />
ainsi conscience de la multiplicité des acteurs et de la pluralité des voies qui ont contribué à façonner la science moderne. Celleci<br />
est le produit d’un syncrétisme philosophique et d’un amalgame de pratiques d’une fécondité insoupçonnable. Ainsi, verronsnous<br />
la remise en cause de la cosmologie aristotélicienne et les diverses tentatives de développer une nouvelle philosophie<br />
naturelle jusqu’à la solution proposée par Newton au XVIIe siècle.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Lectures préparatoires (une bibliographie détaillée sera donnée au début du cours) :<br />
FONTENELLE, Entretiens sur la pluralité des mondes, Paris, GF Flammarion, 1998 et rééd.<br />
KOYRÉ, Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, 1988.<br />
GALILÉE, Le messager des étoiles, Paris, Seuil, 1998 et rééd.<br />
KUHN, Thomas, La révolution copernicienne, Paris, Fayard, 1973 et rééd.<br />
CM Jeudi 11H<strong>15</strong>-12h45 H229 A Brenner<br />
TD1 Mercredi 10h<strong>15</strong>-11h45 H229 A. Brenner<br />
TD2 Jeudi 9h45-11h<strong>15</strong> H229 A. Brenner<br />
LICENCE 2<br />
E<strong>42</strong>PH3 Histoire de la philosophie (39h : 19,5h de CM et 19,5h de TD) – 3c<br />
Aristote : Physique I et II<br />
Nous utiliserons l’édition suivante : Aristote, Physique, tr. P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion,2000.<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
L. Couloubaritsis, La physique d’Aristote. L’avènement de la science physique, Bruxelles, Ousia, 1997.<br />
F. de Gandt et P. Souffrin (dir.), La physique d’Aristote et les conditions d’une science de la nature, Paris, Vrin, 1991.<br />
Heidegger, « Ce qu’est et comment se détermine la phusis », Questions II, Paris, Gallimard,<br />
1968.<br />
Mardi <strong>15</strong>h<strong>15</strong>-18h<strong>15</strong> H328 R. Calin<br />
E41PH3 Epistémologie et formes de la rationalité (52h) – 4 c<br />
Les discours des origines<br />
Longtemps l'épistémologie a considéré que la rationalité ne pouvait avoir qu'une seule forme. On parlait de « la » raison et il<br />
allait de soi qu'elle était une et toujours la même. Paradoxalement, ce sont les progrès de cette même raison qui ont conduit à<br />
réviser cette idée : la science s'est avérée diverse, multiple, porteuse de discours aux rationalités variées. Prenant acte de ce<br />
constat l'expression « formes de la rationalité » s'est progressivement substituée à l'expression « raison » dans le lexique des<br />
épistémologues. Dans le même temps s'ouvrait une nouvelle question : si la raison n'est pas unique mais qu'elle se diffracte en<br />
multiple « formes de la rationalité », qu'est-ce qui permet de distinguer les productions de la raison d'autres discours qui<br />
94