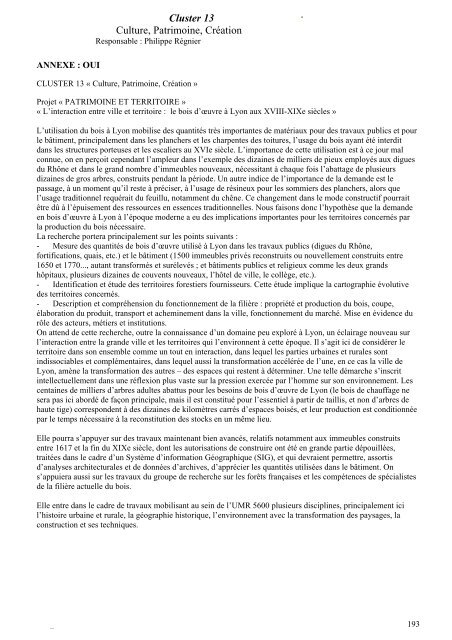Culture, patrimoine, création - Cluster 13
Culture, patrimoine, création - Cluster 13
Culture, patrimoine, création - Cluster 13
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ANNEXE : OUI<br />
<strong>Cluster</strong> <strong>13</strong><br />
<strong>Culture</strong>, Patrimoine, Création<br />
Responsable : Philippe Régnier<br />
CLUSTER <strong>13</strong> « <strong>Culture</strong>, Patrimoine, Création »<br />
Projet « PATRIMOINE ET TERRITOIRE »<br />
« L’interaction entre ville et territoire : le bois d’œuvre à Lyon aux XVIII-XIXe siècles »<br />
L’utilisation du bois à Lyon mobilise des quantités très importantes de matériaux pour des travaux publics et pour<br />
le bâtiment, principalement dans les planchers et les charpentes des toitures, l’usage du bois ayant été interdit<br />
dans les structures porteuses et les escaliers au XVIe siècle. L’importance de cette utilisation est à ce jour mal<br />
connue, on en perçoit cependant l’ampleur dans l’exemple des dizaines de milliers de pieux employés aux digues<br />
du Rhône et dans le grand nombre d’immeubles nouveaux, nécessitant à chaque fois l’abattage de plusieurs<br />
dizaines de gros arbres, construits pendant la période. Un autre indice de l’importance de la demande est le<br />
passage, à un moment qu’il reste à préciser, à l’usage de résineux pour les sommiers des planchers, alors que<br />
l’usage traditionnel requérait du feuillu, notamment du chêne. Ce changement dans le mode constructif pourrait<br />
être dû à l’épuisement des ressources en essences traditionnelles. Nous faisons donc l’hypothèse que la demande<br />
en bois d’œuvre à Lyon à l’époque moderne a eu des implications importantes pour les territoires concernés par<br />
la production du bois nécessaire.<br />
La recherche portera principalement sur les points suivants :<br />
- Mesure des quantités de bois d’œuvre utilisé à Lyon dans les travaux publics (digues du Rhône,<br />
fortifications, quais, etc.) et le bâtiment (1500 immeubles privés reconstruits ou nouvellement construits entre<br />
1650 et 1770..., autant transformés et surélevés ; et bâtiments publics et religieux comme les deux grands<br />
hôpitaux, plusieurs dizaines de couvents nouveaux, l’hôtel de ville, le collège, etc.).<br />
- Identification et étude des territoires forestiers fournisseurs. Cette étude implique la cartographie évolutive<br />
des territoires concernés.<br />
- Description et compréhension du fonctionnement de la filière : propriété et production du bois, coupe,<br />
élaboration du produit, transport et acheminement dans la ville, fonctionnement du marché. Mise en évidence du<br />
rôle des acteurs, métiers et institutions.<br />
On attend de cette recherche, outre la connaissance d’un domaine peu exploré à Lyon, un éclairage nouveau sur<br />
l’interaction entre la grande ville et les territoires qui l’environnent à cette époque. Il s’agit ici de considérer le<br />
territoire dans son ensemble comme un tout en interaction, dans lequel les parties urbaines et rurales sont<br />
indissociables et complémentaires, dans lequel aussi la transformation accélérée de l’une, en ce cas la ville de<br />
Lyon, amène la transformation des autres – des espaces qui restent à déterminer. Une telle démarche s’inscrit<br />
intellectuellement dans une réflexion plus vaste sur la pression exercée par l’homme sur son environnement. Les<br />
centaines de milliers d’arbres adultes abattus pour les besoins de bois d’œuvre de Lyon (le bois de chauffage ne<br />
sera pas ici abordé de façon principale, mais il est constitué pour l’essentiel à partir de taillis, et non d’arbres de<br />
haute tige) correspondent à des dizaines de kilomètres carrés d’espaces boisés, et leur production est conditionnée<br />
par le temps nécessaire à la reconstitution des stocks en un même lieu.<br />
Elle pourra s’appuyer sur des travaux maintenant bien avancés, relatifs notamment aux immeubles construits<br />
entre 1617 et la fin du XIXe siècle, dont les autorisations de construire ont été en grande partie dépouillées,<br />
traitées dans le cadre d’un Système d’information Géographique (SIG), et qui devraient permettre, assortis<br />
d’analyses architecturales et de données d’archives, d’apprécier les quantités utilisées dans le bâtiment. On<br />
s’appuiera aussi sur les travaux du groupe de recherche sur les forêts françaises et les compétences de spécialistes<br />
de la filière actuelle du bois.<br />
Elle entre dans le cadre de travaux mobilisant au sein de l’UMR 5600 plusieurs disciplines, principalement ici<br />
l’histoire urbaine et rurale, la géographie historique, l’environnement avec la transformation des paysages, la<br />
construction et ses techniques.<br />
193