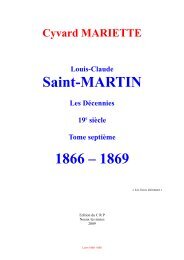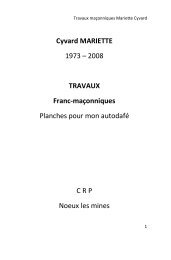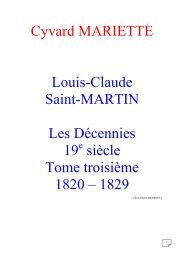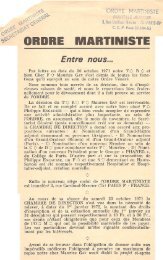Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
et bienveillante. Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre répandit sur tous ses écrits la teinte évangélique du<br />
vicaire savoyard. M. de Châteaubriand, sorti d'une première incertitude, remonta jusqu'aux<br />
autels catholiques dont il fêta la dédicace nouvelle. Ces deux derniers, qui, sous l'appareil de<br />
la philanthropie ou de l'orthodoxie, couvraient des portions de tristesse chagrine et de<br />
préoccupation assez amère, dont il n'y a pas trace chez leur rivale expansive, avaient le mérite<br />
de sentir, de peindre, bien autrement qu'elle, cette nature solitaire qui, tant de fois, les avait<br />
consolés des hommes ; ils étaient vraiment religieux par là, tandis qu'elle, elle était plutôt<br />
religieuse en vertu de ses sympathies humaines. Chez tous les trois, ce développement plein<br />
de grandeur auquel, dans l'espace de vingt années, on dut les Etudes et les Harmonies de la<br />
Nature, Delphine et Corinne, le Génie du Christianisme et les Martyrs, s'accomplissait au<br />
moyen d'une prose riche, épanouie, cadencée, souvent métaphysique chez madame de Staël,<br />
purement poétique dans les [40] deux autres, et d'autant plus désespérante, en somme, qu'elle<br />
n'avait pour pendant et vis-à-vis que les jolis miracles de la versification delilienne. Mais<br />
Lamartine était né. Ce n'est plus de Jean-Jacques qu'émane directement Lamartine ; c'est de<br />
Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre, de M. de Châteaubriand et de lui-même. La lecture de Bernardin de<br />
<strong>Saint</strong>-Pierre produit une délicieuse impression dans la première jeunesse. Il a peu d'idées, des<br />
systèmes importuns, une modestie fausse, une prétention à l'ignorance, qui revient toujours et<br />
impatiente un peu. Mais il sent la nature, il l'adore, il l'embrasse sous ses aspects magiques,<br />
par masses confuses, au sein des clairs de lune où elle est baignée ; il a des mots d'un effet<br />
musical et qu'il place dans son style comme des harpes éoliennes, pour nous ravir en rêverie.<br />
Que de fois, enfant, le soir le long des routes, je me suis surpris répétant avec des pleurs son<br />
invocation aux forêts et à leurs résonnantes clairières ! Lamartine, vers 1808, devait beaucoup<br />
lire les Études de Bernardin; il devait dès lors s'initier par lui au secret de ces voluptueuses<br />
couleurs dont plus tard il a peint dans le Lac son souvenir le plus chéri :<br />
Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,<br />
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,<br />
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface<br />
De ses molles clartés !<br />
[41] Le génie pittoresque du prosateur a passé tout entier en cette muse : il s'y est éclipsé et<br />
s'est détruit lui-même en la nourrissant. Aussi, à part Paul et Virginie, que rien ne saurait<br />
atteindre, Lamartine dispense à peu près aujourd'hui de la lecture de Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre<br />
; quand on nommera les Harmonies, c'est uniquement de celles du poète que la postérité<br />
entendra parler. Lamartine, vers le même temps, aima et lut sans doute beaucoup le Génie du<br />
Christianisme, René: si sa simplicité, ses instincts de goût sans labeur ne s'accommodaient<br />
qu'imparfaitement de quelques traits de ces ouvrages, son éducation religieuse, non moins que<br />
son anxiété intérieure, le disposait à en saisir les beautés sans nombre. Quand il s'écrie à la fin<br />
de l'Isolement, dans la première des premières Méditations :<br />
Et moi je suis semblable à la feuille flétrie<br />
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !<br />
Il n'est que l'écho un peu affaibli de cette autre voix impétueuse:<br />
Levez-vous, orages désirés, qui devez emporter René, etc. Rousseau, je le sais, agit aussi très<br />
puissamment sur Lamartine ; mais ce fut surtout à travers Bernardin de <strong>Saint</strong>-Pierre et M. de<br />
Chateaubriand qu'il le sentit. Il n'eut rien de Werther; il ne connut guère Byron de bonne<br />
heure, et même en savait peu de chose au delà du renom fantastique qui circulait, quand il lui<br />
[42] adressa sa magnifique remontrance. Son génie préexistait à toute influence lointaine.<br />
André Chénier, dont la publication tardive (18<strong>19</strong>) a donné l'éveil à de bien nobles muses,<br />
particulièrement à celle de M. Alfred de Vigny, resta, jusqu'à ces derniers temps, inaperçu et,<br />
disons-le, méconnu de Lamartine, qui n'avait rien, il est vrai, à tirer de ce monde d'inspiration<br />
antique, et dont le style était déjà né de lui-même à la source de ses pensées. J'oserai affirmer,<br />
sans crainte de démenti, que, si les poésies fugitives de Ducis sont tombées aux mains de<br />
décennies 1830_1839<br />
100