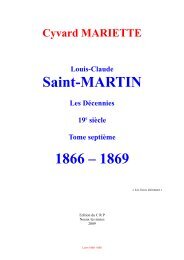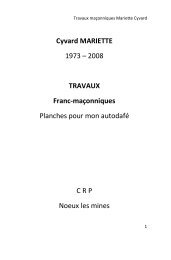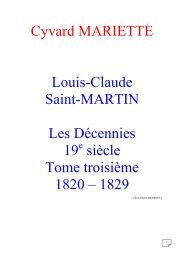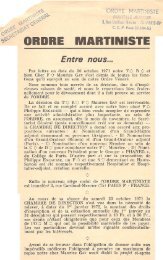Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
[324] partie, de la méthode : « Dans cette partie, je n'aurai, ajoute-t-il, presque rien à dire de<br />
nouveau; je me bornerai à recueillir les résultats que j'aurai exposés et développés dans les<br />
sections précédentes. Je ferai voir que bien sentir, bien se servir de ses facultés, bien former<br />
ses idées, bien parler, sous des points de vue et des termes divers, ne sont qu'une seule et<br />
même chose (1). M Toujours donc la sensation transformée, toujours l'intérêt bien entendu,<br />
toujours l'interjection, toujours, en un mot, la philosophie du XVIIIe siècle. Cette philosophie<br />
dominait alors avec une puissance qui en faisait comme une religion ; elle était non seulement<br />
la vérité, mais toute la vérité : ses nombreux disciples n'admettaient pas qu'il y eût possibilité<br />
à croire en quelque autre symbole philosophique.<br />
Le spiritualisme essaya pourtant d'une timide récrimination. A cette école, les élèves avaient<br />
le droit d'interpeller les professeurs, soit pour les combattre, soit pour leur deman-<br />
(1) Recueil des leçons de l'Ecole normale, 2e volume, page 39.<br />
[325] der de plus amples explications : un jour par semaine était réservé à ces débats. Or,<br />
parmi les auditeurs de Garat, se trouvait ce fameux <strong>Saint</strong>-Martin, auteur mystérieux de tant<br />
d'ouvrages mystiques, traducteur et commentateur de Jacob Bœhm, celui que M. de Maistre a<br />
nommé le plus élégant des théosophes modernes, et probablement seul alors à oser professer<br />
en France une autre philosophie que celle de Condillac. <strong>Saint</strong>-Martin eut d'abord quelque<br />
peine à se faire au langage du jour. La langue du matérialisme ne ressemblait en rien à celle<br />
parlée dans ces hautes sphères de la spéculation où l'emportait son génie. Enfin, le professeur<br />
ayant amèrement blâmé cette célèbre proposition de Jean-Jacques : « La parole semble avoir<br />
été fort nécessaire à l'institution de la parole, » <strong>Saint</strong>-Martin, de son banc, et du milieu de la<br />
foule, entreprit la défense de Rousseau. Profitant de l'occasion, il défendait de même, contre<br />
une autre attaque du professeur, la doctrine de Hutcheson sur le sens moral. Mais le débat ne<br />
tarda pas à devenir plus important, le dialogue suivant s'engagea entre l'élève et le professeur :<br />
« Vous paraissez vouloir, [526] disait ce dernier, qu'il y ait dans l'homme un organe<br />
d'intelligence autre que nos sens extérieurs et notre sensibilité intérieure ? — Oui, citoyen. —<br />
Un organe d'intelligence ? — Oui, citoyen. — Vous avez pour doctrine que sentir les choses<br />
et les connaître sont des choses différentes ? — J'en suis persuadé. — Cependant, lorsque je<br />
reçois en présence du soleil les sensations que me donne cet astre éclatant qui échauffe et qui<br />
éclaire la terre, est-ce que j'en connais autre chose que les sensations mêmes que j'en reçois ?<br />
— Vous sentez les sensations; mais les réflexions que vous ferez sur le soleil, mais... (1). »<br />
<strong>Saint</strong>-Martin aurait eu sans doute bien d'autres mais à ajouter; mais le professeur, prenant tout<br />
à coup un ton solennel : « Ce qu'il importe d'abord de dire, c'est que par cette doctrine dans<br />
laquelle on suppose que nos sensations et nos idées sont des choses différentes, c'est le<br />
platonisme, le cartésianisme, le malebranchisme que vous ressuscitez. Quand on a une foi, il<br />
est beau de la professer, il est beau de la pro-<br />
(1) Débats, t. 3, p. 18<br />
[327] fesser du haut des toits ; mais il n'est pas bon de porter une foi dans la métaphysique<br />
comme en physique. La philosophie observe les faits, elle les classe, elle les combine, mais<br />
elle ne s'écarte jamais des résultats immédiats, soit dans leur simplicité, soit dans leur<br />
combinaison. Ce n'est point là le procédé de Malebranche et de Platon : l'un et l'autre<br />
supposent dans l'homme des agents qui ne nous sont connus par aucun fait sensible, et des<br />
faits qui ne nous sont connus par aucune de nos sensations. De pareils agents sont précisément<br />
de ces idoles qui ont obtenu si longtemps un culte superstitieux de l'esprit humain, de ces<br />
idoles dont les écoles étaient.les temples, et dont Bacon le premier a brisé les statues et les<br />
autels. Ce serait un grand malheur si, à l'ouverture des écoles normales et des écoles centrales,<br />
décennies 1830_1839<br />
104