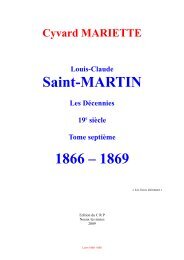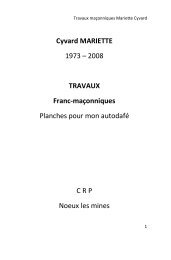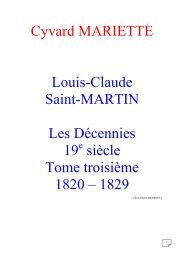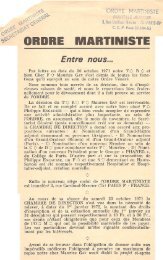Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
Cyvard MARIETTE Louis-Claude Saint-MARTIN Les Décennies 19 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
succession présuppose la durée, dans laquelle elle n'est qu'un rapport [332] de nombre,<br />
comme le mouvement présuppose l'étendue. Qu'on ne cherche pas l'origine de la durée dans<br />
la succession : on ne la trouvera que dans l'activité du moi. Le moi dure, parce qu'il agit ; il<br />
dure sans cesse, parce qu'il agit sans cesse : sa durée, c'est son action continue, réfléchie<br />
dans la conscience et dans la mémoire : de la continuité de l'action naît la continuité de la<br />
durée ; si l'action cessait pour recommencer, et cessait encore pour recommencer encore, le<br />
moi se sentirait à chaque instant défaillir et renaître ; la durée serait une quantité discrète<br />
comme le nombre ; ses parties seraient séparées par des intervalles où il n'y aurait pas de<br />
durée. Elle est une quantité continue parce que le moi se sent continu, et il se sent continu,<br />
parce que son action est continue. Et plus loin il s'exprime en ces termes, pour montrer<br />
comment la pensée passe de la durée limitée à la durée illimitée :<br />
« A l'occasion de la durée contingente et limitée des choses, nous comprenons une durée<br />
nécessaire et illimitée, théâtre éternel de toutes les existences ; et non seulement nous la<br />
comprenons, mais nous sommes invinciblement persuadés de sa réalité. Cette durée est le<br />
temps. Que la pensée anéantisse, elle le peut, et les choses et leurs successions ; il n'est pas en<br />
son pouvoir d'anéantir le temps : il subsiste vide d'événements ; il continue de s'écouler,<br />
quoiqu'il n'entraîne plus rien dans son cours. Dans l'ordre de la connaissance, c'est la durée<br />
particulière du moi qui amène le temps ; dans l'ordre de la nature, le temps est antérieur, à<br />
toutes les vicissitudes qui s'opèrent en lui, à toutes les révolutions par lesquelles nous le<br />
mesurons. Le commencement du temps implique contradiction ; la supposition d'un temps qui<br />
aurait précédé le temps est absurde. »<br />
Enfin voici comment il compare en elles-mêmes et dans leurs idées le temps et l'espace :<br />
« Comme la notion de durée devient indépendante des événements qui nous l'ont donnée, de<br />
même la notion de l'étendue, aussitôt que nous l'avons acquise, devient indépendante des<br />
objets où nous l'avons trouvée. Quand la pen[333]sée anéantit ceux-ci, elle n' anéantit pas<br />
l'espace qui les contenait. Comme la notion d'une durée limitée nous suggère la notion du<br />
temps, c'est-à-dire d'une durée sans bornes, qui n'a pas pu commencer et qui ne pourrait pas<br />
finir, de même la notion d'une étendue limitée nous suggère la notion de l'espace, c'est-à-dire<br />
une étendue infinie et nécessaire qui demeure immobile, tandis que les corps s'y meuvent en<br />
tout sens. Le temps se perd dans l’éternité, l'espace dans l'immensité. Sans le temps il n'y<br />
aurait pas de durée; sans l'espace il n'y aurait pas d'étendue. Le temps et l'espace contiennent<br />
dans leur ample sein toutes les existences finies, et ils ne sont contenus dans aucune. Toutes<br />
les choses créées sont situées dans l'espace, et elles ont aussi leur moment dans le temps ;<br />
mais le temps est partout, et l'espace aussi ancien que le temps. »<br />
Reprenons. Le système qui réduit toute l'intelligence à la sensation n'est pas incomplet<br />
seulement parce qu'il n'explique pas les notions de substance, de cause, de temps et d'espace,<br />
il l'est aussi parce qu'il n'explique bien aucune idée morale. En effet, si la sensation est tout le<br />
sens humain, il ne peut y avoir que la matière qui soit un objet de connaissance : car la<br />
sensation ne tombe jamais que sur l'étendue, la figure, la couleur, etc. ; elle ne porte pas sur<br />
les faits qui sont du domaine de la conscience ; elle se fixe sur le monde, et ne se retour ne<br />
pas sur l'âme ; elle est la vue de l'esprit par les sens; et par les sens l'esprit ne voit ni passion,<br />
ni pensée, ni volonté ; il ne voit rien d'intime, de moral : il ne perçoit que le physique, du<br />
moins si on le réduit rigoureusement à la sensation, et qu'on ne prête pas à la sensation une<br />
propriété qu'elle n'a pas. Ainsi, borner l'homme au toucher, à la vue, au goût, à l'ouïe et à<br />
l'odorat, le borner à la sensibilité externe, c'est nier qu'il ait le sentiment des faits<br />
psychologiques ; ou, si on ne le nie pas, on désavoue, on contredit le principe duquel on part.<br />
Condillac serait en opposition avec lui-même s'il reconnaissait à l'âme humaine d'autres<br />
notions que celles des sens. Or, une telle conséquence ruine le système dont elle sort, et M.<br />
Royer-Collard n'eut pas de peine à le faire voir : il démontra qu'une idéologie qui se<br />
condamne [334] à ne rien dire du sens moral et des idées dont il est la source est par là même<br />
décennies 1830_1839<br />
17