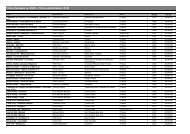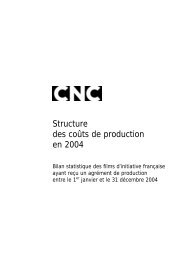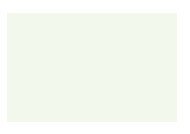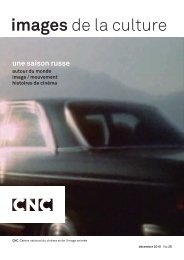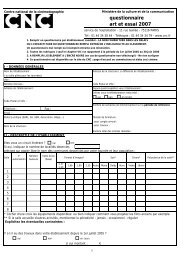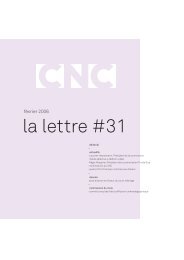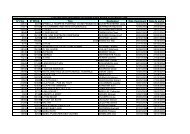télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
le deuil de l’amérique<br />
Notes à propos du film Diane Wellington d’Arnaud des Pallières, par Sylvain Maestraggi. fille ? Quelle société ne peut se reprocher de<br />
Lorsque je me suis rendu à New York pour <strong>la</strong><br />
première fois, j’ai été déçu. La ville me paraissait<br />
terriblement concrète, déglinguée. Comme<br />
une grosse machine rouillée. Elle n’avait pas <strong>la</strong><br />
magnificence, <strong>la</strong> grandeur que j’avais espérées.<br />
Ce n’est qu’en rentrant en France, en al<strong>la</strong>nt au<br />
cinéma voir un film de Scorsese (tourné en fait<br />
à Boston et non à New York) et après lui d’autres<br />
films américains, que j’ai réalisé que ce pays,<br />
ce décor, à travers lequel j’avais voyagé au<br />
cinéma toute mon enfance, n’était pas un rêve,<br />
mais existait réellement. C’est alors que s’est<br />
produit le véritable choc.<br />
Si au XVIIIe siècle, on envoyait les jeunes aristocrates<br />
ang<strong>la</strong>is en Italie pour leur faire découvrir<br />
le berceau de <strong>la</strong> culture occidentale, pour<br />
qu’après des années de lecture des textes grecs<br />
et <strong>la</strong>tins, ils se promènent dans les paysages<br />
de Virgile, d’Ovide ou de l’histoire romaine, au<br />
XXIe siècle, c’est aux Etats-Unis qu’il faudrait<br />
envoyer tout jeune Européen accomplir le Grand<br />
Tour. Quitte à provoquer une désillusion.<br />
Car il y a avec l’Amérique, comme l’annonçait<br />
Disney<strong>la</strong>nd mon vieux pays natal, un compte<br />
à régler. Dans ce film, daté de 2000, Arnaud<br />
des Pallières partait explorer le parc d’attractions<br />
de Marne-<strong>la</strong>-Vallée à <strong>la</strong> recherche d’une<br />
enfance supposée, celle à qui s’adresse l’univers<br />
de Disney, pour y rencontrer une tout autre<br />
réalité et de tout autres récits que ceux des<br />
studios américains. Que l’Amérique soit notre<br />
“vieux pays natal” signifie que nous avons<br />
grandi avec elle, imprégnés de sa mythologie<br />
portée et exportée par le cinéma, <strong>la</strong> bande<br />
dessinée, <strong>la</strong> musique. L’Amérique a bercé notre<br />
enfance. Pour <strong>la</strong> jeunesse européenne, depuis<br />
<strong>la</strong> Seconde Guerre mondiale, elle représente<br />
le pays du rêve. Mais arrivés à l’âge adulte, soit<br />
que <strong>la</strong> vie nous ait conduits à cesser de rêver,<br />
soit que l’on ait appris à connaître l’histoire<br />
des Etats-Unis, on ne peut plus rêver innocemment<br />
de l’Amérique comme on en a rêvé<br />
enfant, on ne peut plus ignorer <strong>la</strong> part d’injustice,<br />
de trahison, d’intérêt qui se cache derrière ce<br />
rêve, comme derrière toute existence.<br />
C’est autour de ce moment de désillusion, de<br />
cette perte de l’innocence, que semblent tourner<br />
Diane Wellington (2010) et Poussières d’Amérique<br />
(2011) d’Arnaud des Pallières, comme<br />
avant eux son film sur Disney<strong>la</strong>nd.<br />
le rêve américain<br />
Diane Wellington et Poussières d’Amérique<br />
forment un diptyque. Les deux films ont été<br />
conçus selon <strong>la</strong> même méthode : de brefs récits<br />
à <strong>la</strong> première personne composés de phrases<br />
données à lire sur fond noir et d’images d’archives<br />
provenant des Etats-Unis, images, entre<br />
autres, de <strong>la</strong> chasse à <strong>la</strong> baleine, de l’abattage<br />
des forêts, d’interminables banlieues résidentielles<br />
et de <strong>la</strong> conquête spatiale dans Poussières<br />
d’Amérique, images d’une petite ville de<br />
province dans Diane Wellington. Récits muets,<br />
mais accompagnés d’une bande originale de<br />
Martin Wheeler, de citations musicales et<br />
d’ambiances sonores. Si Poussières d’Amérique<br />
dure près d’une heure quarante, Diane Wellington<br />
ne dure que seize minutes, et n’est constitué<br />
que d’un seul récit. Quoique antérieur, il pourrait<br />
être un fragment détaché de Poussières<br />
d’Amérique, une séquence qui n’y aurait pas<br />
trouvé sa p<strong>la</strong>ce, parce que possédant son<br />
unité propre.<br />
Les deux films re<strong>la</strong>tent l’histoire d’un crime,<br />
crimes apparentés, mais d’envergure différente.<br />
Dans Poussières d’Amérique, c’est du<br />
crime de l’histoire dont il est question : l’exploitation<br />
de <strong>la</strong> nature et le massacre des Indiens,<br />
l’héroïsme de <strong>la</strong> conquête qui prend sa source<br />
dans <strong>la</strong> violence pour se résoudre quelques<br />
siècles plus tard dans le conformisme débilitant<br />
de l’American way of life, idéal vaniteux sous<br />
lequel se rassemblent le petit propriétaire creusant<br />
sa piscine et l’astronaute qui s’envole vers<br />
<strong>la</strong> lune. Dans Diane Wellington, il s’agit d’un<br />
fait divers dont l’origine est à chercher dans<br />
les mœurs et <strong>la</strong> mentalité d’une petite ville : <strong>la</strong><br />
mort d’une jeune fille dans <strong>la</strong> solitude, oubliée<br />
par ses camarades de c<strong>la</strong>sse qui ne voyaient<br />
en elle qu’une représentante de <strong>la</strong> bourgeoisie<br />
et de leurs rêves d’ascension sociale.<br />
Mais ces crimes après tout qu’ont-ils d’exceptionnel<br />
? Qui y a-t-il là de proprement américain<br />
? Massacrer un peuple, sacrifier une jeune<br />
telles injustices ? La spécificité de ces crimes,<br />
c’est qu’ils ont le rêve pour complice, qu’ils<br />
sont le revers d’un rêve ou d’une fiction – de <strong>la</strong><br />
grande fiction américaine, du grand récit<br />
épique : le “rêve américain”, dont le cinéma,<br />
“l’usine à rêve”, s’est fait le promoteur. Certes, à<br />
travers lui, l’Amérique a toujours pris en charge<br />
sa propre critique, mais pour renouveler à<br />
chaque fois d’un vœu pieux le pacte avec sa<br />
conscience, en rappe<strong>la</strong>nt les valeurs qui <strong>la</strong><br />
fondent : liberté, égalité, succès, bonheur. Droits<br />
fondamentaux qui quand ils sont bafoués<br />
autorisent le héros de cinéma à se faire justice<br />
lui-même, à recourir à <strong>la</strong> sauvagerie pour restaurer<br />
l’ordre social. C’est <strong>la</strong> dimension cathartique<br />
du cinéma américain, faite de violence<br />
destructrice et de réconciliation. Mais l’horizon<br />
de <strong>la</strong> réconciliation – l’éternel happy ending qui<br />
viendrait couronner <strong>la</strong> “poursuite du bonheur”<br />
– appartient-il à <strong>la</strong> réalité ou à <strong>la</strong> fiction ? Et<br />
cette fiction qui voudrait purger <strong>la</strong> société de<br />
sa violence n’est-elle pas suspecte au contraire<br />
de l’exciter (que l’on pense au récent massacre<br />
d’Aurora dans une salle de cinéma), surtout si<br />
le rêve promis par <strong>la</strong> fiction ne se réalise pas, s’il<br />
se révèle être un cauchemar ou un mensonge ?<br />
souvenirs d’enfance<br />
Poussières d’Amérique s’ouvre sur le récit<br />
d’un mensonge : Christophe Colomb, qui avait<br />
promis une récompense au premier de ses<br />
marins qui verrait <strong>la</strong> terre, refuse de l’accorder<br />
au vainqueur sous prétexte qu’il l’a aperçue<br />
avant lui. Ce mensonge inaugural, le film le<br />
décline sous une multitude de petits récits qui<br />
sont autant d’histoires de résignations, de<br />
déceptions, de promesses non tenues, qui tapissent<br />
le revers du “rêve américain” : l’homme qui<br />
construit sa piscine ne veut plus de sa vie de<br />
famille une fois les travaux terminés ; <strong>la</strong> femme<br />
à qui son mari demande ce qu’elle veut pour<br />
son anniversaire répond qu’elle souhaite le<br />
divorce ; <strong>la</strong> mère qui sur son lit de mort désire<br />
se maquiller une dernière fois y renonce en<br />
contemp<strong>la</strong>nt son visage vieilli dans le miroir, et<br />
ainsi de suite.<br />
La dimension infernale de l’idéal domestique<br />
est accentuée dans Poussières d’Amérique<br />
58 images de <strong>la</strong> culture