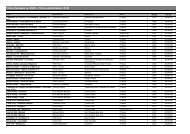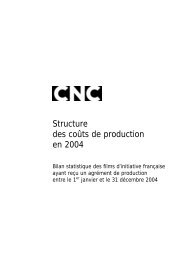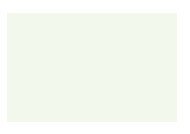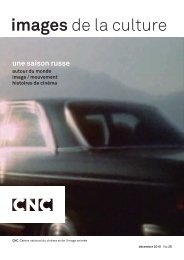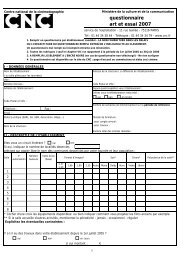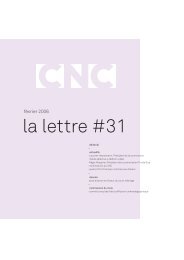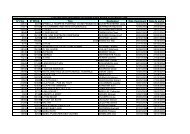télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
images documentaires renvoient à quelque<br />
chose d’invisible. Parmi les visages souriants qui<br />
lui sont présentés, elles <strong>la</strong>issent au spectateur<br />
le soin de deviner où sont les innocents et où<br />
sont les coupables. Nous n’avons plus affaire<br />
au corps glorieux de l’acteur, mais à de fugaces<br />
fragments de vie dont <strong>la</strong> vérité reste secrète.<br />
Le récit, lui, nous est donné à lire sous <strong>la</strong> forme<br />
de courtes phrases qui apparaissent à l’écran.<br />
Il ne s’agit ni de cartons à <strong>la</strong> manière du cinéma<br />
muet ni d’une voix off, mais d’une voix silencieuse<br />
qui s’adresse à nous à <strong>la</strong> première personne et<br />
résonne dans notre l’esprit, par l’intermédiaire<br />
de <strong>la</strong> lecture, comme s’il nous était donné de<br />
l’entendre. Une voix qui se singu<strong>la</strong>rise par son<br />
rythme, l’alternance plus ou moins rapide du<br />
texte et des images, le découpage des propositions,<br />
leur répercussion sur ce que l’on voit,<br />
coïncidence ou interruption, suspension, attente,<br />
re<strong>la</strong>nce. En donnant ainsi le texte à lire, Arnaud<br />
des Pallières ramène l’expérience du cinéma,<br />
celle de partager l’écoute et <strong>la</strong> vision d’un film<br />
avec une salle entière, au sentiment d’intimité<br />
qui n’appartient qu’au livre. Par cette opération,<br />
il met le cinéma, art du collectif, au singulier.<br />
Diane Wellington, comme Poussières d’Amérique,<br />
suscite dès lors une forme d’empathie<br />
qui s’éloigne de l’identification avec les personnages<br />
à <strong>la</strong>quelle nous a habitués le cinéma<br />
américain. Que l’on se souvienne du magnifique<br />
discours de Tom Joad (Henri Fonda) à <strong>la</strong> fin des<br />
Raisins de <strong>la</strong> colère, justement. Avant de disparaître,<br />
Tom Joad promet qu’il sera toujours là où<br />
l’on se bat contre l’injustice, qu’il n’est pas un<br />
individu isolé, mais qu’il fait partie d’une âme<br />
collective. Ce discours galvanise le spectateur<br />
en l’invitant à se reconnaître dans cette âme<br />
collective. La grande fiction, pour le meilleur ou<br />
pour le pire, est toujours intégratrice. Mickey<br />
nous tend les bras à l’entrée de Disney<strong>la</strong>nd et, sur<br />
d’immenses pelouses, des maisons uniformes<br />
s’apprêtent à accueillir l’Américain moyen.<br />
Chez des Pallières, au contraire, singu<strong>la</strong>rité,<br />
intimité, solitude de <strong>la</strong> lecture, renvoient à <strong>la</strong><br />
solitude des personnages : solitude de Diane<br />
Wellington, révélée par le récit ; solitude du<br />
narrateur qui écoute l’histoire qui lui est rapportée<br />
par sa mère. Au discours cathartique<br />
de <strong>la</strong> fiction, à <strong>la</strong> promesse de rédemption collective,<br />
le cinéaste oppose une multitude de<br />
micro-récits discordants, de contes cruels,<br />
énigmatiques, irrésolus.<br />
Si Walter Benjamin, cité dans Drancy Avenir,<br />
film réalisé par Arnaud des Pallières en 1997,<br />
invitait l’historien à se dégager de <strong>la</strong> vision des<br />
vainqueurs pour “prendre l’histoire à rebroussepoil”,<br />
le cinéaste, lui, par ces opérations et ces<br />
choix narratifs, applique ce précepte à <strong>la</strong> fiction.<br />
Histoire et fiction d’ailleurs c’est tout un, si <strong>la</strong><br />
distance entre les deux n’est pas maintenue<br />
par les grains de poussière d’existences insolites<br />
qui font grincer <strong>la</strong> grande machine du récit. S.M.<br />
ceux qui vont<br />
à l’abattoir<br />
En Normandie et en Bretagne, des usines géantes transforment 24 heures sur 24 les bêtes<br />
vivantes – vaches, porcs ou poulets – en barquettes de viande sous film p<strong>la</strong>stique destinées<br />
aux supermarchés. Dans ces sites industriels ultramodernes se concentre une extrême<br />
violence, celle faite aux bêtes tuées à <strong>la</strong> chaîne et celle faite aux ouvriers qui y travaillent<br />
dans des conditions insoutenables. C’est à ces centaines d’hommes et de femmes issus<br />
des vertes campagnes environnantes que <strong>la</strong> réalisatrice Manue<strong>la</strong> Frésil donne <strong>la</strong> parole<br />
de manière chorale et par moment même chorégraphique. Aboutissement d’un long travail<br />
cinématographique sur le rapport à l’animal dans notre société dominée par l’agro-industrie,<br />
Entrée du personnel a reçu le grand prix de <strong>la</strong> compétition française au FID-Marseille 2011.<br />
Quand avez-vous commencé à travailler<br />
sur le projet de Entrée du personnel ?<br />
J’ai mis sept ans à faire le film. Pour moi, les films<br />
sont comme des poupées russes et un projet<br />
en engendre souvent un autre. J’ai réalisé un film<br />
sur un élevage industriel (Si loin des bêtes, 2003,<br />
Arturo Mio/Arte) suite à un autre film sur le mythe<br />
de <strong>la</strong> vie à <strong>la</strong> campagne (Notre campagne, 1999,<br />
Amip/Arte). Ce<strong>la</strong> m’avait amenée en Bretagne<br />
à rencontrer des gens qui étaient pris dans le<br />
système agro-industriel de production. Un<br />
éleveur de porcs, bouleversé d’être accusé de<br />
maltraiter les bêtes, m’avait fait venir dans son<br />
exploitation. Les conditions de vie des bêtes que<br />
nous avons observées étaient épouvantables<br />
mais il ne le voyait pas. Mon premier film portait<br />
sur le ma<strong>la</strong>ise de ces éleveurs que le système<br />
industriel empêche d’être vraiment des éleveurs.<br />
J’étais alors entrée dans les abattoirs<br />
pour filmer l’aboutissement du processus.<br />
Vous avez donc commencé à filmer<br />
dans les abattoirs il y a plus de dix ans ?<br />
Oui, nous étions en 1999, en plein dans le scandale<br />
du poulet à <strong>la</strong> dioxine, qui succédait à celui<br />
de <strong>la</strong> vache folle. La filière du porc était fragilisée<br />
par une affaire de peste porcine en Espagne et<br />
au Danemark. L’union européenne mettait en<br />
p<strong>la</strong>ce des directives sur le bien-être des animaux<br />
et <strong>la</strong> traçabilité. Les industriels, notamment<br />
les Bretons, étaient encore très fiers de “nourrir<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète”, le grand enjeu depuis les années<br />
1960, et très fiers de <strong>la</strong> modernité de leurs dispositifs.<br />
En rencontrant les ouvriers des abattoirs,<br />
je leur ai posé <strong>la</strong> même question qu’aux<br />
éleveurs : “Qu’est-ce que ça vous fait de faire ça<br />
aux bêtes ?” Mes interlocuteurs qui étaient des<br />
syndicalistes ont répondu que ce n’était pas<br />
leur problème. Eux, ils travail<strong>la</strong>ient à l’embal-<br />
<strong>la</strong>ge, à <strong>la</strong> découpe ou dans le secteur frigorifique.<br />
Sur une usine de 2 500 sa<strong>la</strong>riés, seulement 35<br />
sont à <strong>la</strong> tuerie, les autres travaillent <strong>la</strong> viande.<br />
Mais tous se p<strong>la</strong>ignaient de douleurs aux<br />
épaules, aux muscles. Moi, j’ai été frappée du<br />
fait qu’ils souffraient à l’endroit même où ils<br />
découpaient les bêtes.<br />
Les p<strong>la</strong>intes de ces travailleurs des abattoirs<br />
ont-elles été à l’origine de ce nouveau projet<br />
de film ?<br />
Oui, j’ai été bouleversée de les entendre raconter<br />
ce qu’ils vivaient sur <strong>la</strong> chaîne, je n’imaginais<br />
pas que c’était aussi dur. On prétend qu’il n’y a<br />
plus d’ouvriers en France. En fait, il y en a encore<br />
beaucoup mais pas forcément là où l’on pense.<br />
Ils sont concentrés dans les zones rurales ou à<br />
<strong>la</strong> grande périphérie des zones urbaines. Les<br />
cadences n’ont pas cessé de s’accélérer et le<br />
travail à <strong>la</strong> chaîne, en tout cas dans ce secteur,<br />
est bien pire qu’il n’a jamais été. Une femme<br />
m’a parlé en pleurant d’une calcification à<br />
l’épaule qui l’empêchait de bouger. A son aspect,<br />
je <strong>la</strong> croyais près de <strong>la</strong> retraite, elle n’avait que<br />
40 ans ! En agro-alimentaire, <strong>la</strong> France est le<br />
deuxième exportateur de viande de l’Union européenne,<br />
le troisième du monde. La recherche<br />
de compétitivité sur le marché international<br />
pousse en permanence à l’accélération des<br />
cadences, jusqu’à l’extrême limite. Dès les<br />
premiers entretiens avec les ouvriers, j’ai été<br />
touchée par <strong>la</strong> puissance de résistance de leur<br />
parole. Certes, ils sont enfermés physiquement<br />
et socialement dans cette usine qu’ils ne veulent<br />
pas quitter car chômer serait pire que tout.<br />
Mais ils ne sont pas dans une aliénation qui<br />
ferait d’eux les complices de leurs bourreaux.<br />
Ils sont très conscients de leur situation. Aussi<br />
détruits qu’ils soient, Ils savent bien où ils en<br />
60 images de <strong>la</strong> culture