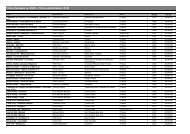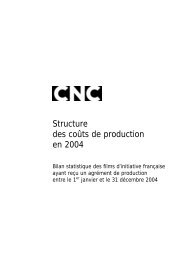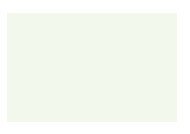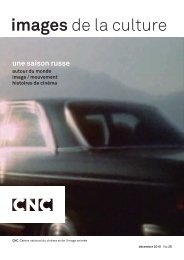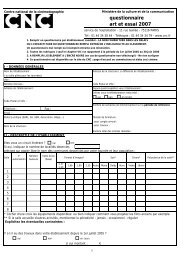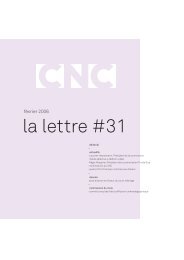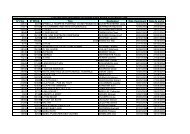télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
par le contraste entre l’impression de bonheur<br />
transmise par les films de famille, et les souffrances<br />
ou les désirs confessés par les personnages.<br />
Les grands discours civilisateurs,<br />
les éloges de <strong>la</strong> compétition et du progrès,<br />
dont l’emblème dans le film sont l’abattage<br />
des arbres, leur découpage en rondins précipités<br />
dans des torrents, puis débités en p<strong>la</strong>nches<br />
prêtes pour l’édification du Nouveau Monde, ces<br />
discours qui justifient toutes les conquêtes,<br />
de celle de l’Ouest à celle de <strong>la</strong> lune, ne trouvent<br />
pas seulement leur contradiction dans les<br />
rires ou les <strong>la</strong>mentations de l’Indien, mais<br />
dans les bizarreries ma<strong>la</strong>dives qui se trament<br />
à l’intérieur de chaque foyer américain.<br />
Les enfants sont nombreux dans Poussières<br />
d’Amérique et il est au moins une histoire de<br />
meurtre d’enfants, par un père qui ne peut<br />
plus subvenir à leurs besoins. Dans une société<br />
qui leur réserve une p<strong>la</strong>ce privilégiée, les enfants<br />
sont l’objet d’un mé<strong>la</strong>nge ambigu d’espoir et<br />
d’envie. Ils sont le pivot de cet idéal qui se<br />
révèle ici sous un jour inquiétant.<br />
Dans Disney<strong>la</strong>nd mon vieux pays natal, Arnaud<br />
des Pallières comparait Disney<strong>la</strong>nd au joueur<br />
de flûte de Hamelin qui fait disparaître tous<br />
les enfants de <strong>la</strong> ville sous un rocher. On ne sait<br />
pas si les enfants sont morts ou s’ils mènent une<br />
vie heureuse dans un autre monde. Cette ambiguïté<br />
du “rêve américain” se retrouve encore dans<br />
Diane Wellington. Lorsque Diane disparaît, les<br />
autres filles de sa c<strong>la</strong>sse plutôt que de s’inquiéter<br />
de son absence se mettent à rêver de ce dont<br />
rêve toute jeune fille de province : elles imaginent<br />
que Diane s’est enfuie avec un homme ou qu’elle<br />
est devenue actrice. Le rêve l’emporte sur <strong>la</strong><br />
réalité, qui finira par se révéler plus terrible,<br />
plus étroite que toute fiction, provoquant <strong>la</strong><br />
longue fugue en train de <strong>la</strong> fin du film, qui est<br />
comme un cri qui monte à travers les paysages<br />
pour éc<strong>la</strong>ter sur le rivage de l’océan.<br />
récits contre fiction<br />
Mais si le rêve, <strong>la</strong> fiction, sont complices de ces<br />
crimes, <strong>la</strong> désillusion n’est-elle pas salutaire ?<br />
Pour chacun de ses films, Arnaud des Pallières<br />
a cherché à inventer des formes de récit qui, tout<br />
en faisant appel aux ressources du cinéma,<br />
empruntent <strong>la</strong>rgement à <strong>la</strong> littérature. Le recours<br />
à <strong>la</strong> voix off comme instance narrative et <strong>la</strong> composition<br />
de récits à partir de citations d’œuvres<br />
littéraires lui sont familiers. Mais plus précisément<br />
qu’à <strong>la</strong> littérature, c’est à “l’art du conteur”<br />
que recourent les films de des Pallières, un art<br />
qui implique à <strong>la</strong> fois l’oralité et une forme particulière<br />
de récit. Dans un essai intitulé Le<br />
Narrateur, Walter Benjamin en a énoncé les<br />
traits distinctifs : entre autres, <strong>la</strong> transmission<br />
d’une expérience, <strong>la</strong> concision et le caractère<br />
énigmatique des récits qui restent ouverts à<br />
l’interprétation. Le conte de fées, “le premier<br />
conseiller de l’enfance”, n’est qu’une des facettes<br />
de cet art, qui invite le petit auditeur à trouver<br />
son chemin dans <strong>la</strong> forêt de l’existence.<br />
Dans Disney<strong>la</strong>nd mon vieux pays natal, Arnaud<br />
des Pallières avait déjà construit une séquence<br />
autour d’un de ces récits dont Walter Benjamin<br />
s’est fait le narrateur : Le Mouchoir, extrait de<br />
son recueil de nouvelles, Rastelli raconte… Si<br />
certaines de ces caractéristiques du conte se<br />
retrouvent dans les récits de Poussières d’Amérique<br />
et de Diane Wellington, <strong>la</strong> valeur initiatique<br />
du conte de fées semble <strong>la</strong>isser entièrement <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>ce à une sombre perversité. Ces récits sont<br />
des “contes cruels”, trop ancrés dans <strong>la</strong> banalité<br />
du quotidien pour accéder à <strong>la</strong> dimension de tragédies.<br />
Plutôt que d’acheminer les personnages<br />
vers <strong>la</strong> maturité, ils les confrontent à de terribles<br />
impasses. Mais peut-être est-ce <strong>la</strong> nature des<br />
contes modernes, ceux d’un monde déserté par<br />
les fées, et les dangers qu’ils exposent ne sont<br />
pas moins riches d’enseignements.<br />
D’un point de vue cinématographique, l’intrusion<br />
de cette forme de narration dans le montage<br />
du film donne libre cours à <strong>la</strong> puissance métaphorique<br />
de <strong>la</strong> parole, à <strong>la</strong> faculté de <strong>la</strong> voix de<br />
projeter un récit parmi des images qui ne le<br />
représentent pas. Avec <strong>la</strong> seule réserve que <strong>la</strong><br />
parole est ici donnée à lire et non à entendre.<br />
Diane Wellington est construit à partir d’images<br />
d’archives des années 1930-1940 (peut-être<br />
un peu plus anciennes pour certaines), tournées<br />
essentiellement dans les rues d’une petite<br />
ville des Etats-Unis. L’action se déroule dans le<br />
Dakota du Sud, dans un environnement rural.<br />
Les hivers y sont rudes. Si l’on ne peut s’empêcher<br />
de penser aux Raisins de <strong>la</strong> colère de John Ford,<br />
ces images anonymes évoquent plus directement<br />
les photographies prises par Walker Evans<br />
ou Ben Shahn dans le cadre de <strong>la</strong> FSA (Farm<br />
Security Administration), organisation constituée<br />
par Roosevelt pour remédier aux désastres<br />
de <strong>la</strong> Grande Dépression. Loin de <strong>la</strong> plénitude<br />
et de <strong>la</strong> lisibilité des images d’Hollywood, ces<br />
A voir<br />
cnc.fr/idc :<br />
Portrait incomplet de Gertrude Stein<br />
(coll. Un Siècle d’écrivains),<br />
d’Arnaud des Pallières, 1999, 46'.<br />
sylvainmaestraggi.com<br />
Diane Wellington<br />
2010, 16', couleur, fiction<br />
réalisation : Arnaud des Pallières<br />
production : Les Films Hatari, Arte France,<br />
Ciné Cinéma, Le Fresnoy/Studio national<br />
des arts contemporains<br />
participation : <strong>CNC</strong>, ministère de <strong>la</strong> Culture<br />
et de <strong>la</strong> Communication (Cnap)<br />
A travers l’adaptation d’un court récit soumis<br />
à Paul Auster par Nancy Peavy, South Dakota,<br />
c’est à une ode au cinéma muet qu’Arnaud<br />
des Pallières semble ici nous convier.<br />
Montage d’archives comme sorties<br />
de l’Amérique de Roosevelt, un piano bientôt<br />
remp<strong>la</strong>cé par le bourdon d’une musique<br />
électronique, et, chargés de dérouler l’histoire<br />
de Diane Wellington, des cartons aussi<br />
réguliers que concis.<br />
Diane Wellington semble d’abord user<br />
d’une méthode désormais convenue,<br />
fondée sur un usage disjonctif du montage,<br />
entre une narration écrite (cartons),<br />
des images comme illustratives, sans lien<br />
direct avec ce que le film paraît vouloir<br />
nous raconter, et les enjolivures d’un piano.<br />
La permanence de leur éc<strong>la</strong>tement ouvre<br />
entre eux une béance où s’inscrivent,<br />
par imaginaire, les personnages invisibles<br />
de cette histoire. L’habileté du film<br />
de des Pallières consiste néanmoins<br />
à démultiplier cette béance, à surmonter<br />
cette absence figurative d’une absence<br />
seconde, celle de Diane Wellington, disparue<br />
un beau jour sans <strong>la</strong>isser d’adresse. Mieux,<br />
à décrire, par le biais de ce redoublement,<br />
<strong>la</strong> mutation qualitative de cette absence,<br />
quand on apprend que cette “désertion” cache<br />
une histoire sordide. De là, sans doute,<br />
que les portraits d’archives fassent p<strong>la</strong>ce<br />
bientôt à des routes qui défilent sans fin :<br />
comme si l’indifférence se changeait<br />
en l’affirmation continuée, effarée,<br />
d’une douleur. M.C.<br />
autour du monde 59