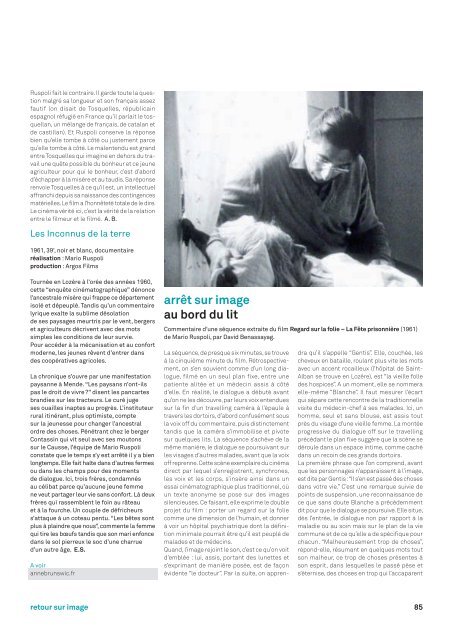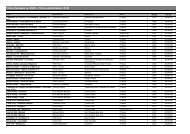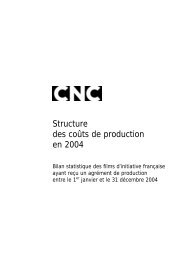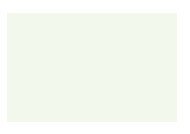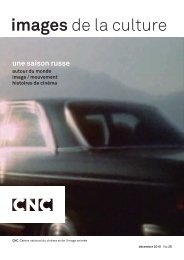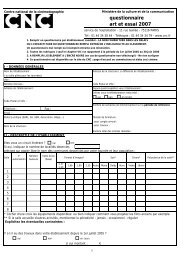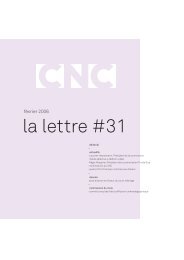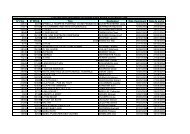télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
télécharger la revue - CNC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ruspoli fait le contraire. Il garde toute <strong>la</strong> question<br />
malgré sa longueur et son français assez<br />
fautif (on disait de Tosquelles, républicain<br />
espagnol réfugié en France qu’il par<strong>la</strong>it le tosquel<strong>la</strong>n,<br />
un mé<strong>la</strong>nge de français, de cata<strong>la</strong>n et<br />
de castil<strong>la</strong>n). Et Ruspoli conserve <strong>la</strong> réponse<br />
bien qu’elle tombe à côté ou justement parce<br />
qu’elle tombe à côté. Le malentendu est grand<br />
entre Tosquelles qui imagine en dehors du travail<br />
une quête possible du bonheur et ce jeune<br />
agriculteur pour qui le bonheur, c’est d’abord<br />
d’échapper à <strong>la</strong> misère et au taudis. Sa réponse<br />
renvoie Tosquelles à ce qu’il est, un intellectuel<br />
affranchi depuis sa naissance des contingences<br />
matérielles. Le film a l’honnêteté totale de le dire.<br />
Le cinéma vérité ici, c’est <strong>la</strong> vérité de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion<br />
entre le filmeur et le filmé. A. B.<br />
Les Inconnus de <strong>la</strong> terre<br />
1961, 39', noir et b<strong>la</strong>nc, documentaire<br />
réalisation : Mario Ruspoli<br />
production : Argos Films<br />
Tournée en Lozère à l’orée des années 1960,<br />
cette “enquête cinématographique” dénonce<br />
l’ancestrale misère qui frappe ce département<br />
isolé et dépeuplé. Tandis qu’un commentaire<br />
lyrique exalte <strong>la</strong> sublime déso<strong>la</strong>tion<br />
de ses paysages meurtris par le vent, bergers<br />
et agriculteurs décrivent avec des mots<br />
simples les conditions de leur survie.<br />
Pour accéder à <strong>la</strong> mécanisation et au confort<br />
moderne, les jeunes rêvent d’entrer dans<br />
des coopératives agricoles.<br />
La chronique s’ouvre par une manifestation<br />
paysanne à Mende. “Les paysans n’ont-ils<br />
pas le droit de vivre ?” disent les pancartes<br />
brandies sur les tracteurs. Le curé juge<br />
ses ouailles inaptes au progrès. L’instituteur<br />
rural itinérant, plus optimiste, compte<br />
sur <strong>la</strong> jeunesse pour changer l’ancestral<br />
ordre des choses. Pénétrant chez le berger<br />
Contassin qui vit seul avec ses moutons<br />
sur le Causse, l’équipe de Mario Ruspoli<br />
constate que le temps s’y est arrêté il y a bien<br />
longtemps. Elle fait halte dans d’autres fermes<br />
ou dans les champs pour des moments<br />
de dialogue. Ici, trois frères, condamnés<br />
au célibat parce qu’aucune jeune femme<br />
ne veut partager leur vie sans confort. Là deux<br />
frères qui rassemblent le foin au râteau<br />
et à <strong>la</strong> fourche. Un couple de défricheurs<br />
s’attaque à un coteau pentu. “Les bêtes sont<br />
plus à p<strong>la</strong>indre que nous”, commente <strong>la</strong> femme<br />
qui tire les bœufs tandis que son mari enfonce<br />
dans le sol pierreux le soc d’une charrue<br />
d’un autre âge. E.S.<br />
A voir<br />
annebrunswic.fr<br />
arrêt sur image<br />
au bord du lit<br />
Commentaire d’une séquence extraite du film Regard sur <strong>la</strong> folie – La Fête prisonnière (1961)<br />
de Mario Ruspoli, par David Benassayag.<br />
La séquence, de presque six minutes, se trouve<br />
à <strong>la</strong> cinquième minute du film. Rétrospectivement,<br />
on s’en souvient comme d’un long dialogue,<br />
filmé en un seul p<strong>la</strong>n fixe, entre une<br />
patiente alitée et un médecin assis à côté<br />
d’elle. En réalité, le dialogue a débuté avant<br />
qu’on ne les découvre, par leurs voix entendues<br />
sur <strong>la</strong> fin d’un travelling caméra à l’épaule à<br />
travers les dortoirs, d’abord confusément sous<br />
<strong>la</strong> voix off du commentaire, puis distinctement<br />
tandis que <strong>la</strong> caméra s’immobilise et pivote<br />
sur quelques lits. La séquence s’achève de <strong>la</strong><br />
même manière, le dialogue se poursuivant sur<br />
les visages d’autres ma<strong>la</strong>des, avant que <strong>la</strong> voix<br />
off reprenne. Cette scène exemp<strong>la</strong>ire du cinéma<br />
direct par lequel s’enregistrent, synchrones,<br />
les voix et les corps, s’insère ainsi dans un<br />
essai cinématographique plus traditionnel, où<br />
un texte anonyme se pose sur des images<br />
silencieuses. Ce faisant, elle exprime le double<br />
projet du film : porter un regard sur <strong>la</strong> folie<br />
comme une dimension de l’humain, et donner<br />
à voir un hôpital psychiatrique dont <strong>la</strong> définition<br />
minimale pourrait être qu’il est peuplé de<br />
ma<strong>la</strong>des et de médecins.<br />
Quand, l’image rejoint le son, c’est ce qu’on voit<br />
d’emblée : lui, assis, portant des lunettes et<br />
s’exprimant de manière posée, est de façon<br />
évidente “le docteur”. Par <strong>la</strong> suite, on appren-<br />
dra qu’il s’appelle “Gentis”. Elle, couchée, les<br />
cheveux en bataille, rou<strong>la</strong>nt plus vite les mots<br />
avec un accent rocailleux (l’hôpital de Saint-<br />
Alban se trouve en Lozère), est “<strong>la</strong> vieille folle<br />
des hospices”. A un moment, elle se nommera<br />
elle-même “B<strong>la</strong>nche”. Il faut mesurer l’écart<br />
qui sépare cette rencontre de <strong>la</strong> traditionnelle<br />
visite du médecin-chef à ses ma<strong>la</strong>des. Ici, un<br />
homme, seul et sans blouse, est assis tout<br />
près du visage d’une vieille femme. La montée<br />
progressive du dialogue off sur le travelling<br />
précédant le p<strong>la</strong>n fixe suggère que <strong>la</strong> scène se<br />
déroule dans un espace intime, comme caché<br />
dans un recoin de ces grands dortoirs.<br />
La première phrase que l’on comprend, avant<br />
que les personnages n’apparaissent à l’image,<br />
est dite par Gentis : “Il s’en est passé des choses<br />
dans votre vie.” C’est une remarque suivie de<br />
points de suspension, une reconnaissance de<br />
ce que sans doute B<strong>la</strong>nche a précédemment<br />
dit pour que le dialogue se poursuive. Elle situe,<br />
dès l’entrée, le dialogue non par rapport à <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die ou au soin mais sur le p<strong>la</strong>n de <strong>la</strong> vie<br />
commune et de ce qu’elle a de spécifique pour<br />
chacun. “Malheureusement trop de choses”,<br />
répond-elle, résumant en quelques mots tout<br />
son malheur, ce trop de choses présentes à<br />
son esprit, dans lesquelles le passé pèse et<br />
s’éternise, des choses en trop qui l’accaparent<br />
retour sur image 85