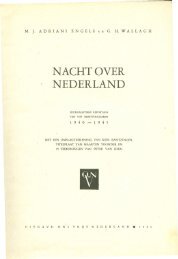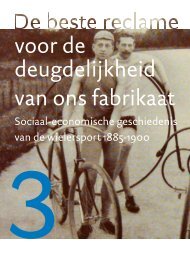Sport et éthique: valeurs et normes - Wielersportboeken
Sport et éthique: valeurs et normes - Wielersportboeken
Sport et éthique: valeurs et normes - Wielersportboeken
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
126<br />
rationnel, développé par Per Hendrik Ling. C<strong>et</strong>te gymnastique se limitait à des mouvements de<br />
développement du corps <strong>et</strong> de normalisation des attitudes. L’objectif premier consistait à<br />
développer le corps au moyen d’exercices rigides <strong>et</strong> imposés. Lorsque l’éducation physique fut<br />
introduite dans nos écoles à la fin du XIX e siècle, il fallut faire un choix entre ces deux courants<br />
rationnels. On trancha finalement en faveur de la gymnastique suédoise. Jusqu’à la fin des années<br />
60, il n’a donc pas été question de viser une approche globale des jeunes pendant les activités<br />
physiques à l’école, <strong>et</strong> encore moins de chercher à former des éléments tels que la dimension affective<br />
du jeune, son évolution ou sa conscience de la norme. Mais dès la première moitié du XX e<br />
siècle, un grand nombre de spécialistes s’opposèrent à c<strong>et</strong>te vision dualiste <strong>et</strong> proposèrent d’envisager<br />
l’activité physique à l’école dans une optique beaucoup plus large. On vit ainsi fleurir une<br />
série de dénominations nouvelles pour désigner ces courants (éducation motrice, enseignement<br />
moteur, formation motrice, psychomotricité, gymnologie, ...).<br />
K. Rijsdorp jugeait par exemple que le mot même "d’éducation physique" portait en lui des traces<br />
de dualisme : “Toute éducation physique doit être une éducation au sens le plus compl<strong>et</strong> du terme.<br />
Cela signifie que toute éducation doit viser l’être humain dans son ensemble. Elle ne peut pas avoir<br />
une orientation exclusivement biologique ou pédagogique. Les deux aspects du problème ont<br />
autant de valeur : un seul ne peut jamais offrir une base suffisante à une éducation physique qui<br />
vise essentiellement son objectif éducatif. La problématique de l’éducation physique est donc de<br />
nature biologico-pédagogique”. Bart Crum, qui est lui aussi l’auteur de plusieurs nouvelles dénominations<br />
de c<strong>et</strong>te discipline (comme la ‘bewegingsagogie’, la ‘bewegingsagogiek’ ou la<br />
‘bewegingsagologie’), s’est opposé à Rijsdorp en insistant sur le fait que le mouvement n’est pas<br />
seulement un moyen didactique visant à atteindre certains objectifs plus globaux, mais que le but<br />
premier est de modifier le comportement moteur de l’enfant. Pour lui, il s’agit donc avant tout de<br />
chercher à influencer intentionnellement la motricité des jeunes <strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre à leur disposition des<br />
moyens pour réguler celle-ci.<br />
Tout ceci montre qu’aux Pays-Bas comme dans d’autres pays, les théoriciens se sont basés sur des<br />
courants philosophiques qui s’intéressaient surtout à la relation homme-monde (réalité),<br />
c’est-à-dire sur les théories phénoménologiques <strong>et</strong> existentialistes. C’est aussi ce qui explique<br />
pourquoi ils ont préféré parler de mouvement <strong>et</strong> de motricité que d’éducation physique, parce que<br />
ces termes expriment mieux le côté intentionnel du comportement <strong>et</strong> donc de l’action.<br />
Mais chez nous, le débat a longtemps fait du sur-place. Après avoir considéré pendant des siècles<br />
le corps comme un obj<strong>et</strong> qu’il fallait avant tout discipliner, endurcir, entraîner, exercer <strong>et</strong> même<br />
dompter, on s’est mis p<strong>et</strong>it à p<strong>et</strong>it à se poser des questions, du côté de la pédagogie, de<br />
l’orthopédagogie, de la psychologie du développement <strong>et</strong> de la sociologie, sur l’importance de la<br />
formation physique dans le développement global du jeune. Ce n’est que vers la fin des années 60<br />
qu’on a commencé à se détourner d’une gymnastique qui était surtout une affaire de ligaments, de<br />
tendons <strong>et</strong> de muscles, <strong>et</strong> ce avec l’ouvrage de Jean Le Boulch : "L’Education par le mouvement".<br />
C<strong>et</strong> intitulé avait déjà été utilisé en 1941 par K. Rijsdorp, qui voulait ainsi s’opposer aux<br />
variations mécaniques <strong>et</strong> artificielles qui, à son avis, déterminaient beaucoup trop le contenu de<br />
l’éducation physique.<br />
N’ignorant certainement pas les méthodes de rééducation psychomotrices (Borel, Maisony, Ramain,<br />
Pieg <strong>et</strong> Vayer, ...), influencé par des phénoménologues (Buytendyck, Merleau-Ponty) <strong>et</strong> dans le<br />
sillage de la psychologie du développement de Piag<strong>et</strong>, Le Bouch est parti de l’idée qu’il fallait<br />
s’intéresser à la relation entre les aspects moteurs, cognitifs <strong>et</strong> émotionnels du comportement.