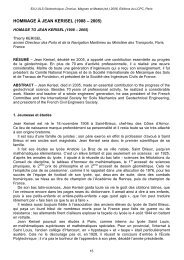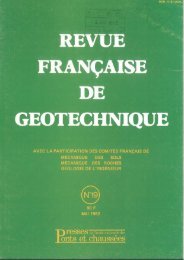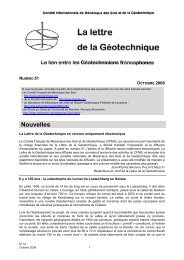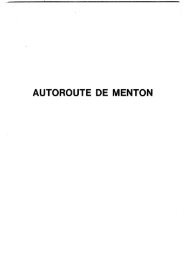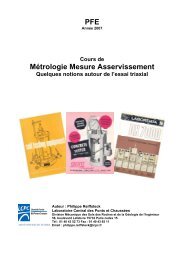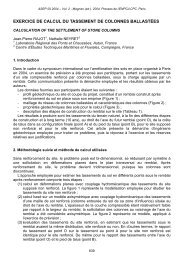Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hauteur (m)<br />
CONSTATATIONS<br />
En cours de réalisation de l'ouvrage expérimental, la<br />
vitesse d'avancement <strong>des</strong> travaux a été très variable en<br />
fonction <strong>des</strong> conditions météorologiques : la première<br />
tranche de remblai, de un mètre d'épaisseur, a été mise en<br />
place entre le 10 décembre 1968 <strong>et</strong> le 2 janvier 1969. La<br />
deuxième tranche de chargement, portant l'épaisseur à 2<br />
ou 2,50 m suivant les points, a été mise en place entre le<br />
27 décembre 1968 <strong>et</strong> le 14 janvier 1969. Le chargement<br />
suivant, portant la hauteur totale du remblai mis en place à<br />
3 ou 3,30 m a été effectué du 13 au 15 janvier 1969. Ce<br />
chargement a été interrompu dès l'apparition de la<br />
deuxième rupture, ce qui explique que <strong>des</strong> niveaux différents<br />
de chargement aient été obtenus sur les diverses<br />
parties de la plate-forme.<br />
La première rupture s'est produite le 15 janvier 1969 à<br />
14 h 15, suivant la direction AA' précisée sur la figure 5 b.<br />
La figure 5 a montre une photographie du chantier après<br />
les deux ruptures constatées.<br />
Le mécanisme de la rupture peut être décomposé chronologiquement<br />
de la façon suivante :<br />
— un effondrement instantané de la plate-forme de remblai<br />
sur 40 à 50 cm de hauteur, sans observation corrélative<br />
d'une remontée de niveau du terrain naturel (pas de<br />
formation de bourrel<strong>et</strong>). Après c<strong>et</strong> effondrement, il n'y a<br />
pas eu de mouvement apparent pendant 10 mn environ;<br />
— un mouvement de rotation de l'ensemble plate-forme<br />
effondrée <strong>et</strong> sols compressibles apparaît ensuite. Ce mouvement<br />
de rupture circulaire s'effectue à vitesse relativement<br />
rapide (visible à l'œil) pendant 15 mn environ. En fin<br />
de mouvement, la surface de cisaillement visible dans le<br />
corps de remblai (c'est-à-dire la hauteur de l'affaissement<br />
du remblai) atteint une hauteur égale à 1,50 m. Le déplacement<br />
<strong>des</strong> sols, le long de la surface de rupture, se faisant<br />
donc à une vitesse voisine de 7 cm/mn environ (14 fois<br />
plus vite que dans les essais dits « rapi<strong>des</strong> » de cisaillement<br />
direct en laboratoire).<br />
Les profils relevés aux différentes dates sont présentés<br />
sur la figure 6.<br />
La deuxième rupture, figure 7, s'est produite le 16 janvier<br />
1969 à 11 h 45 suivant l'axe AB, perpendiculaire à l'axe<br />
148<br />
Fig. 8. — Cercle de rupture<br />
sur l'axe AB.<br />
A A' précédemment défini (donc sur une autre face du<br />
remblai). Dans c<strong>et</strong>te rupture, le mouvement est beaucoup<br />
plus continu, <strong>et</strong> correspond du début à la fin à un<br />
glissement circulaire progressif (fig. 8) :<br />
— à 11 h 45, légère remontée du terrain naturel <strong>et</strong><br />
ouverture d'une fissure dans le corps de remblai. Les<br />
déplacements mesurés au tassomètre T5 sont voisins de<br />
1 cm pour 5 à 10 mn;<br />
— jusqu'à 15 h, le mouvement continue à vitesse lente;<br />
— après 15 h, la vitesse est plus importante, visible à<br />
l'œil, mais les lectures au tassomètre ne sont pas réalisables<br />
à cause de l'importance <strong>des</strong> déformations déjà<br />
observées (bourrel<strong>et</strong> de 0,80 m environ);<br />
— après 15 h 30, le mouvement se poursuit à vitesse plus<br />
lente : 10 cm d'affaissement en 1 h 30 mn (début de<br />
stabilisation).<br />
CONCLUSION<br />
Les ruptures se sont produites pour <strong>des</strong> hauteurs de<br />
remblai variant entre 3 <strong>et</strong> 3,30 m, c'est-à-dire pour <strong>des</strong><br />
coefficients de sécurité « calculés » voisins de 1,20 à 1,30,<br />
<strong>et</strong> ceci malgré toutes les précautions prises à l'époque en<br />
cours d'étude.<br />
Le fait beaucoup plus intéressant, est que le mécanisme de<br />
la rupture n'est pas forcément toujours celui que l'on<br />
adm<strong>et</strong> au niveau <strong>des</strong> calculs :<br />
— la rupture a bien été intégralement de type « circulaire »<br />
dans le cas de la deuxième observation, <strong>et</strong> s'est localisée<br />
dans la zone <strong>des</strong> faibles valeurs de cohésion. On a montré<br />
depuis (cf. article de G. Pilot dans c<strong>et</strong> ouvrage) qu'il<br />
faudrait introduire un coefficient réducteur tenant compte<br />
notamment de la plasticité <strong>des</strong> sols;<br />
— en revanche il n'en a pas été de même pour la première<br />
rupture : l'effondrement brusque de toute une partie de la<br />
plate-forme sans qu'apparaisse parallèlement de soulèvement<br />
(visuellement détectable) en pied, montre que le<br />
phénomène de la rupture (sur <strong>des</strong> sols du type de ceux<br />
rencontrés dans les marais de la Dordogne) tient peut-être<br />
autant du poinçonnement par fluage que du glissement.