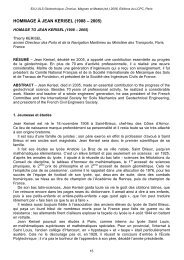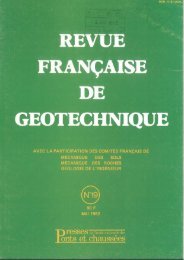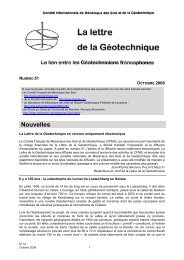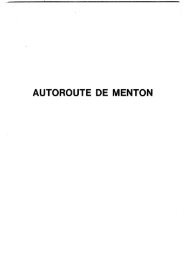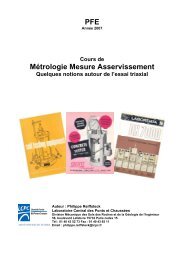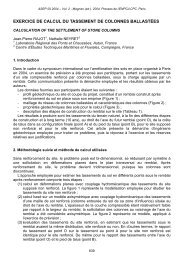Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 1 I' 1<br />
•• .<br />
ir -<br />
i; - ' '.'<br />
: :<br />
W y.:- :<br />
11 : ; :.•<br />
1<br />
.v.v.v;'/<br />
hi<br />
h2<br />
ii<br />
: r-~- /<br />
H 1<br />
r<br />
h2 t i h<br />
b) Variation de la charge<br />
a) Implantation. en fonction de la profondeur.<br />
Fig. 4. — Schéma de deux aquifères superposés.<br />
k, e, R désignant respectivement la perméabilité, l'épaisseur,<br />
le rayon d'action d'un puits de l'aquifère 1 ou 2 selon<br />
l'indice. Généralement on peut supposer R,=Ri, <strong>et</strong> l'on<br />
obtient :<br />
h =<br />
r, + T :<br />
T=ke : transmissivité de l'aquifère.<br />
C<strong>et</strong>te formule montre en particulier que si l'un <strong>des</strong> deux<br />
aquifères est beaucoup plus puissant que l'autre (très forte<br />
transmissivité), le niveau de stabilisation est très voisin de<br />
celui de c<strong>et</strong> aquifère. Dans ces conditions, on risque de<br />
négliger le deuxième pendant la reconnaissance. Dans le<br />
niveau argileux, la charge varie régulièrement avec la<br />
profondeur (tout au moins, si les aquifères sont en<br />
équilibre). La charge en un point M, situé à une distance x<br />
du premier aquifère, sera en première approximation, si e<br />
est l'épaisseur du niveau argileux :<br />
h (M) = h, + (h,-h2)--•<br />
Il existe un cas où l'hétérogénéité verticale présente un<br />
grand risque, c'est celui où la perméabilité <strong>des</strong> terrains<br />
croît avec la profondeur. Dans le cas d'une tranchée, il<br />
apparaît alors <strong>des</strong> écoulements verticaux ascendants, en<br />
pied de <strong>talus</strong>, très défavorables pour la stabilité (possibilité<br />
de renard sur la plate-forme). C'est par exemple<br />
le cas de la tranchée du Tronchon (cf. l'article de<br />
I.-P. Goss<strong>et</strong> <strong>et</strong> I.-P. Khizardjian, étude de la tranchée<br />
d'essai du Tronchon, dans c<strong>et</strong> ouvrage).<br />
Anisotropie<br />
Le comportement hydraulique <strong>des</strong> sols est très rarement<br />
isotrope; du fait de leur condition de dépôts, ils présentent<br />
généralement une très forte anisotropie, la perméabilité<br />
verticale étant beaucoup plus faible que la perméabilité<br />
horizontale. Les loess <strong>et</strong> lehm font exception à c<strong>et</strong>te règle.<br />
Dans le cas général, l'anisotropie relève le niveau piézométrique<br />
<strong>et</strong> ainsi augmente les pressions interstitielles. La<br />
figure 5 montre que pour un rapport égal à 9, la surface<br />
piézométrique est plus voisine de celle obtenue dans un<br />
milieu à perméabilité verticale nulle, que de celle du milieu<br />
isotrope. C<strong>et</strong>te constatation justifie en particulier le choix<br />
de la répartition <strong>des</strong> pressions interstitielles que l'on fait<br />
pour les calculs de stabilité <strong>des</strong> pentes.<br />
L'anisotropie rend le drainage <strong>des</strong> terrains beaucoup plus<br />
difficile, puisqu'il est nécessaire de recouper toute l'épais-<br />
Fig. 5. — Eff<strong>et</strong> de l'anisotropie sur la position de la surface libre.<br />
Écoulement à travers une digue perméable.<br />
seur d'une nappe pour la rabattre d'une manière homogène.<br />
Alimentation<br />
C'est une condition aux limites pour tout calcul de système<br />
drainant <strong>et</strong> à ce titre elle est primordiale.<br />
On peut définir schématiquement deux types d'alimentation<br />
qui peuvent d'ailleurs être combinés : l'infiltration <strong>et</strong><br />
l'alimentation arrière, par un réservoir important. On peut<br />
les distinguer relativement facilement par la réaction <strong>des</strong><br />
piézomètres aux pluies.<br />
Pour une alimentation lointaine, le problème du drainage<br />
sera de choisir le rayon d'action du système <strong>et</strong> la hauteur<br />
<strong>des</strong> plus hautes eaux à ce niveau. L'étude du rabattement<br />
se fera alors en régime permanent. Le choix du rayon<br />
d'action se fait généralement par approximations successives,<br />
en tenant compte :<br />
— du débit réduit de la nappe Q/k, qui est donné par la<br />
carte piézométrique (Q/k = Hi (H épaisseur de la nappe, ('<br />
gradient hydraulique). C<strong>et</strong>te valeur ne varie pas;<br />
— on étudie, pour diverses valeurs de R la surface<br />
piézométrique <strong>et</strong> la valeur du débit recueilli par le système<br />
drainant. La valeur choisie est celle qui donne pour débit<br />
Q/k.<br />
Il faut noter que le rayon d'action augmente quand le débit<br />
de la nappe diminue. Si <strong>des</strong> répercussions sur <strong>des</strong> puits<br />
sont à craindre, l'étude du rayon d'action doit se faire aux<br />
plus basses eaux de la nappe.<br />
Pour l'infiltration, il s'agira d'éviter que le niveau de la<br />
nappe dépasse une certaine cote. L'étude doit se faire en<br />
régime transitoire, en faisant intervenir le coefficient<br />
d'emmagasinement du sol. Il faut penser aussi que l'infiltration<br />
peut être limitée par <strong>des</strong> travaux relativement peu<br />
153