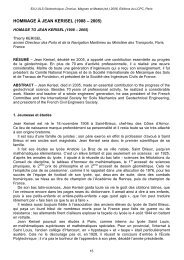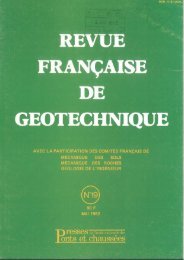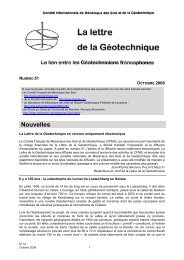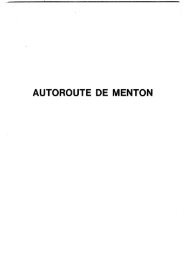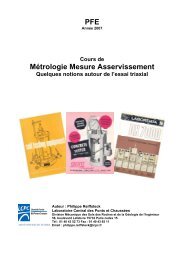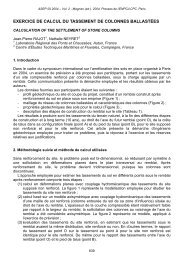Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
m (NGF)<br />
Lobe <strong>des</strong><br />
pressions<br />
interstitielles<br />
Fig. 15 a.<br />
Réseau d'écoulement<br />
aux profils 1 <strong>et</strong> II.<br />
Régime transitoire<br />
L'ensemble <strong>des</strong> son<strong>des</strong> accuse une baisse notable de<br />
pression interstitielle pendant les terrassements. On note<br />
en particulier le passage dans la tourbe, à un mètre de<br />
profondeur, aux environs du 25-26 mars, qui se traduit<br />
surtout sur les son<strong>des</strong> supérieures par une chute brutale de<br />
la pression interstitielle, d'environ un mètre. Cela correspond<br />
au fait que la couche de tourbe, très perméable,<br />
constitue la zone d'alimentation supérieure du massif. Le<br />
pompage dans la fouille y ayant pratiquement annulé les<br />
pressions interstitielles, les conditions aux limites varient<br />
brusquement.<br />
Il y a bon accord de comportement entre les son<strong>des</strong><br />
situées «à l'extérieur» de la zone de rupture (16-1 <strong>et</strong><br />
I 11-1,1 8-3 <strong>et</strong> I 13-3.19-1,1 9-2 <strong>et</strong> I 14-1,1 14-2) (fig. 14).<br />
En revanche, on note une certaine discordance de mesures<br />
entre les son<strong>des</strong> proches du parement du <strong>talus</strong> qui sont<br />
plus directement sensibles aux variations de la surface<br />
libre. Les mesures effectuées en juin <strong>et</strong> juill<strong>et</strong> ne font pas<br />
ressortir de modification sensible du régime de pressions<br />
interstitielles par rapport au régime de mi-avril, au<br />
moment de la rupture; hormis une légère remontée, de<br />
l'ordre de 0,50 m sur certaines son<strong>des</strong>, sans que cela soit<br />
ni n<strong>et</strong>, ni général. Cela laisserait entendre que le drainage<br />
suit immédiatement le rythme <strong>des</strong> terrassements <strong>et</strong> que le<br />
relâchement <strong>des</strong> contraintes totales dû à l'excavation, ne<br />
se traduit pas par une variation sensible de pression<br />
interstitielle par rapport à l'écoulement permanent.<br />
La précision <strong>des</strong> mesures <strong>et</strong> l'intervalle séparant deux<br />
mesures consécutives ne perm<strong>et</strong>tent pas de constater de<br />
variation sensible de la pression interstitielle au moment<br />
de la rupture (nuit du 15 au 16 avril 1972). Il est fort<br />
possible que le cisaillement brutal qui se produit induise<br />
<strong>des</strong> surpressions importantes entre deux mesures, la dissipation<br />
se faisant dans la surface de rupture qui constitue<br />
une zone perméable.<br />
m I<br />
2,0<br />
Fig. 14. — Réseau<br />
d'écoulement général<br />
au moment de la rupture.<br />
Fig. 15*.<br />
Réseau d'écoulement<br />
au profil III.<br />
On a représenté sur la figure 14 les charges hydrauliques<br />
mesurées au moment de la rupture ainsi que les équipotentielles<br />
correspondantes. Du fait de la perméabilité de la<br />
tourbe, le rabattement en surface est important <strong>et</strong> le<br />
«rayon d'action» de la fouille est de l'ordre de 40 m. La<br />
dissymétrie <strong>des</strong> équipotentielles apparaît n<strong>et</strong>tement entre<br />
les deux côtés.<br />
Deux modèles d'analogie électrique ont été exécutés en<br />
simulation de sol homogène, avec conditions aux limites<br />
respectivement à 10 <strong>et</strong> 30 m <strong>des</strong> bords de fouille. L'allure<br />
<strong>des</strong> équipotentielles est beaucoup moins distordue que<br />
d'après les mesures en place, ce qui laisse penser que la<br />
zone plus perméable comprise entre 6 <strong>et</strong> 7 m de profondeur<br />
(cote -4 à -5NGF) joue un rôle non négligeable<br />
dans l'évolution <strong>des</strong> pressions interstitielles.<br />
La figure 15 a présente le lobe <strong>des</strong> pressions interstitielles<br />
agissant le long de la surface de rupture observée, interpolées<br />
à partir du réseau d'équipotentielles. Vis-à-vis de la<br />
stabilité, ce lobe est équivalent à celui que donnerait une<br />
nappe fictive suintant à la cote -0,75 m NGF, c'est-à-dire<br />
plus haut que ce que donne la surface libre déduite <strong>des</strong><br />
mesures. Cela vient du fort potentiel mesuré en 17-1<br />
(H= +0,60 NGF).<br />
La figure 15 ft donne le réseau similaire pour le profil III.<br />
EXPLOITATION : ANALYSE DE STABILITÉ<br />
Éléments géotechniques<br />
Les essais d'identification <strong>et</strong> les essais scissométriques de<br />
chantier, font ressortir l'existence de trois couches aux<br />
caractéristiques légèrement différentes (tableau III).<br />
La fouille étant à 4 m de profondeur au moment de la<br />
67