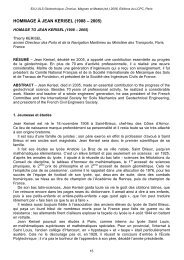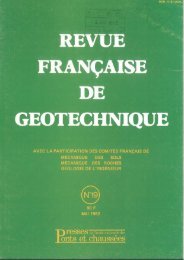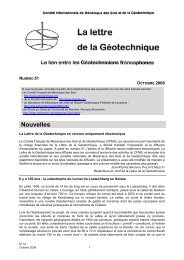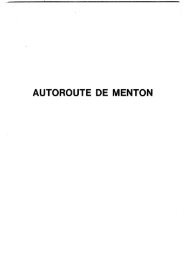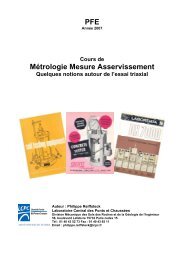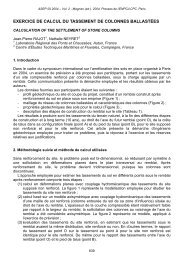Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>et</strong> indéformable, trois points de mesure suffisent pour<br />
déterminer les déplacements d'ensemble du solide.<br />
Cependant, une certaine redondance d'informations n'est<br />
pas inutile. De plus les masses rocheuses sont rarement<br />
monolithiques <strong>et</strong> indéformables, <strong>et</strong> le dispositif de mesures<br />
doit tenir compte de l'analyse structurale <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
déplacements possibles au niveau <strong>des</strong> discontinuités.<br />
Les mesures doivent avoir une précision de l'ordre du<br />
millimètre <strong>et</strong> surtout être faibles dans le temps. Les<br />
mesures de déplacement doivent être accompagnées de<br />
l'enregistrement de la température de manière à m<strong>et</strong>tre en<br />
évidence l'influence <strong>des</strong> variations thermiques sur les<br />
mesures <strong>et</strong> les déplacements. En eff<strong>et</strong>, en cas de baisse de<br />
température les parties superficielles se refroidissent plus<br />
rapidement que la masse de la falaise <strong>et</strong>, par conséquent,<br />
se contractent plus, ce qui entraîne une ouverture <strong>des</strong><br />
fissures. Ce mouvement d'ouverture n'est d'ailleurs que<br />
très partiellement réversible pendant le réchauffement car<br />
il y a toujours <strong>des</strong> phénomènes de coins qui s'opposent à<br />
la ferm<strong>et</strong>ure <strong>des</strong> fractures. Il en résulte d'ailleurs <strong>des</strong><br />
contraintes internes qui sont théoriquement susceptibles<br />
d'aggraver la situation.<br />
Un soin particulier doit être apporté au dispositif de<br />
mesures en tenant compte <strong>des</strong> contraintes diverses<br />
(précision, accessibilité <strong>des</strong> points de mesures, <strong>et</strong>c.) <strong>et</strong> en<br />
considérant les diverses hypothèses plausibles de mouvement<br />
d'ensemble <strong>et</strong> de déformations internes de la masse.<br />
Des métho<strong>des</strong> de télémesure <strong>et</strong> d'enregistrement automatique<br />
sont en cours d'élaboration <strong>et</strong> leur utilisation doit se<br />
développer.<br />
Des métho<strong>des</strong> d'auscultation indirectes ont été envisagées.<br />
Près de la rupture on a observé dans un certain<br />
nombre de cas une chute très sensible de la vitesse de<br />
propagation <strong>des</strong> on<strong>des</strong>, liée à l'ouverture <strong>et</strong> à la propagation<br />
<strong>des</strong> fissures. De même les microruptures qui précèdent<br />
l'écroulement s'accompagnent d'une émission de<br />
microbruits dont l'intensité <strong>et</strong> le nombre vont en croissant.<br />
Des dispositifs sismoacoustiques perm<strong>et</strong>tent l'enregistrement<br />
<strong>des</strong> microbruits dans une gamme de fréquences<br />
adéquate. La fiabilité de ces différentes métho<strong>des</strong> est<br />
cependant suj<strong>et</strong>te à caution.<br />
En présence d'un éboulement qui paraît probable à brève<br />
échéance <strong>et</strong> qui menace <strong>des</strong> habitations ou <strong>des</strong> voies de<br />
communication, trois situations peuvent être envisagées :<br />
— stabiliser la masse rocheuse par <strong>des</strong> soutènements ou<br />
<strong>des</strong> tirants. La mise en œuvre de tels procédés se révèle<br />
souvent inadmissible sur le plan financier car l'accès <strong>des</strong><br />
zones à consolider <strong>et</strong> la réalisation <strong>des</strong> travaux sont<br />
particulièrement difficiles;<br />
— implanter <strong>des</strong> dispositifs de protection perm<strong>et</strong>tant<br />
d'arrêter les blocs avant qu'ils n'atteignent la zone à<br />
protéger. La conception de ces dispositifs est très voisine<br />
de celle <strong>des</strong> paravalanches;<br />
— purger la masse instable. Lorsque la masse est impor<br />
tante, la purge se fait par un abattage à l'explosif. Il s'agit<br />
d'une opération délicate dont la réalisation doit être<br />
soigneusement étudiée, le choix du plan de tir doit tenir<br />
compte non seulement du désir d'obtenir une bonne<br />
fragmentation, mais aussi de la nécessité de pouvoir faire<br />
la foration <strong>des</strong> trous de mine dans <strong>des</strong> conditions de<br />
sécurité pour les équipes <strong>et</strong> dans un délai relativement<br />
bref. Toutes les précautions nécessaires (évacuation,<br />
interdiction de circulation, <strong>et</strong>c.) peuvent être prises au<br />
moment du tir, c<strong>et</strong>te dernière méthode présente donc <strong>des</strong><br />
avantages indiscutables. Cependant, comme pour tous les<br />
travaux de purge, il faut bien s'assurer que la situation<br />
après la purge ne sera pas aussi précaire que la précédente.<br />
On peut citer le cas de la falaise du Chaînon du<br />
180<br />
Cornu<strong>et</strong> qui surplombe la voie ferrée Paris-Rome <strong>et</strong> la<br />
route nationale 491 sur la rive est du lac du Bourg<strong>et</strong> : après<br />
le pétardage <strong>et</strong> la purge d'une masse de 20000 m 3<br />
, il s'est<br />
avéré nécessaire de construire sur une longueur de 75 m<br />
une galerie couverte pour la voie ferrée, <strong>et</strong> une énorme<br />
dalle inclinée en béton s'appuyant sur la galerie <strong>et</strong> protégeant<br />
par un porte-à-faux la route nationale (fig. 17).<br />
La trajectoire <strong>des</strong> blocs au cours d'un éboulement naturel<br />
ou provoqué est très difficile à prévoir. L'observation <strong>des</strong><br />
éboulis naturels montrent en général un étalement sur une<br />
longueur assez faible de la masse éboulée avec un classement<br />
<strong>des</strong> matériaux suivant leur taille, les blocs les plus<br />
gros <strong>et</strong> les plus cubiques ayant la trajectoire la plus longue.<br />
Dans la plupart <strong>des</strong> cas, il semble qu'une partie très<br />
importante de l'énergie cinétique acquise au cours de la<br />
chute se dissipe à l'impact. On peut cependant observer<br />
<strong>des</strong> blocs isolés qui ont pu franchir <strong>des</strong> distances parfois<br />
considérables en provoquant <strong>des</strong> saignées spectaculaires.<br />
Une étude <strong>des</strong> trajectoires <strong>des</strong> blocs paraît nécessaire afin<br />
de mieux dimensionner les ouvrages de protection.<br />
Fig. 17. — Ouvrage de protection de la voie ferrée Paris-Rome <strong>et</strong><br />
de la RN491 sur la rive est du lac du Bourg<strong>et</strong>.<br />
ÉTUDE DES GLISSEMENTS DE MASSES ROCHEUSES<br />
Le glissement <strong>des</strong> masses rocheuses se produit très généralement<br />
sur <strong>des</strong> surfaces de discontinuité préexistantes<br />
approximativement planes.<br />
Dans les massifs stratifiés, les glissements banc sur banc<br />
sont fréquents. Les massifs calcaires présentent souvent<br />
un versant à peu près conforme à la stratification. Les<br />
bancs superficiels, lorsqu'ils ne sont pas butés en pied,<br />
glissent d'autant plus facilement que le joint de stratification<br />
est argileux ou marneux. Le glissement de gran<strong>des</strong><br />
dalles structurales monolithiques est rare. On peut cepen<br />
dant citer le cas du Claps-de-Luc dans la Drôme<br />
•(L. Mor<strong>et</strong>, 1945) qui s'est produit en 1442; la dalle de<br />
calcaire tithonique qui a glissé a donné naissance à un<br />
chaos de blocs impressionnant (fig. 18). Le glissement <strong>des</strong><br />
bancs superficiels diaclasés <strong>et</strong> altérés est plus facile que<br />
celui <strong>des</strong> bancs profonds, plus continus, car la masse<br />
rocheuse s'adapte plus facilement aux irrégularités <strong>des</strong><br />
surfaces structurales. Les terrassements qui entaillent <strong>des</strong><br />
bancs ayant un pendage défavorable orienté vers le déblai<br />
(pendage dit « aval ») risquent toujours de provoquer <strong>des</strong><br />
glissements. Les volumes susceptibles d'être mis en mouvement<br />
sont souvent importants, les travaux de stabilisation<br />
<strong>et</strong> les terrassements supplémentaires qu'ils entraînent<br />
doivent être réalisés dans <strong>des</strong> conditions difficiles <strong>et</strong> sont<br />
donc particulièrement onéreux (fig. 19).