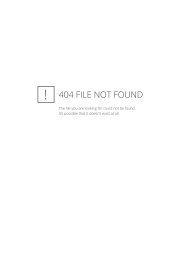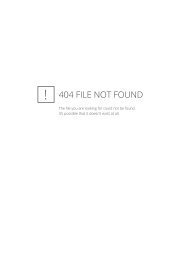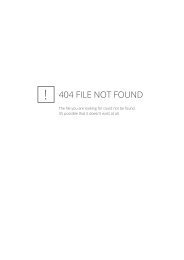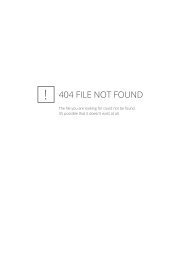colloque sur la prudence. - Académie des sciences morales et ...
colloque sur la prudence. - Académie des sciences morales et ...
colloque sur la prudence. - Académie des sciences morales et ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il faut bien nous situer dans le contexte contemporain : La science<br />
nous a proj<strong>et</strong>és dans une forme d’hybris. En manque de norme nous<br />
demandons à c<strong>et</strong> hybris qu‘il fasse preuve de <strong>prudence</strong> pour nous absoudre<br />
de sa déme<strong>sur</strong>e. Un paradoxe d’hybris qui se voudrait prudent. La juste<br />
me<strong>sur</strong>e aristotélicienne a-t-elle encore un sens si elle doit se me<strong>sur</strong>er dans<br />
l’hybris ? y-a-t-il une juste me<strong>sur</strong>e dans l‘excès? Ou suffit-il de se satisfaire<br />
d‘un mal moindre pour qu‘il devienne un bien en soi ?<br />
Construction de notre représentation du consensus<br />
Dans <strong>la</strong> cité athénienne, Homère nous parle du conseil <strong>des</strong> 500 (le<br />
conseil <strong>des</strong> anciens) <strong>la</strong> boulè qui donna boulèsis (délibération) qu‘Aristote<br />
sera le premier à employer dans un sens technique. Ce Conseil <strong>des</strong> 500, les<br />
sages, les phronimoï (de phronèsis) étaient chargés de préparer par une<br />
délibération préa<strong>la</strong>ble, les décisions de l‘assemblée du peuple. Le conseil<br />
délibérait <strong>et</strong> le peuple choisissait… ou du moins ratifiait <strong>la</strong> pré-décision.<br />
Etait-ce pour rappeler qu‘il n‘y a pas de décisions justes (proaïrésis) sans<br />
délibération préa<strong>la</strong>ble qu‘Aristote évoque <strong>la</strong> pratique homérique ? Rien à voir<br />
avec le choix, <strong>la</strong> décision juste, l‘intention de bien qui doit animer celui qui<br />
choisit <strong>et</strong> qui engage sa liberté, sa responsabilité <strong>et</strong> son mérite.<br />
Calqué <strong>sur</strong> ce schéma organisationnel de <strong>la</strong> décision, le consensus<br />
de <strong>la</strong> république romaine semble avoir été un processus de légitimité<br />
oligarchique basé <strong>sur</strong> <strong>la</strong> <strong>prudence</strong>.<br />
Il existait deux types d‘assemblée popu<strong>la</strong>ire à Rome, les contiones <strong>et</strong><br />
les comices. Les premières étaient informatives <strong>et</strong> servaient à tester l‘opinion<br />
publique, Par suite, les contiones étaient le lieu où les rogatores me<strong>sur</strong>aient<br />
à quel point le peuple était prêt à s‘engager pour une cause ou à faire<br />
obstruction. Au sens littéral, elles étaient le lieu institutionnalisé de <strong>la</strong><br />
me<strong>sur</strong>e de <strong>la</strong> préférence. Les secon<strong>des</strong> (comices), selon qu‘elles étaient<br />
tributes (35 tribus) <strong>la</strong> majorité <strong>des</strong> tribus l‘emportaient, ou centuriates (193<br />
centuries) où les voix <strong>des</strong> citoyens riches pesaient beaucoup plus lourd que<br />
celles <strong>des</strong> autres.<br />
Les comices étaient dirigés par un tribun ou un magistrat qui était<br />
mandaté pour présenter un proj<strong>et</strong> de loi (rogator). L‘assemblée ne pouvait ni<br />
exposer son point de vue, ni proposer <strong>des</strong> amendements ; elle n‘avait le choix<br />
qu‘entre approuver ou refuser.<br />
100