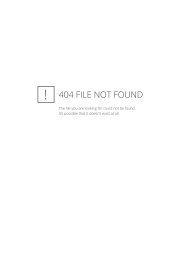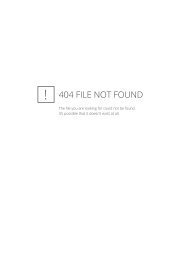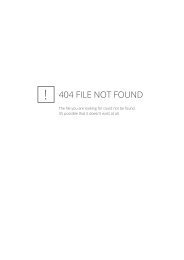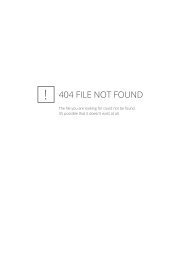colloque sur la prudence. - Académie des sciences morales et ...
colloque sur la prudence. - Académie des sciences morales et ...
colloque sur la prudence. - Académie des sciences morales et ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
subjectif plus qu‘une trace historiographique. Le présent devient événement<br />
dans le sens où le suj<strong>et</strong> sait que, de ce présent dédié à <strong>la</strong> délibération, va<br />
dépendre son histoire.<br />
Prudence, entre éthique <strong>et</strong> politique<br />
La <strong>prudence</strong> dans son acception contemp<strong>la</strong>tive est du même ordre<br />
que le consensus cicéronien quand il dépend de <strong>la</strong> nature seule dans une<br />
harmonie, une sympathie <strong>des</strong> éléments entre eux <strong>et</strong> qui n‘a pas droit de cité<br />
dans les affaires humaines. Elle est aussi en lien avec le consensus dans son<br />
autre acception quand elle devient un moyen au service de l‘homme dans ce<br />
qui lui est utile <strong>et</strong> bon. Ici, <strong>la</strong> <strong>prudence</strong> se situe à <strong>la</strong> limite entre l‘éthique <strong>et</strong> le<br />
politique.<br />
A ce moment, il ne reste qu‘à galvauder l‘utile <strong>et</strong> le bon en termes de<br />
profit pour faire de <strong>la</strong> <strong>prudence</strong>, comme du consensus, <strong>des</strong> frères d‘arme au<br />
service de l‘action politique utilitariste anthropocentrique.<br />
Or, si Aristote dit dans Des parties <strong>des</strong> animaux que « <strong>la</strong> nature tire<br />
le meilleur parti <strong>des</strong> possibles dont elle dispose 233 », il a en vue <strong>des</strong> analogies<br />
humaines <strong>et</strong> s‘il m‘est permis une critique je ferai <strong>la</strong> suivante. Il a, à mon sens,<br />
fait un rapprochement trop rapide car le meilleur <strong>des</strong> possibles dont on<br />
dispose n‘est pas différent pour un homme de ce qui consiste à accéder à un<br />
moindre mal quand l‘action nous presse (un arbre qui pousserait à l‘ombre<br />
d‘un autre tenterait de s‘en écarter autant que faire se peut, dans les limites<br />
du possible : le meilleur du possible dont il dispose, ce qu‘il a sous <strong>la</strong> main.<br />
Ce meilleur là n‘est qu‘un moindre mal car <strong>la</strong> nature n‘a pas d‘autre choix<br />
que ceux dont elle dispose. Elle tire le moins mauvais parti d‘elle-même<br />
parce qu‘elle est contrainte par elle-même, elle ne peut pas s‘affranchir<br />
d‘elle-même. Alors que l‘homme, lui, dans sa boulésis (délibération, va<br />
pouvoir opérer une proaïrésis (capacité à faire <strong>des</strong> choix justes qui procèdent<br />
de c<strong>et</strong>te dernière qui peuvent l‘affranchir de <strong>la</strong> nature <strong>et</strong> c‘est dans c<strong>et</strong>te<br />
acception que les utilitaristes vont s‘engouffrer en occultant <strong>la</strong> pensée<br />
d‘Aristote qui les dérange <strong>et</strong> qui dit que c<strong>et</strong>te proaïrésis est ce qui engage<br />
notre liberté, notre responsabilité <strong>et</strong> notre mérite.<br />
233 Aristote, Des parties <strong>des</strong> animaux, (IV,10,687,a 16), in Pierre Aubenque, La <strong>prudence</strong> chez<br />
Aristote, op. cit. p. 132.<br />
92