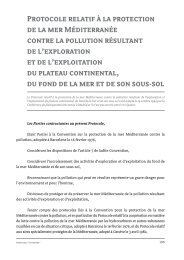dossier sur le tourisme et le développement durable
dossier sur le tourisme et le développement durable
dossier sur le tourisme et le développement durable
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
86<br />
Dimensions politiques<br />
demande en eau. C’est notamment <strong>le</strong> cas en Tunisie, où une politique tarifaire spécifique a<br />
permis de diminuer de manière significative la consommation d’eau potab<strong>le</strong> par lit<br />
touristique, alors que <strong>le</strong> nombre d’arrivées augmentait.<br />
Néanmoins, une tel<strong>le</strong> réorientation ne peut réussir sans un cadre porteur à l’échel<strong>le</strong> des<br />
régions <strong>et</strong> pays.<br />
4.2. Nécessité d’un cadre porteur au niveau national<br />
La mise en œuvre de ces démarches loca<strong>le</strong>s suppose l’existence d’un contexte favorab<strong>le</strong> au<br />
niveau national : textes législatifs, politiques d’investissement, cadre juridique clairement<br />
établi, décentralisation effective, processus de participation abouti, <strong>et</strong>c. Il y a une exigence<br />
de cohérence entre l’État <strong>et</strong> <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s, afin d’appuyer <strong>et</strong> de soutenir<br />
l’émergence de proj<strong>et</strong>s de territoire. L’État doit jouer un rô<strong>le</strong> de facilitateur au niveau local, en<br />
perm<strong>et</strong>tant aux acteurs de travail<strong>le</strong>r ensemb<strong>le</strong> <strong>et</strong> de s’accorder <strong>sur</strong> des thèmes majeurs.<br />
Un cadre porteur se traduit par différentes me<strong>sur</strong>es politiques concernant l’aménagement du<br />
territoire à l’échel<strong>le</strong> nationa<strong>le</strong>, l’aide à l’investissement <strong>et</strong> à la délocalisation <strong>et</strong> <strong>le</strong>s politiques<br />
d’incitation. Il suppose éga<strong>le</strong>ment de m<strong>et</strong>tre en place un dispositif de péréquation entre <strong>le</strong>s<br />
régions, afin de réduire <strong>le</strong>s disparités entre <strong>le</strong>s territoires <strong>et</strong> d’équilibrer <strong>le</strong> processus de<br />
<strong>développement</strong>. L’ensemb<strong>le</strong> des schémas directeurs touchant à l’aménagement du territoire<br />
(plans d’urbanisme, gestion des sols, schémas de transports…) doivent être<br />
complémentaires <strong>et</strong> s’articu<strong>le</strong>r de manière cohérente. Dès lors, la notion de subsidiarité<br />
publique est incontournab<strong>le</strong><br />
La subsidiarité est un principe de répartition des tâches entre l’État <strong>et</strong> la société civi<strong>le</strong> : à<br />
chaque fois que <strong>le</strong> régime de l’association entre individus ou entre groupes suffit à<br />
l’accomplissement d’une tâche déterminée, il doit être préféré à l’intervention directe de<br />
l’Etat. C<strong>et</strong>te notion, à l’inverse de cel<strong>le</strong> de décentralisation, ne renvoie pas à l’organisation<br />
des pouvoirs entre <strong>le</strong>s institutions. El<strong>le</strong> est du domaine de l’action <strong>et</strong> vise à l’amélioration de<br />
l’existant, à partir des ressources disponib<strong>le</strong>s, ainsi qu’au renforcement des capacités. El<strong>le</strong><br />
oblige à répondre à plusieurs questions : quel<strong>le</strong>s ressources ? Quel<strong>le</strong>s modalités d’usages ?<br />
Quel<strong>le</strong>s améliorations <strong>et</strong> quels objectifs ? Quels acteurs <strong>et</strong> quels secteurs mobiliser ? La<br />
subsidiarité est une condition essentiel<strong>le</strong> de l’élaboration d’un cadre porteur national. El<strong>le</strong> est<br />
indissociab<strong>le</strong> de pratiques en réseau, oeuvrant à l’intérêt général, <strong>et</strong> de la création<br />
d’associations travaillant dans un esprit de partage, de mise en commun des connaissances<br />
<strong>et</strong> des compétences.<br />
4.3. La coopération méditerranéenne dans <strong>le</strong> domaine du <strong>tourisme</strong><br />
Par rapport à d’autres domaines, comme la gestion de l’eau, la coopération méditerranéenne<br />
reste peu développée dans <strong>le</strong> secteur du <strong>tourisme</strong>. Il n’existe pas d’organisation commune <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s échanges n’ont généra<strong>le</strong>ment lieu que <strong>sur</strong> des proj<strong>et</strong>s précis, pour une période limitée,<br />
par exemp<strong>le</strong> à l’occasion de proj<strong>et</strong>s financés par l’Union européenne ou d’autres<br />
organisations internationa<strong>le</strong>s.<br />
Plusieurs facteurs ont empêché jusqu’ici c<strong>et</strong>te coopération :<br />
• la faib<strong>le</strong>sse des politiques publiques dans <strong>le</strong> <strong>tourisme</strong>,<br />
• la très forte concurrence que se livrent <strong>le</strong>s destinations <strong>et</strong> <strong>le</strong>s États, <strong>sur</strong> des produits touristiques<br />
similaires,<br />
• l’existence d’autres scènes de coopération pour <strong>le</strong>s États (Union européenne) qui peuvent jouer <strong>le</strong><br />
rô<strong>le</strong> de force centrifuge face à la volonté des acteurs du <strong>tourisme</strong> de se regrouper,<br />
• la persistance de tensions géopolitiques, particulièrement au Proche-Orient.<br />
Pourtant, un réel besoin d’organisation commune se fait sentir <strong>et</strong> la coopération<br />
méditerranéenne dans <strong>le</strong> <strong>tourisme</strong> dispose de plusieurs textes fondateurs. L’Agenda MED 21