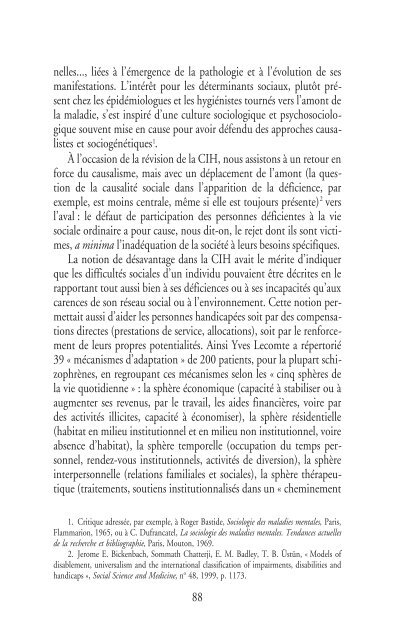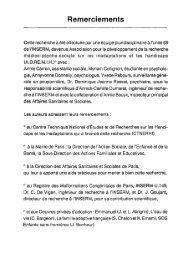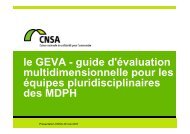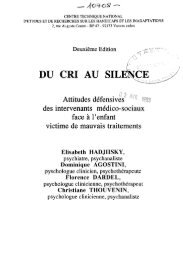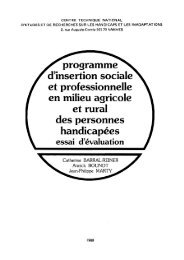classification internationale des handicaps et santé mentale - ctnerhi
classification internationale des handicaps et santé mentale - ctnerhi
classification internationale des handicaps et santé mentale - ctnerhi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
nelles..., liées à l’émergence de la pathologie <strong>et</strong> à l’évolution de ses<br />
manifestations. L’intérêt pour les déterminants sociaux, plutôt présent<br />
chez les épidémiologues <strong>et</strong> les hygiénistes tournés vers l’amont de<br />
la maladie, s’est inspiré d’une culture sociologique <strong>et</strong> psychosociologique<br />
souvent mise en cause pour avoir défendu <strong>des</strong> approches causalistes<br />
<strong>et</strong> sociogénétiques 1 .<br />
À l’occasion de la révision de la CIH, nous assistons à un r<strong>et</strong>our en<br />
force du causalisme, mais avec un déplacement de l’amont (la question<br />
de la causalité sociale dans l’apparition de la déficience, par<br />
exemple, est moins centrale, même si elle est toujours présente) 2 vers<br />
l’aval : le défaut de participation <strong>des</strong> personnes déficientes à la vie<br />
sociale ordinaire a pour cause, nous dit-on, le rej<strong>et</strong> dont ils sont victimes,<br />
a minima l’inadéquation de la société à leurs besoins spécifiques.<br />
La notion de désavantage dans la CIH avait le mérite d’indiquer<br />
que les difficultés sociales d’un individu pouvaient être décrites en le<br />
rapportant tout aussi bien à ses déficiences ou à ses incapacités qu’aux<br />
carences de son réseau social ou à l’environnement. C<strong>et</strong>te notion perm<strong>et</strong>tait<br />
aussi d’aider les personnes handicapées soit par <strong>des</strong> compensations<br />
directes (prestations de service, allocations), soit par le renforcement<br />
de leurs propres potentialités. Ainsi Yves Lecomte a répertorié<br />
39 « mécanismes d’adaptation » de 200 patients, pour la plupart schizophrènes,<br />
en regroupant ces mécanismes selon les « cinq sphères de<br />
la vie quotidienne » : la sphère économique (capacité à stabiliser ou à<br />
augmenter ses revenus, par le travail, les ai<strong>des</strong> financières, voire par<br />
<strong>des</strong> activités illicites, capacité à économiser), la sphère résidentielle<br />
(habitat en milieu institutionnel <strong>et</strong> en milieu non institutionnel, voire<br />
absence d’habitat), la sphère temporelle (occupation du temps personnel,<br />
rendez-vous institutionnels, activités de diversion), la sphère<br />
interpersonnelle (relations familiales <strong>et</strong> sociales), la sphère thérapeutique<br />
(traitements, soutiens institutionnalisés dans un « cheminement<br />
1. Critique adressée, par exemple, à Roger Bastide, Sociologie <strong>des</strong> maladies <strong>mentale</strong>s, Paris,<br />
Flammarion, 1965, ou à C. Dufrancatel, La sociologie <strong>des</strong> maladies <strong>mentale</strong>s. Tendances actuelles<br />
de la recherche <strong>et</strong> bibliographie, Paris, Mouton, 1969.<br />
2. Jerome E. Bickenbach, Sommath Chatterji, E. M. Badley, T. B. Üstün, « Models of<br />
disablement, universalism and the international <strong>classification</strong> of impairments, disabilities and<br />
<strong>handicaps</strong> », Social Science and Medicine, n o 48, 1999, p. 1173.<br />
88