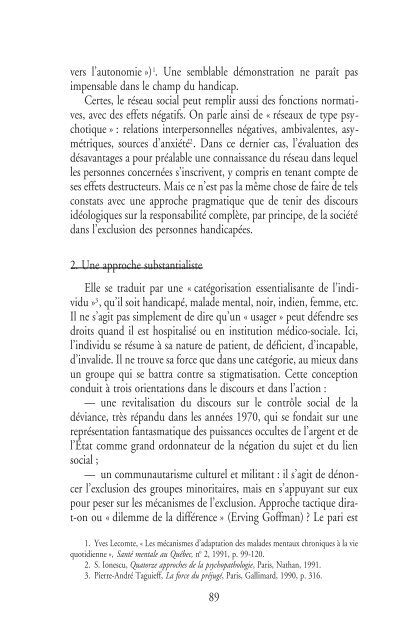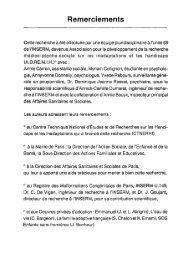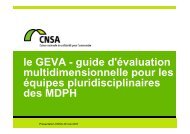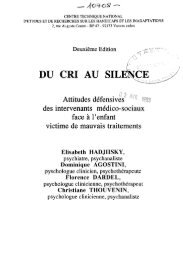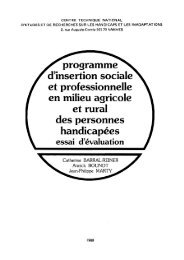classification internationale des handicaps et santé mentale - ctnerhi
classification internationale des handicaps et santé mentale - ctnerhi
classification internationale des handicaps et santé mentale - ctnerhi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
vers l’autonomie ») 1 . Une semblable démonstration ne paraît pas<br />
impensable dans le champ du handicap.<br />
Certes, le réseau social peut remplir aussi <strong>des</strong> fonctions normatives,<br />
avec <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s négatifs. On parle ainsi de « réseaux de type psychotique<br />
» : relations interpersonnelles négatives, ambivalentes, asymétriques,<br />
sources d’anxiété 2 . Dans ce dernier cas, l’évaluation <strong>des</strong><br />
désavantages a pour préalable une connaissance du réseau dans lequel<br />
les personnes concernées s’inscrivent, y compris en tenant compte de<br />
ses eff<strong>et</strong>s <strong>des</strong>tructeurs. Mais ce n’est pas la même chose de faire de tels<br />
constats avec une approche pragmatique que de tenir <strong>des</strong> discours<br />
idéologiques sur la responsabilité complète, par principe, de la société<br />
dans l’exclusion <strong>des</strong> personnes handicapées.<br />
2. Une approche substantialiste<br />
Elle se traduit par une « catégorisation essentialisante de l’individu<br />
» 3 , qu’il soit handicapé, malade mental, noir, indien, femme, <strong>et</strong>c.<br />
Il ne s’agit pas simplement de dire qu’un « usager » peut défendre ses<br />
droits quand il est hospitalisé ou en institution médico-sociale. Ici,<br />
l’individu se résume à sa nature de patient, de déficient, d’incapable,<br />
d’invalide. Il ne trouve sa force que dans une catégorie, au mieux dans<br />
un groupe qui se battra contre sa stigmatisation. C<strong>et</strong>te conception<br />
conduit à trois orientations dans le discours <strong>et</strong> dans l’action :<br />
— une revitalisation du discours sur le contrôle social de la<br />
déviance, très répandu dans les années 1970, qui se fondait sur une<br />
représentation fantasmatique <strong>des</strong> puissances occultes de l’argent <strong>et</strong> de<br />
l’État comme grand ordonnateur de la négation du suj<strong>et</strong> <strong>et</strong> du lien<br />
social ;<br />
— un communautarisme culturel <strong>et</strong> militant : il s’agit de dénoncer<br />
l’exclusion <strong>des</strong> groupes minoritaires, mais en s’appuyant sur eux<br />
pour peser sur les mécanismes de l’exclusion. Approche tactique dirat-on<br />
ou « dilemme de la différence » (Erving Goffman) Le pari est<br />
1. Yves Lecomte, « Les mécanismes d’adaptation <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> mentaux chroniques à la vie<br />
quotidienne », Santé <strong>mentale</strong> au Québec, n o 2, 1991, p. 99-120.<br />
2. S. Ionescu, Quatorze approches de la psychopathologie, Paris, Nathan, 1991.<br />
3. Pierre-André Taguieff, La force du préjugé, Paris, Gallimard, 1990, p. 316.<br />
89