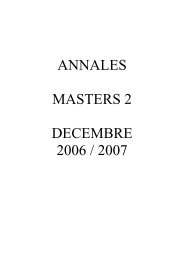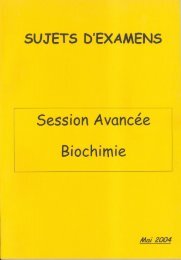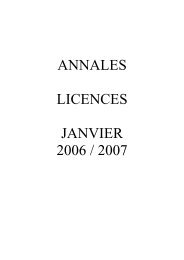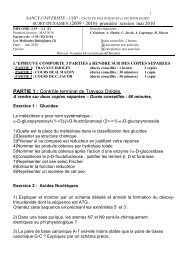Juin 2005
Juin 2005
Juin 2005
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il a fallu attendre la fin des années 1990 pour avoir des données precises et pourqu'émerge, enfin, la question des bas salaires et de la pauvreté laborieuse. Les recherches dePierre Concialdi et Sophie Ponthieux le montrent: en France, désormais, 3,4 millions depersonnes travaillent pour un salaire inférieur au smic mensuel. Parmi elles, 80 % sont desfemmes. Depuis le début des années 1980, les bas salaires (moins de 838 euros par mois) sonten pleine expansion. Ils concernaient 11 % des salarié(e)s en 1983 et 17 % en 2001. Quantaux très bas salaires (moins de 629 euros), leur croissance a été encore plus rapide: de 5 %des salariéee)s en 1983, ils sont passés à 9 % en 2001.Cette forte progression des salaires inférieurs au salaire minimum légal est étroitementliée à la multiplication des emplois à temps partiel, qui touche 80 % de ceux qui ont des bassalaires. Parallèlement à la croissance de ce type d'emploi, on voit donc se profiler unprocessus de paupérisation: le développement d'une frange de salarié(e)s pauvres, c'est-àdirede gens qui ne sont ni chômeurs, ni « exclus », ni « assistés », mais qui travaillent sansparvenir à gagner leur vie.Ces femmes sont, pour la plupart, effacées de la comptabilité officielle des workingpaars français. D'une part, l'Institut national de la statistique et des études économiques(Insee) retient, dans sa définition des travailleurs pauvres, le seuil de 50 % du revenu médian(soit 534 euros en 1996), et n'évalue leur nombre qu'à 1,3 million. D'autre part, enchoisissant de se fonder sur une définition familiale (et non individuelle) des revenus, lesstatistiques officielles trouvent 60 % d'hommes parmi eux.Ce décompte exclut une grande partie des bas salaires engendrés par le sous-emploi. Ilsous-évalue la paupérisation d'une partie du salariat - et notamment du salariat féminin.Pourtant, il faut se rendre à l'évidence: dans notre pays, les salariéee)s pauvres sont plusnombreux que les chômeurs. Il a fallu attendre bien longtemps pour que ces données soientrendues publiques. Il faudra sans doute attendre plus longtemps encore pour qu'ellesapparaissent dans le débat social.S'il ne s'agit pas, tant s'en faut, d'une méconnaissance des faits et des chiffres, l'oublidu sexe de l'emploi qui caractérise la plupart des analyses économiques laisse pantois. Cetteétrange absence interroge: la pauvreté laborieuse serait-elle trop féminisée pour êtrechoquante? Le sous-emploi serait-il moins grave lorsqu'il affecte le deuxième sexe?La France de ce début de XXI' siècle compte 3,4 millions de sous-smicards. Maissilence: ce ne sont pas des travailleurs pauvres. La plupart ne sont que des femmes quis'activent pour un salaire partiel - un salaire d'appoint en quelque sorte... C'est probablementlà qu'il faut chercher l'origine de cette discrétion suspecte: une tolérance sociale qui ne ditpas son nom.Chiffrer le chômage n'est pas chose évidente, mais au moins le sait-on, Le sous-emploiet la pauvreté laborieuse, en revanche, demeurent la face cachée de la crise de l'emploi. Car lechômage, ce n'est pas seulement la privation d'emploi pour un nombre imposant depersonnes. C'est également un moyen de pression sur les conditions de travail et d'emploi detous ceux qui travaillent. C'est au nom du chômage que l'on précarise l'emploi et que l'onrejette certaines catégories de salarié(e)s vers l'inactivité contrainte ou le sous-emploi, quel'on redéfinit les rythmes de travail et que l'on fait accepter des salaires inférieurs auminimum légal.~argaret~aruaniDocuments non autorisésCalculatrice non autorisée