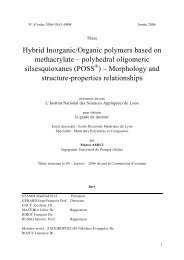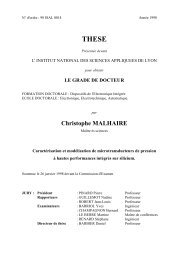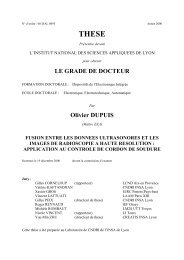Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...
Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...
Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Khalid Lamnawar<br />
INSA de Lyon<br />
3.1.5 Couplage interdiffusion/réaction <strong>aux</strong> <strong>interfaces</strong><br />
Les trav<strong>aux</strong> utilisant l’outil rhéologique pour prévoir <strong>et</strong> quantifier la compétition entre le<br />
processus de migration <strong>des</strong> chaînes (interdiffusion) <strong>et</strong> le processus de réaction chimique <strong>aux</strong><br />
<strong>interfaces</strong> restent limités dans la littérature. Nous citons tout de même le travail récent de A.<br />
Aradian [2001] qui propose un état de l’art théorique, s’inspirant de la dynamique<br />
moléculaire, pour décrire <strong>et</strong> modéliser la coalescence <strong>des</strong> films de latex. Leur modèle<br />
simplifié, traite d’une interface de deux matéri<strong>aux</strong> identiques. Il explique que la mobilité <strong>des</strong><br />
chaînes diminue au détriment de la réaction de réticulation <strong>et</strong> par conséquent fait chuter<br />
l’interdiffusion, cʹest‐à‐dire la coalescence <strong>des</strong> latex.<br />
Concept diffusion/réaction interfaciale<br />
S’appuyant sur l’analyse initiale de De Gennes, O’Shaughnessy <strong>et</strong> ses collaborateurs [1994,<br />
1996, 1999] ont, au cours de la dernière décennie, développé un formalisme général fondé sur<br />
les techniques de théorie <strong>des</strong> champs. Leurs calculs (toujours assortis d’une représentation<br />
simplifiée en lois d’échelle) ont permis de couvrir une large partie de l’éventail <strong>des</strong> réactions<br />
macromoléculaires. Outre l’extension de la théorie pour <strong>des</strong> fondus faiblement réactifs, les<br />
réactions dans les solutions (diluées, semi‐diluées, concentrées), donnant lieu à <strong>des</strong><br />
complications dues <strong>aux</strong> eff<strong>et</strong>s de volume exclu, ont aussi été étudiées [O’Shaughnessy 1994].<br />
Le cas <strong>des</strong> réactions interfaciales se produisant à l’interface stationnaire entre <strong>des</strong> fondus<br />
immiscibles a été ensuite décrit (O’Shaughnessy [1996 <strong>et</strong> 1999] (en concomitance avec <strong>des</strong><br />
trav<strong>aux</strong> similaires de Fredrickson <strong>et</strong> Milner [1996a <strong>et</strong> 1996b]), <strong>et</strong> récemment réexaminé de<br />
manière plus complète (O’Shaughnessy [1999]).<br />
La création d’une interface réactive implique que chaque composant contienne <strong>des</strong> fonctions<br />
capables de réagir in situ <strong>et</strong> de façon irréversible avec les fonctions antagonistes de l’autre<br />
composant. Ainsi, l’interface entre ces deux <strong>polymères</strong> est occupée progressivement par le<br />
copolymère dibloc. Dans le cas où les deux <strong>polymères</strong> A <strong>et</strong> B sont fortement immiscibles<br />
(cʹest‐à‐dire que le paramètre de Flory‐Hugins χ est positif), la région de coexistence <strong>des</strong><br />
chaînes A <strong>et</strong> B à l’interface <strong>des</strong> particules est extrêmement réduite. La réaction est alors<br />
confinée dans c<strong>et</strong>te p<strong>et</strong>ite région interfaciale, <strong>et</strong> ne s’étend pas au volume comme dans le cas<br />
de <strong>polymères</strong> identiques : d’après O’Shaughnessy [1996 <strong>et</strong> 1999] la cinétique de la réaction<br />
interfaciale est très différente de celle d’une réaction de volume.<br />
Guegan, Macosko <strong>et</strong> al. [1994] <strong>et</strong> Orr C <strong>et</strong> al. [1998] ont montré que la réaction entre deux<br />
<strong>polymères</strong> immiscibles fonctionnalisés où la réaction entre les groupes greffés d’acide<br />
carboxylique de fin de chaînes de polystyrène <strong>et</strong> les groupes époxy<strong>des</strong> du polyméthacrylate<br />
de méthyl, pour un couple (PS‐COOH/PMMA‐GMA) donné, s’effectue en parallèle de la<br />
diffusion <strong>des</strong> chaînes réactives. C’est‐à‐dire que la réaction entre les groupements réactifs de<br />
fin de chaînes est assurée par le phénomène de diffusion <strong>des</strong> chaînes.<br />
Selon Jonathan <strong>et</strong> al. [2000], la cinétique de la réaction est contrôlée soit par la réaction<br />
interfaciale soit par le phénomène diffusion <strong>des</strong> chaînes. Cependant, plusieurs auteurs tels<br />
que Fredrickson [1996a] <strong>et</strong> O’Shaughnessy [1996 <strong>et</strong> 1999] ont traité indépendamment <strong>et</strong><br />
théoriquement les aspects de la réaction interfaciale, en l’absence d’écoulement <strong>et</strong> surtout en<br />
présence de faible concentration de chaînes fonctionnalisées dans chacune <strong>des</strong> phases. La<br />
constante k de la vitesse de réaction pourrait être décrite par l’équation suivante :<br />
Partie A : Etat de l’art<br />
50