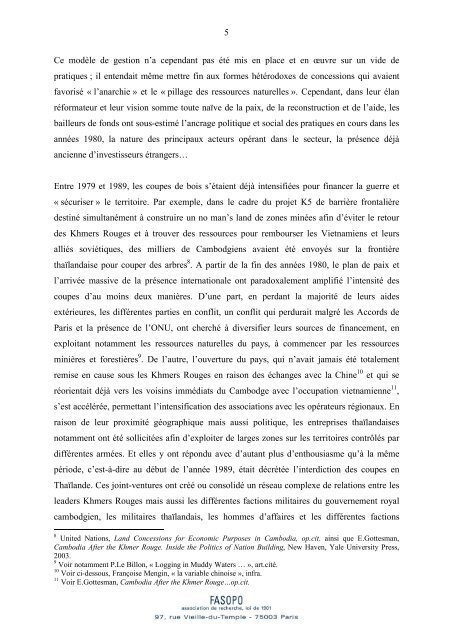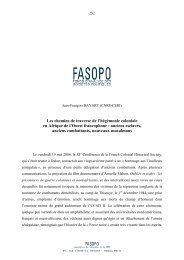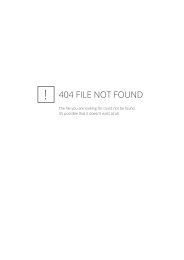Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5<br />
Ce <strong>modèle</strong> de gestion n’a cependant pas été mis en place et en œuvre sur un vide de<br />
pratiques ; il entendait même mettre fin aux formes hétérodoxes de concessions qui avaient<br />
favorisé « l’anarchie » et le « pillage des ressources naturelles ». Cependant, dans leur élan<br />
réformateur et leur vision somme toute naïve de la paix, de la reconstruction et de l’aide, les<br />
bailleurs de fonds ont sous-estimé l’ancrage politique et social des pratiques en cours dans les<br />
années 1980, la nature des principaux acteurs opérant dans le secteur, la présence déjà<br />
ancienne d’investisseurs étrangers…<br />
Entre 1979 et 1989, les coupes de bois s’étaient déjà intensifiées pour financer la guerre et<br />
« sécuriser » le territoire. Par exemple, dans le cadre du projet K5 de barrière frontalière<br />
destiné simultanément à construire un no man’s land de zones minées afin d’éviter le retour<br />
des Khmers Rouges et à trouver des ressources pour rembourser les Vietnamiens et leurs<br />
alliés soviétiques, des milliers de Cambodgiens avaient été envoyés sur la frontière<br />
thaïlandaise pour couper des arbres 8 . A partir de la fin des années 1980, le plan de paix et<br />
l’arrivée massive de la présence internationale ont paradoxalement amplifié l’intensité des<br />
coupes d’au moins deux manières. D’une part, en perdant la majorité de leurs aides<br />
extérieures, les différentes parties en conflit, un conflit qui perdurait malgré les Accords de<br />
Paris et la présence de l’ONU, ont cherché à diversifier leurs sources de financement, en<br />
exploitant notamment les ressources naturelles du pays, à commencer par les ressources<br />
minières et forestières 9 . De l’autre, l’ouverture du pays, qui n’avait jamais été totalement<br />
remise en cause sous les Khmers Rouges en raison des échanges avec la Chine 10 et qui se<br />
réorientait déjà vers les voisins immédiats du <strong>Cambodge</strong> avec l’occupation vietnamienne 11 ,<br />
s’est accélérée, permettant l’intensification des associations avec les opérateurs régionaux. En<br />
raison de leur proximité géographique mais aussi politique, les entreprises thaïlandaises<br />
notamment ont été sollicitées afin d’exploiter de larges zones sur les territoires contrôlés par<br />
différentes armées. Et elles y ont répondu avec d’autant plus d’enthousiasme qu’à la même<br />
période, c’est-à-dire au début de l’année 1989, était décrétée l’interdiction des coupes en<br />
Thaïlande. Ces joint-ventures ont créé ou consolidé un réseau complexe de relations entre les<br />
leaders Khmers Rouges mais aussi les différentes factions militaires du gouvernement royal<br />
cambodgien, les militaires thaïlandais, les hommes d’affaires et les différentes factions<br />
8 United Nations, Land Concessions for Economic Purposes in Cambodia, op.cit. ainsi que E.Gottesman,<br />
Cambodia After the Khmer Rouge. Inside the Politics of Nation Building, New Haven, Yale University Press,<br />
2003.<br />
9 Voir notamment P.Le Billon, « Logging in Muddy Waters … », art.cité.<br />
10 Voir ci-dessous, Françoise Mengin, « la variable chinoise », infra.<br />
11 Voir E.Gottesman, Cambodia After the Khmer Rouge…op.cit.