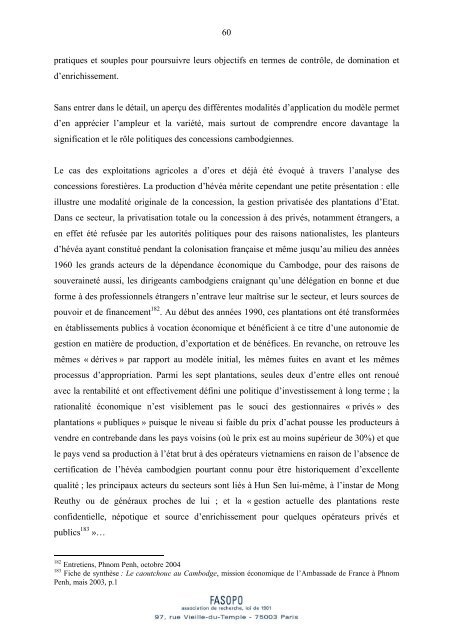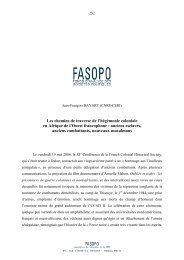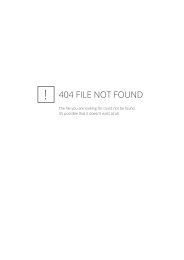Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
60<br />
pratiques et souples pour poursuivre leurs objectifs en termes de contrôle, de domination et<br />
d’enrichissement.<br />
Sans entrer dans le détail, un aperçu des différentes modalités d’application du <strong>modèle</strong> permet<br />
d’en apprécier l’ampleur et la variété, mais surtout de comprendre encore davantage la<br />
signification et le rôle politiques des concessions cambodgiennes.<br />
Le cas des exploitations agricoles a d’ores et déjà été évoqué à travers l’analyse des<br />
concessions forestières. La production d’hévéa mérite cependant une petite présentation : elle<br />
illustre une modalité originale de la concession, la gestion privatisée des plantations d’Etat.<br />
Dans ce secteur, la privatisation totale ou la concession à des privés, notamment étrangers, a<br />
en effet été refusée par les autorités politiques pour des raisons nationalistes, les planteurs<br />
d’hévéa ayant constitué pendant la colonisation française et même jusqu’au milieu des années<br />
1960 les grands acteurs de la dépendance économique du <strong>Cambodge</strong>, pour des raisons de<br />
souveraineté aussi, les dirigeants cambodgiens craignant qu’une délégation en bonne et due<br />
forme à des professionnels étrangers n’entrave leur maîtrise sur le secteur, et leurs sources de<br />
pouvoir et de financement 182 . Au début des années 1990, ces plantations ont été transformées<br />
en établissements publics à vocation économique et bénéficient à ce titre d’une autonomie de<br />
gestion en matière de production, d’exportation et de bénéfices. En revanche, on retrouve les<br />
mêmes « dérives » par rapport au <strong>modèle</strong> initial, les mêmes fuites en avant et les mêmes<br />
processus d’appropriation. Parmi les sept plantations, seules deux d’entre elles ont renoué<br />
avec la rentabilité et ont effectivement défini une politique d’investissement à long terme ; la<br />
rationalité économique n’est visiblement pas le souci des gestionnaires « privés » des<br />
plantations « publiques » puisque le niveau si faible du prix d’achat pousse les producteurs à<br />
vendre en contrebande dans les pays voisins (où le prix est au moins supérieur de 30%) et que<br />
le pays vend sa production à l’état brut à des opérateurs vietnamiens en raison de l’absence de<br />
certification de l’hévéa cambodgien pourtant connu pour être historiquement d’excellente<br />
qualité ; les principaux acteurs du secteurs sont liés à Hun Sen lui-même, à l’instar de Mong<br />
Reuthy ou de généraux proches de lui ; et la « gestion actuelle des plantations reste<br />
confidentielle, népotique et source d’enrichissement pour <strong>quel</strong>ques opérateurs privés et<br />
publics 183 »…<br />
182 Entretiens, Phnom Penh, octobre 2004<br />
183 Fiche de synthèse : Le caoutchouc au <strong>Cambodge</strong>, mission économique de l’Ambassade de France à Phnom<br />
Penh, mais 2003, p.1