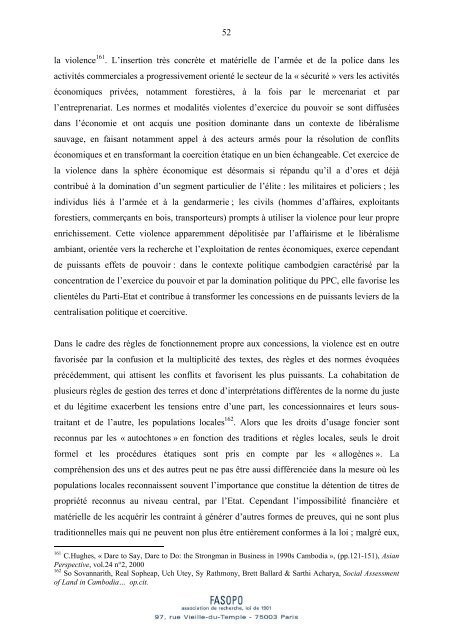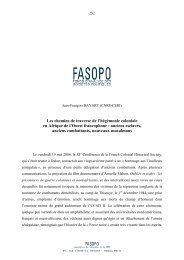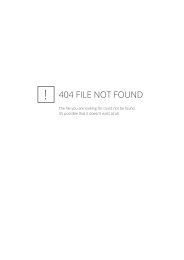Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
Cambodge : quel modèle concessionnaire ? - fasopo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
52<br />
la violence 161 . L’insertion très concrète et matérielle de l’armée et de la police dans les<br />
activités commerciales a progressivement orienté le secteur de la « sécurité » vers les activités<br />
économiques privées, notamment forestières, à la fois par le mercenariat et par<br />
l’entreprenariat. Les normes et modalités violentes d’exercice du pouvoir se sont diffusées<br />
dans l’économie et ont acquis une position dominante dans un contexte de libéralisme<br />
sauvage, en faisant notamment appel à des acteurs armés pour la résolution de conflits<br />
économiques et en transformant la coercition étatique en un bien échangeable. Cet exercice de<br />
la violence dans la sphère économique est désormais si répandu qu’il a d’ores et déjà<br />
contribué à la domination d’un segment particulier de l’élite : les militaires et policiers ; les<br />
individus liés à l’armée et à la gendarmerie ; les civils (hommes d’affaires, exploitants<br />
forestiers, commerçants en bois, transporteurs) prompts à utiliser la violence pour leur propre<br />
enrichissement. Cette violence apparemment dépolitisée par l’affairisme et le libéralisme<br />
ambiant, orientée vers la recherche et l’exploitation de rentes économiques, exerce cependant<br />
de puissants effets de pouvoir : dans le contexte politique cambodgien caractérisé par la<br />
concentration de l’exercice du pouvoir et par la domination politique du PPC, elle favorise les<br />
clientèles du Parti-Etat et contribue à transformer les concessions en de puissants leviers de la<br />
centralisation politique et coercitive.<br />
Dans le cadre des règles de fonctionnement propre aux concessions, la violence est en outre<br />
favorisée par la confusion et la multiplicité des textes, des règles et des normes évoquées<br />
précédemment, qui attisent les conflits et favorisent les plus puissants. La cohabitation de<br />
plusieurs règles de gestion des terres et donc d’interprétations différentes de la norme du juste<br />
et du légitime exacerbent les tensions entre d’une part, les <strong>concessionnaire</strong>s et leurs sous-<br />
traitant et de l’autre, les populations locales 162 . Alors que les droits d’usage foncier sont<br />
reconnus par les « autochtones » en fonction des traditions et règles locales, seuls le droit<br />
formel et les procédures étatiques sont pris en compte par les « allogènes ». La<br />
compréhension des uns et des autres peut ne pas être aussi différenciée dans la mesure où les<br />
populations locales reconnaissent souvent l’importance que constitue la détention de titres de<br />
propriété reconnus au niveau central, par l’Etat. Cependant l’impossibilité financière et<br />
matérielle de les acquérir les contraint à générer d’autres formes de preuves, qui ne sont plus<br />
traditionnelles mais qui ne peuvent non plus être entièrement conformes à la loi ; malgré eux,<br />
161<br />
C.Hughes, « Dare to Say, Dare to Do: the Strongman in Business in 1990s Cambodia », (pp.121-151), Asian<br />
Perspective, vol.24 n°2, 2000<br />
162<br />
So Sovannarith, Real Sopheap, Uch Utey, Sy Rathmony, Brett Ballard & Sarthi Acharya, Social Assessment<br />
of Land in Cambodia… op.cit.