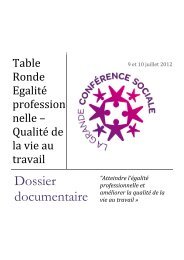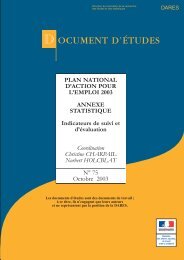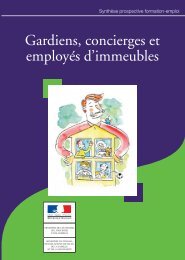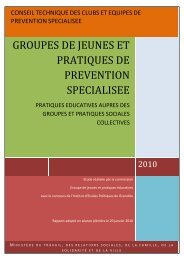Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
exorbitant se révèle particulièrement contraignant pour l’employeur : il lui impose le maintien du salarié protégé dans<br />
l’entreprise dans le but de garantir la continuité du mandat et porte, de facto, atteinte à son pouvoir de direction 1 tel qu’il<br />
a été forgé par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation 2 . Il constitue un cadre juridique strict qui<br />
règle précisément les conduites à tenir.<br />
Une telle analyse renvoie incontestablement à une certaine représentation du mandat dont il apparaît nécessaire de<br />
questionner la pertinence au travers de cette étude.<br />
II- <strong>Le</strong>s différentes configurations du mandat<br />
Ce cadre juridique délimite les règles du jeu <strong>des</strong> rapports entre <strong>salariés</strong> et employeur. Il impose une « manière de voir »<br />
commune. Toutefois, chaque joueur, pour reprendre la terminologie d'Elias, peut toujours choisir, ou jouer<br />
involontairement, <strong>des</strong> coups "hors <strong>des</strong> règles". En outre ce cadre juridique est une norme de contenant, et non de<br />
contenu. Elle laisse une grande marge d'interprétation aux joueurs. Ceci explique le constat d'une pluralité de<br />
comportements ou pour être plus précis, une pluralité de configurations relationnelles, au sens que leur donne Elias.<br />
Pour comprendre les différentes configurations que peuvent emprunter les relations entre <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> et entreprise<br />
qui peuvent conduire in fine au <strong>licenciement</strong>, il faut tout d'abord distinguer deux manières d'occuper le mandat<br />
fortement opposées :<br />
- Pour certains <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> les intérêts <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> et les intérêts de l'entreprise (ou plutôt du patronat dans ce caslà)<br />
sont perçus comme totalement antagonistes ;<br />
- Pour d'autres <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> au contraire, les intérêts <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> ne sont pas obligatoirement opposés à ceux de<br />
l'entreprise et parfois même leurs intérêts propres leur paraissent totalement intégrés à ceux de l'entreprise.<br />
On peut ainsi se représenter les différentes manières qu'ont les individus de concevoir le mandat de manière graphique,<br />
le long d'une droite dont ces deux manières constituent les deux extrémités. <strong>Le</strong>s comportements individuels sont<br />
influencés par la plus ou grande proximité <strong>des</strong> systèmes de préférence individuels avec ces deux pôles : ils sont plus ou<br />
moins influencés par l'un <strong>des</strong> deux sans que l'on puisse résumer la totalité de leurs actions uniquement par l'opposition<br />
ou uniquement par l'adhésion à l'entreprise. Personne ne croit que son intérêt est totalement opposé aux intérêts de<br />
l'entreprise, comme personne ne croit qu'il peut y avoir confusion totale. De la même façon, les <strong>salariés</strong> qui voient <strong>des</strong><br />
différences fortes entre leurs intérêts et ceux de l'entreprise employeuse souhaitent pourtant y être un minimum intégrés.<br />
La différence est donc de niveau et non de nature.<br />
<strong>Le</strong>s résultats présentés ici doivent donc être compris comme <strong>des</strong> idéaux-types qui ne se rencontrent jamais à l'état pur<br />
dans la réalité. <strong>Le</strong>s différences de populations ou de comportements que nous présentons ne sont pas <strong>des</strong> typologies au<br />
sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire la <strong>des</strong>cription et le classement d'une population en sous-populations à<br />
partir d'une déclinaison d'une ou plusieurs variables appliquées de manière homogène. Ces catégories issues de l'analyse<br />
sont beaucoup plus <strong>des</strong> catégories idéales-typiques dans le sens où <strong>des</strong> phénomènes concernant tout agent ou toute<br />
partie de l'organisation sont particulièrement mis en lumière pour décrire un groupe d'agents ou un phénomène<br />
organisationnel. Elles sont une simplification qui permet de mettre crûment en lumière <strong>des</strong> phénomènes qui sont, dans<br />
la réalité, beaucoup plus discrets et moins généraux que ce que nous pourrions penser d'après la présentation que nous<br />
en faisons. Ce modèle d'analyse, basé sur la méthodologie <strong>des</strong> idéaux-types formalisée par Weber (1971), présente<br />
l'énorme avantage de rendre très visibles les phénomènes qui se déroulent dans une organisation. En revanche, et c'est le<br />
prix à payer pour ce surplus de visibilité, ils apparaissent comme <strong>des</strong> caricatures d'une réalité dont les nuances ne sont<br />
pas prises en compte. L'opposition salarié – entreprise et l'intégration représentent deux "idéaux types".<br />
1 Suivant un récent revirement de jurisprudence unifiant les deux régimes juridiques, la mise à pied d’un représentant du personnel,<br />
qu’elle soit conservatoire ou disciplinaire, n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de son mandat (seule la mise à pied<br />
disciplinaire n’affectait plus, depuis un arrêt de 1999, le mandat qui ne se trouvait plus suspendu durant l’exécution de la mesure<br />
(Cass. Soc. 2 mars 2004, Agence Littoral de la société Alsthom Contracting Nord et Est, n° 464 FS-P+B+R+I).<br />
C’est aussi ce qui explique que la mise à pied conservatoire prononcée en vue d’un <strong>licenciement</strong> impose au représentant du salarié de<br />
cesser ses fonctions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise ; il ne peut ainsi prétendre au paiement <strong>des</strong> heures de<br />
délégation : Cass. Crim. 5 mars 2002, RJS 6/02, n° 695<br />
2 La notion de "pouvoir de direction" fonde en même temps qu’elle légitime certaines décisions prises par l’employeur (en matière,<br />
par exemple, de modification <strong>des</strong> conditions de travail <strong>des</strong> <strong>salariés</strong>) ; pour une illustration jurisprudentielle, cf. Cass. Soc. 30 avril<br />
2003, publié au bulletin. ; ou encore Cass. Soc. 1 er avril 2003<br />
L’employeur peut toujours, le cas échéant, apporter la preuve de l’existence d’un détournement <strong>des</strong> fonctions de représentation : il y<br />
a alors fraude à la loi (le salarié protégé a, par exemple, cherché à se faire élire ou nommer représentant du personnel ou DS pour<br />
échapper à un <strong>licenciement</strong> (Soc. 18 nov. 1999, Dr. Soc. 2000, p. 190, cf. J.-M. Verdier, "Désignation d’un délégué syndical : charge<br />
de la preuve et définition de la faute"). Encore faut-il qu’il parvienne à prouver que le but exclusif de la désignation était de faire<br />
échec au pouvoir unilatéral de l’employeur, l’existence d’une activité syndicale extérieure écartant par ailleurs cette exclusivité<br />
(Cass. Soc. 18 nov. 1999).<br />
22