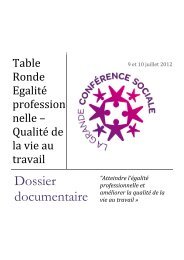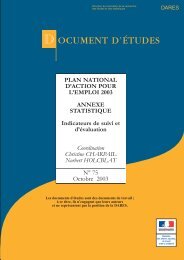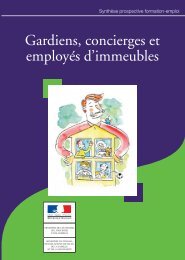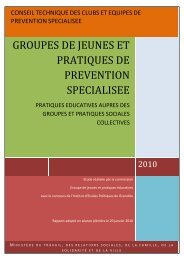Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
demande que nous aussi on soit plus pointus, plus compétents, donc effectivement c’est une remise en<br />
cause constante.» (Salarié, juge prud'homal, délégué syndical, ouvrier, 58 ans, CEP, TPE, demande de<br />
<strong>licenciement</strong> pour inaptitude)<br />
<strong>Le</strong> droit est alors principalement appréhendé dans sa dimension instrumentale : il est une ressource, dès lors que le<br />
salarié est en capacité de la mobiliser.<br />
«J'ai commencé à constituer mon dossier, parce que je me suis dit, "un jour on va aller au clash." Alors,<br />
voici un exemple : je fais une demande écrite pour pouvoir aller à tel salon, on me répondait : "avez-vous<br />
un intérêt quelconque à aller dans ce salon ?" Je faisais la personne qui acceptait tout en sachant que je<br />
préparais mon dossier, et le jour où je l'ai sorti, ils sont tombés de très haut.» (Salarié protégé, délégué<br />
syndical, membre du comité d’entreprise, 55 ans, cadre, BEPC, PME, demande de <strong>licenciement</strong> pour<br />
inaptitude)<br />
Dans son expression la plus "ultime", c’est-à-dire le procès, le droit prolonge, par d’autres moyens, le désaccord ou le<br />
conflit.<br />
«Comme on avait déjà engagé une action prud’homale où on veut aller jusqu’au bout, je veux aller au<br />
moins jusqu’au bout de ça avant de partir. Et par principe, parce que je sais que ça les emmerde, et bien<br />
ça me fait plaisir de rester là. Parce qu’ils nous ont tellement fait chier pendant un an et demi, ils ont<br />
essayé de me virer, ils n’y sont pas arrivés, ils vont sûrement recommencer. Mais à mon avis, ça va être<br />
de plus en plus difficile, ils vont avoir du mal à trouver <strong>des</strong> motifs. Parce que s’ils n’en ont pas trouvé<br />
jusque maintenant <strong>des</strong> motifs, parce que comme vous le disiez, ce n’est pas très compliqué de virer<br />
quelqu’un. Mais s’ils n’en ont pas trouvé pour me virer, c’est qu’ils vont sans doute avoir du mal à me<br />
virer» (Salarié protégé, membre du comité d’entreprise, délégué du personnel, syndiqué, 37 ans, cadre,<br />
Bac+2, PME, demande de <strong>licenciement</strong> pour faute)<br />
On ne peut alors qu’être amené à s’interroger sur le sens de ces évolutions. <strong>Le</strong> recours au droit ne pose-t-il pas la<br />
question de la pertinence du recours à la grève, qui, pour un secrétaire de CE interrogé<br />
«N’est pas adapté à notre temps.» (Secrétaire comité d’entreprise, syndiqué, 58 ans, PME)<br />
Ce constat va dans le sens de celui que dresse Alain Supiot 1 pour qui «la grève était tout d’abord une arme adaptée au<br />
modèle dominant de l’entreprise industrielle, conçue comme une institution soumettant une collectivité de travailleurs<br />
au pouvoir d’un employeur sous l’égide d’une loi nationale. […] Ainsi conçu, le droit de grève a joué depuis un siècle<br />
un rôle majeur dans l’édification de l'Etat-Providence. […]. Mais aujourd’hui le cadre économique et juridique dans<br />
lequel s’est affirmé le droit de grève a changé. <strong>Le</strong> modèle de la grande entreprise industrielle n’a cessé de décliner en<br />
Europe depuis 20 ans, au fur et à mesure que les entrepreneurs se sont affranchis <strong>des</strong> frontières nationales et que les<br />
Etats ont été en revanche soumis aux règles du commerce international. Face à ces changements, le droit de grève est<br />
une arme de moins en moins bien adaptée».<br />
<strong>Le</strong> droit apparaît ainsi particulièrement adapté à une population salariée de plus en plus diplômée et qualifiée. <strong>Le</strong><br />
rapport de forces quantitatif et physique <strong>des</strong> premiers temps du syndicalisme tend alors à être remplacé par <strong>des</strong><br />
affrontements de compétences ou le droit peut être mobilisé quasiment à parité par tous les protagonistes. Toutefois cet<br />
usage du droit ne doit pas faire oublier que la « juridicisation » <strong>des</strong> relations suppose que les individus disposent déjà de<br />
capacités cognitives. Remplacer le rapport de forces par <strong>des</strong> argumentations juridiques revient alors à exclure du jeu<br />
social tous ceux qui n'ont pas accès à ce niveau d'argumentation.<br />
En effet, si tout le monde semble capable de lire un texte de loi, la maîtrise <strong>des</strong> procédures et <strong>des</strong> formes juridiques<br />
relève d'un autre niveau de compétences.<br />
"Il a décidé d’aller tout seul aux prud’hommes, sans prendre d’avocat […] Là, il n'a pas pesé lourd :<br />
l’avocat l’a démonté, il n’avait rien chiffré, il avait fait ça sur un cahier d’écolier." (Salarié protégé)<br />
Toutefois, cette difficulté ne joue pas toujours en défaveur <strong>des</strong> <strong>salariés</strong>. Dans les petites entreprises familiales, par<br />
exemple, les <strong>salariés</strong> les mieux formés peuvent utiliser cette ressource pour rééquilibrer les positions entre subordonnés<br />
et direction.<br />
"<strong>Mo</strong>i je me suis mis sur le droit social parce que j’étais très persévérant.[…]. Et à partir de là, ça a<br />
commencé à jouer sec.» (Salarié protégé, délégué syndical, cadre, 42 ans, Bac, PME, demande de<br />
<strong>licenciement</strong> pour faute)<br />
1 A. Supiot, "Revisiter les droits d’action collective", Dr. Soc. 2001, p. 687 à 704, p. 688 et 689.<br />
97