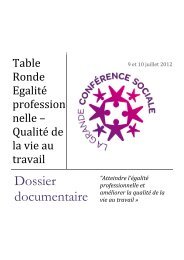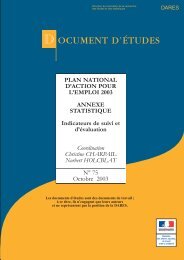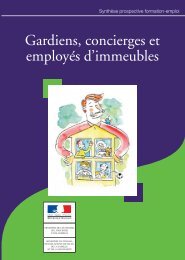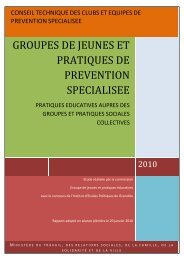Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Conclusions intermédiaires<br />
La tendance à la banalisation et à la subjectivation du mandat<br />
<strong>Le</strong>s différentes modalités d'occupation du mandat que nous avons décrites ainsi que leurs déterminants donnent<br />
l'impression que <strong>des</strong> évolutions de fond qui se déroulent rendent l'occupation du mandat profondément différente de<br />
celle qui prévalait à l'époque où les différentes règles juridiques ont été élaborées, c’est-à-dire à partir <strong>des</strong> années 70 1 .<br />
N’assiste-t-on pas à une banalisation du statut juridique et social du salarié protégé sous la pression, notamment, de<br />
l’important contentieux sur les rattrapages de salaires qui a eu lieu ces dernières années, et dont le plus significatif<br />
demeure celui qui a opposé les <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> de Peugeot à leur direction. Ce contentieux s’est appuyé sur deux arrêts<br />
de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendus le même jour, Fluchère et Seillier, qui, conformément au droit<br />
communautaire 2 , introduisent dans le droit français, un renversement de la charge de la preuve au niveau <strong>des</strong><br />
discriminations tant syndicales 3 que sexistes 4 . <strong>Le</strong> salarié n’a ainsi plus à faire la preuve de la discrimination dont il est<br />
victime mais doit fournir <strong>des</strong> éléments de fait susceptibles de porter atteinte à l’égalité de traitement. Cela peut se faire<br />
par le biais de données statistiques apparemment neutres, mais qui affectent une proportion nettement plus élevée de<br />
personnes d’un sexe ou d’un syndicat, par exemple (discrimination indirecte). En mettant en exergue le lien entre<br />
mandat et conditions de travail, entendues dans le sens large du terme, le droit, et en particulier la jurisprudence de la<br />
Cour de cassation, a sans doute contribué à l’alignement <strong>des</strong> statuts (<strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> - non <strong>protégés</strong>). Cette banalisation<br />
<strong>des</strong> fonctions s’exprime également chez les <strong>salariés</strong> eux-mêmes qui font état d’un "avant" où la discrimination<br />
apparaissait comme un gage d’un "bon syndicalisme" : "<strong>Le</strong>s augmentations de salaires, changer de voiture étaient<br />
suspects" ; "quand on avait une augmentation, on pouvait passer pour <strong>des</strong> collabos" ; "il était interdit, pour un élu,<br />
d’avoir une promotion" 5 . <strong>Le</strong>s discriminations étaient "acceptées" par les militants syndicaux comme faisant partie du<br />
mandat. Il existait en quelque sorte une culture du sacrifice qui contribuait aussi à légitimer le mandat. <strong>Le</strong>s<br />
représentations sociales attachées au mandat et à son occupation semblent ainsi évoluer.<br />
Ces évolutions ne traduisent-elles pas en même tant qu’elles l’induisent, un recentrage sur la personne ? Ainsi que<br />
l’explique F. Duquesne, "<strong>Le</strong> recentrage <strong>des</strong> droits fondamentaux sur la personne au travail, à l’initiative du juge social<br />
tend à favoriser l’admission, à l’intérieur même de la vie de travail, de séquences où le salarié est autorisé à se soustraire<br />
au rapport de subordination" 6 . <strong>Le</strong> mandat confère une certaine liberté à la personne qui l’occupe. C’est ainsi que la<br />
chambre sociale de la Cour de cassation a pu décider qu’un salarié trésorier du CE qui avait détourné <strong>des</strong> fonds et avait<br />
été licencié pour ce fait ne pouvait se voir licencié pour faute grave dès lors qu’"un fait fautif ne peut s’entendre que<br />
d’un fait du salarié contraire à ses obligations à l’égard de l’employeur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors, d’une<br />
part, qu’un salarié agissant dans le cadre de ses fonctions de trésorier du comité d’entreprise n’est pas sous la<br />
subordination de l’employeur, et alors, d’autre part, que l’arrêt n’a caractérisé aucune faute commise par le salarié dans<br />
l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés" 7 .<br />
Au final, il apparaît parfois difficile de déterminer le rôle effectivement joué par le statut juridique : s’agit-il de protéger<br />
le mandat ou la personne ? Si le droit se prononce très clairement en faveur de la protection du mandat 8 , l’analyse <strong>des</strong><br />
pratiques montre l’existence d’une combinaison <strong>des</strong> deux . <strong>Le</strong>s motifs de l’engagement ressortent de l’intérêt collectif et<br />
individuel. C’est ce qu’exprime M. C, DS FO, secrétaire de CE et conseillère prud’homale.<br />
"Il se passait <strong>des</strong> choses injustes dans les salaires, il fallait mettre le nez dedans et personne n’osait. Mais<br />
de fil en aiguille, quand ça m’a atteint personnellement, je me suis dit : il faut faire quelque chose, ça ne<br />
peut plus durer." (Salariée protégée, juge prud'hommes, syndiquée, 54 ans, agent de maîtrise, CAP, PME,<br />
demande de <strong>licenciement</strong> pour inaptitude)<br />
1 Date <strong>des</strong> arrêts Perrier, Cass. Chambre mixte 21 juin 1974, Perrier, Dalloz 1974, p. 593, Concl. Touffait, p. 596 : « attendu que les<br />
dispositions législatives soumettant a l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou à la décision conforme de l'inspecteur du<br />
travail le <strong>licenciement</strong> <strong>des</strong> salaries légalement investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salaries et dans<br />
l'intérêt de l'ensemble <strong>des</strong> travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit<br />
par suite a l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ».<br />
2 Directive de 1997. Aujourd’hui codifiée par la loi du 17 janvier 2002 sur les discriminations à l’article L. 122-45, 4 e al. du Code du<br />
travail.<br />
3 Cass. soc. 28 mars 2000, Fluchère, Dick et CDFT cheminots c/ SNCF, Dr. soc. 2000, p. 593, note M.-Th. Lanquetin.<br />
4 Cass. soc. 23 nov. 1999, Melle G. Seillier c/ CEA, Dr. soc. 2000, p. 593, note M.-Th. Lanquetin.<br />
5 Paroles de militants CGT, Stage ISST, juin 2003.<br />
6 Duquesne (F), "Représentants du personnel. Contrat de travail et exercice du mandat", RJS 7/02, p. 603 à 608, p. 607.<br />
7 Cass. Soc. 4 juillet 2000, RJS 11/00, n° 1109<br />
8 Lire nos développements antérieurs.<br />
55