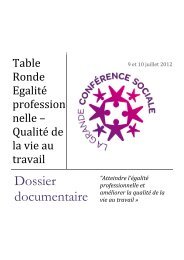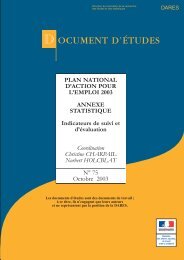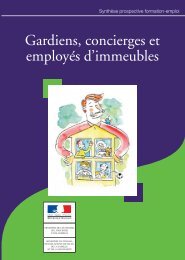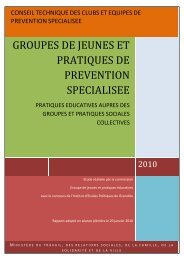Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cette banalisation du mandat s’explique, en partie, par la place plus importante occupée par la personne dans la<br />
construction de la relation de travail.<br />
Cette personnalisation du mandat trouve son pendant juridique dans la récente consécration, par le Code du travail, du<br />
harcèlement moral en tant que catégorie juridique 1 . N’est-on pas en train de glisser d’une logique «d’objectivation du<br />
mandat», que le droit a contribué à instituer, à une logique de «subjectivation» ? Autrement dit, le mandat serait<br />
aujourd’hui intimement lié à la personne qui l’occupe, tant au niveau <strong>des</strong> représentations qu’en ont les autres <strong>salariés</strong><br />
et l’employeur, que dans l’exercice du mandat par le salarié protégé, contribuant à "rendre plus acceptable" une<br />
séparation qui est aussi plus "douloureuse" 2 .<br />
Plusieurs constats, issus <strong>des</strong> enseignements dispensés au sein de l’ISST, peuvent être dressés qui contribuent à étayer<br />
cette hypothèse :<br />
1° <strong>Le</strong>s négociations sur la RTT ont mis en exergue le décalage pouvant exister entre les objectifs du délégué syndical<br />
(mettre en place <strong>des</strong> pauses intégrées dans le temps de travail) et les attentes <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> (faire reconnaître un temps de<br />
pause comme temps de travail mais ne pas l'utiliser afin de raccourcir le temps de présence dans l’entreprise), ce<br />
décalage aboutissant à <strong>des</strong> critiques ouvertes dirigées contre la personne du salarié protégé, critiques pouvant aller<br />
jusqu’au désaveu. <strong>Le</strong>s <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> interrogés dans le cadre de notre activité à l’ISST traduisent ces évolutions en<br />
termes de montée de l’individualisme : «les <strong>salariés</strong> sont difficiles à mobiliser» ; «les militants viennent voir le syndicat<br />
lorsqu’il y a le feu» ; «ils nous utilisent» ; «autrefois, on était à l’intérieur d’un bonheur collectif». Un inspecteur du<br />
travail constate que les modalités d’intervention <strong>des</strong> inspecteurs du travail se font de plus en plus à partir d’une<br />
demande individuelle, alors qu’auparavant, la «clé d’entrée» était un conflit collectif ou un accident du travail.<br />
2° <strong>Le</strong>s <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> font état, plus souvent que les autres <strong>salariés</strong>, de souffrances au travail (environ 14 % <strong>des</strong><br />
personnes venues consulter la FNATH) 3 , de pressions exercées par l’employeur. Or il semble que les pressions que<br />
subissent certains <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> ont glissé depuis le mandat vers le contrat de travail et la personne qui l’occupe. <strong>Le</strong><br />
conflit porterait donc moins sur les fonctions statutaires que sur la façon dont est réalisé le travail : qualité du travail,<br />
manquements professionnels peuvent ainsi être mis en avant par l’employeur, sans qu’il soit aisé de «faire la part <strong>des</strong><br />
choses».<br />
Ce constat trouverait son prolongement juridique (sans que nous ne disposions de données chiffrées) dans les deman<strong>des</strong><br />
de <strong>licenciement</strong> fondées sur une insuffisance professionnelle ou même une inaptitude du salarié protégé. S’agissant de<br />
l’inaptitude, l’une <strong>des</strong> hypothèses (qui reste difficile à prouver) est que la dégradation <strong>des</strong> conditions d’exercice <strong>des</strong><br />
mandats syndicaux serait à l’origine d’une dégradation de l’état de santé <strong>des</strong> personnes qui serait à l’origine de<br />
reconnaissances de l’inaptitude débouchant sur un certain nombre de <strong>licenciement</strong>s. Ce n’est alors pas le mandat mais la<br />
santé défaillante du salarié protégé qui fonde, par le biais de l’inaptitude reconnue, la demande. Ce glissement permet<br />
peut-être d’expliquer, en partie, pourquoi les <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> contestent moins souvent que les employeurs la décision<br />
rendue par l’inspecteur du travail.<br />
Cette personnalisation du mandat semble se traduire aujourd’hui par un glissement de la discrimination vers le<br />
harcèlement moral, transportant les termes du litige sur le terrain du conflit interpersonnel tout en générant une certaine<br />
opacité quant aux fondements réels du litige.<br />
La jurisprudence s’est forgée, au fil <strong>des</strong> ans, autour <strong>des</strong> luttes contre la discrimination <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong>, en<br />
s’appuyant sur l’article L. 122-45 4 . La Cour de cassation annule toute mesure discriminatoire touchant la vie<br />
professionnelle du salarié protégé, qu’il s’agisse de la rémunération, de l’avancement, de l’accès à la formation 5 .… Par<br />
conséquent, l’œuvre jurisprudentielle consiste, entre autres, à garantir une égalité de traitement entre les <strong>salariés</strong><br />
1<br />
Loi du 17 janvier 2002 dite loi de modernisation sociale » ; art. L. 122-49 du Code du travail.<br />
2<br />
Même si le statut protecteur peut apparaître, pour certains <strong>salariés</strong>, en particulier ceux qui possèdent un projet professionnel, comme<br />
un « statut carcan » qui alourdit la procédure et retarde la séparation.<br />
3<br />
FNATH, Salariés en détresse : quelles réponses ? L’expérience d’une consultation pluridisciplinaire, document de travail interne,<br />
automne 2003, 27 p.<br />
4<br />
Suivant le premier alinéa, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une<br />
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,<br />
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de<br />
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de<br />
ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance<br />
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités<br />
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée<br />
par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ».<br />
5<br />
Cass. Soc. 28 mars 2000, Fluchère, Dick et CFDT Cheminots c/ SNCF, Dr. Soc. 2000, p. 593, note M.-Th. Lanquetin. <strong>Le</strong> salarié n’a<br />
plus à faire la preuve de la discrimination dont il est victime mais doit "fournir les éléments de fait susceptibles de caractériser une<br />
atteinte au principe de l’égalité de traitement" ; il incombe alors à l’employeur d’apporter la preuve que cette différence est "justifiée<br />
par <strong>des</strong> éléments objectifs étrangers à toute discrimination".<br />
56