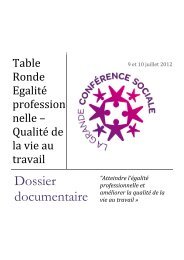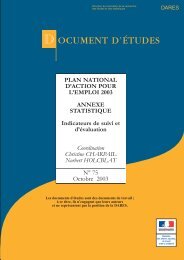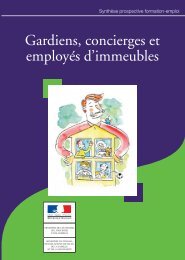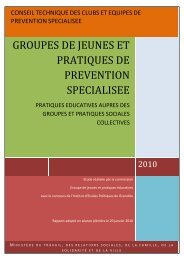Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
C’est pourquoi, ne disposant actuellement que de données quantitatives issues de remontées administratives, la Dares a<br />
fait appel à une équipe de chercheurs pour la réalisation d’une enquête qualitative sur les processus et les enjeux <strong>des</strong><br />
<strong>licenciement</strong>s de <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong>.<br />
<strong>Le</strong> droit et la sociologie pour comprendre le <strong>licenciement</strong> <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong><br />
La méthodologie juridique retenue<br />
<strong>Le</strong> <strong>licenciement</strong> <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> ne peut s’analyser et se comprendre sans une incursion dans le droit. En effet, si<br />
l’intérêt d’une telle étude 1 est d’essayer de mieux cerner le processus à l’œuvre, processus qui conduit à la demande de<br />
<strong>licenciement</strong> présentée à l’inspecteur du travail, l’analyse juridique permet de re-situer les pratiques dans un cadre légal<br />
contraignant. Ce faisant, il apparaît fondamental de relever et d’analyser les éventuels décalages entre le cadre légal et<br />
les pratiques. Quels sont les usages sociaux du droit en la matière, autrement dit, comment les personnes utilisent-elles<br />
le droit ? Quel sens donner à d’éventuelles distorsions ou contournements ? Il apparaît donc essentiel de distinguer (ce<br />
que nous nous efforçons de faire) l’analyse du cadre juridique, porteur de certaines représentations sociales, de<br />
pratiques qui s’en éloignent parfois.<br />
Une telle démarche implique de connaître les textes et d’analyser les pratiques. <strong>Le</strong> chercheur ne peut en effet<br />
comprendre ce qui se joue lors d’un conflit s’il n’a pas la connaissance du cadre juridique qui structure, pour partie, ce<br />
conflit. La difficulté réside alors dans l’élaboration d’une "langue commune" au droit et à la sociologie. Certaines<br />
notions sociologiques peuvent alors apparaître floues ou, au contraire, trop schématiques pour le juriste qui peut, à<br />
l’inverse, sembler quelque peu "s’enfermer" dans une rigueur conceptuelle. Au final, ce travail disciplinaire, bien<br />
qu’indispensable, est loin d’être évident.<br />
<strong>Le</strong> travail juridique a été réalisé à partir d’une analyse de la jurisprudence, et plus spécifiquement de celle du Conseil<br />
d’Etat, réalisée au moyen de deux banques de données : Légisoft, qui contient l’intégralité <strong>des</strong> arrêts publiés au Recueil<br />
<strong>Le</strong>bon par le Conseil d’Etat depuis 1984 et Légifrance, site Internet offrant l’accès à une banque de données <strong>des</strong> arrêts<br />
du Conseil d’Etat 2 . Un dépouillement et une analyse <strong>des</strong> arrêts rendus par le Conseil d’Etat ont été réalisés sur la<br />
période 1990-2002. Une mise à jour a été réalisée, incluant, dans cette étude, les arrêts les plus importants rendus<br />
jusqu’en juin 2005.<br />
<strong>Le</strong> travail d’analyse juridique a été complété par la lecture <strong>des</strong> différentes circulaires du <strong>des</strong> affaires sociales relatives<br />
aux <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> ainsi que par la lecture d’articles de doctrine (cf. la bibliographie). Quant à la consultation de<br />
"manuels", elle a permis d’apporter <strong>des</strong> éclaircissements sur <strong>des</strong> points de droit très précis.<br />
Cette première partie d’un travail basé sur l’analyse de normes juridiques nous a permis d’avoir une vision globale <strong>des</strong><br />
litiges et <strong>des</strong> réponses apportées par le droit. L’intérêt est d’ensuite les confronter aux pratiques.<br />
L'enquête de terrain<br />
Pour cela nous avons fait deux séries d'entretiens :<br />
Une dizaine d'entretiens avec <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> licenciés, <strong>des</strong> inspecteurs du travail du travail, <strong>des</strong><br />
représentants syndicaux 3<br />
À partir du repérage d'une douzaine de dossiers diversifiés une quarantaine d'entretiens ont été réalisés. Dans<br />
chaque cas et dans la mesure du possible ont été interrogés : le salarié protégé lui-même, le chef d'entreprise ou<br />
son représentant, un représentant du comité d’entreprise, l'inspecteur du travail en charge du dossier.<br />
1<br />
Cf. N. Maggi-Germain, « <strong>Le</strong> <strong>licenciement</strong> <strong>des</strong> salaries <strong>protégés</strong> : processus et enjeux. Synthèse juridique d’une étude menée pour la<br />
Dares », à paraître à la revue Droit et société.<br />
2<br />
Publiés au recueil <strong>Le</strong>bon et aux Tables du recueil <strong>Le</strong>bon depuis 1965; inédits au recueil <strong>Le</strong>bon depuis 1986. La publication, décidée<br />
par le Conseil d’Etat, rend compte de l’importance de la décision qui présente généralement un intérêt particulier (questions de droit<br />
nouvelles ou évolutions jurisprudentielles…). Elles figurent en intégralité dans la première partie de Recueil Labon et sous forme<br />
d’analyse dans la seconde partie, appelée aussi Tables du recueil <strong>Le</strong>bon (il s’agit alors de décisions qui confirment la jurisprudence<br />
antérieure ou ne font qu’apporter un complément d’analyse).<br />
3<br />
<strong>Le</strong>s représentants syndicaux ont une vision assez peu précise de ce qui déroule lors <strong>des</strong> <strong>licenciement</strong>s de <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong>. Il faut<br />
certainement mettre ces lacunes en regard du fait que la plus grande partie <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> de <strong>licenciement</strong> concerne <strong>des</strong> nonsyndiqués<br />
mais aussi que, même chez les syndiqués, le <strong>licenciement</strong> est géré comme une affaire personnelle et non comme une<br />
affaire qui concerne l'organisation syndicale.<br />
8