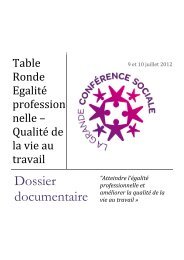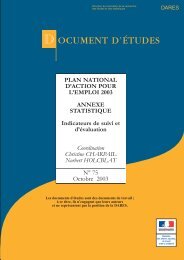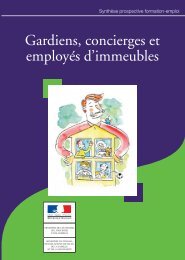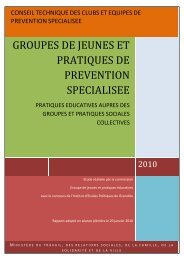Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Malheureusement, donc, je ne peux pas me sentir lié et en plus il faudrait un comité d’entreprise<br />
extrêmement malin et qui ait extrêmement bien étayé le dossier pour qu’on puisse utiliser vraiment les<br />
éléments qu’il y a eu dans les débats du comité d’entreprise. Ce qui arrive de temps en temps ; ce sont les<br />
plus gros <strong>licenciement</strong>s économiques et ces malins savent nous procurer du biscuit pour qu’on puisse le<br />
faire mais c’est très rare." (Inspecteur du travail)<br />
L’analyse <strong>des</strong> avis rendus fait parfois ressortir le caractère quelque peu formel de la décision du comité d’entreprise. On<br />
ne peut, en effet, que s’étonner, à la lecture de certains dossiers de deman<strong>des</strong> de <strong>licenciement</strong>s pour motif économique,<br />
de constater que la réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle l’avis doit être rendu constitue aussi le moment<br />
où la direction expose ses projets de restructuration. Cette concomitance est d’autant plus étonnante que le comité<br />
d’entreprise devait légalement avoir été déjà consulté sur <strong>des</strong> projets de ce type 1 . Dans d’autres dossiers, on ne<br />
comprend pas pourquoi il n’est fait aucune référence aux consultations et avis rendus antérieurement au projet de<br />
restructuration. On peut alors légitimement s’interroger sur la capacité d’appréhension, par le comité d’entreprise, de la<br />
situation globale de l’entreprise, tant au plan économique que social. Ce constat de "déconnexion" entre le volet<br />
économique et social peut donner à penser que le rôle du comité d’entreprise est alors quelque peu "formel".<br />
Cette faible prise <strong>des</strong> IRP sur les données économiques, notamment lors de successions de plans de sauvegarde de<br />
l’emploi, de fusions, de cessions… se révèle lors d’entretiens réalisés avec <strong>des</strong> secrétaires de comité d’entreprise. <strong>Le</strong>s<br />
représentants <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> sont démunis;<br />
"On était assez perdus. […] On avait tellement entendu de choses avant. […] On ne savait plus ce que<br />
l’on devait croire" (Secrétaire de comité d’entreprise, PME)<br />
<strong>Le</strong>s représentants du comité d’entreprise connaissent <strong>des</strong> difficultés pour appréhender une réalité économique et<br />
juridique extrêmement complexe, qui échappe aux béotiens.<br />
"En France, dans l’opinion publique commune […] on finit presque par admettre que dès lors qu’on dit<br />
que c’est économique, il n’y a même pas à contrôler que ce soit fondé"." (Inspecteur du travail)<br />
<strong>Le</strong> recours à un avocat permet alors parfois de combler ces carences.<br />
Cette faible prise sur les contexte économique et social s’explique également, pour partie, par la faible culture<br />
économique et juridique <strong>des</strong> membres du comité d’entreprise qui demeurent insuffisamment formés malgré le droit à<br />
congé dont ils disposent 2 .<br />
Au bout du compte, la relativité de l’avis de comité d’entreprise s’explique aussi par l’absence d’effet contraignant.<br />
"[…] C’est vrai que souvent les entraves aux IRP c’est souvent du formalisme, d’autant plus que le<br />
comité d’entreprise n’a pas un pouvoir de blocage il n’a qu’un pouvoir de consultation, donc, allez<br />
expliquer [aux magistrats] que c’est porter gravement atteinte à l’ordre public social que de ne pas avoir<br />
consulté le comité d’entreprise en amont sur telle décision, alors que le comité d’entreprise ne peut que<br />
dire : on n’est pas d’accord mais l’employeur n’en a rien à foutre et il peut quand même continuer à<br />
avancer, c’est un petit exercice intellectuel." (Inspecteur du travail)<br />
B) L’organisation syndicale<br />
L’intervention, au cours du conflit, de l’organisation syndicale contribue à figer le conflit (1). Elle apparaît, dès lors que<br />
le litige est né, comme une ressource mobilisée par le salarié protégé (2).<br />
1) La présence syndicale cristallise le conflit<br />
L’analyse de terrain montre que la présence syndicale cristallise le conflit : elle produit <strong>des</strong> effets différents selon le<br />
moment auquel elle intervient. Incontestablement, l’affiliation à un syndicat par un salarié protégé est mal perçue par<br />
l’employeur, comme si le salarié faisait entrer l’ennemi dans l'entreprise. Cela peut être vécu comme une déclaration de<br />
guerre dont la réponse est le <strong>licenciement</strong> du salarié.<br />
1 Art. L. 432-1, 2 e al. du Code du travail.<br />
2 Suivant l’article L. 451-1, 4 e al. du Code du travail, les <strong>salariés</strong> désireux de participer à <strong>des</strong> stages ou sessions de formation<br />
économique, sociale ou syndicale ont droit à <strong>des</strong> congés rémunérés dont la durée totale ne peut excéder, par an et par salarié, "douze<br />
jours ou dix-huit jours pour les animateurs <strong>des</strong> stages et sessions et pour les <strong>salariés</strong> appelés à exercer <strong>des</strong> responsabilités syndicales.<br />
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours".<br />
84