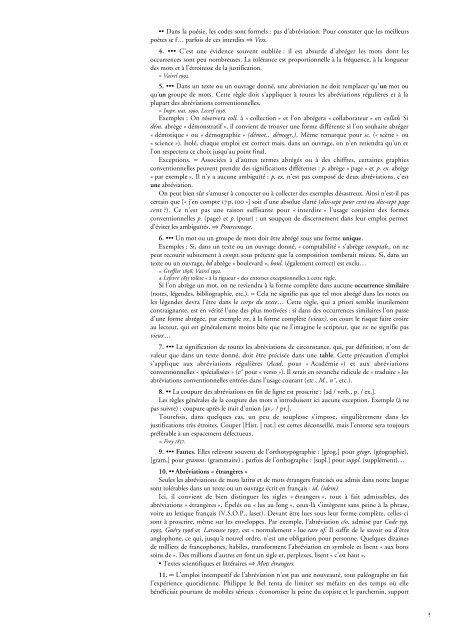Orthotypo-Lacroux.pdf - Liste Typographie
Orthotypo-Lacroux.pdf - Liste Typographie
Orthotypo-Lacroux.pdf - Liste Typographie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
•• Dans la poésie, les codes sont formels : pas d’abréviation. Pour constater que les meilleurs<br />
poètes se f… parfois de ces interdits ⇒ Vers.<br />
4. ••• C’est une évidence souvent oubliée : il est absurde d’abréger les mots dont les<br />
occurrences sont peu nombreuses. La tolérance est proportionnelle à la fréquence, à la longueur<br />
des mots et à l’étroitesse de la justification.<br />
= Vairel 1992.<br />
5. ••• Dans un texte ou un ouvrage donné, une abréviation ne doit remplacer qu’un mot ou<br />
qu’un groupe de mots. Cette règle doit s’appliquer à toutes les abréviations régulières et à la<br />
plupart des abréviations conventionnelles.<br />
= Impr. nat. 1990, Lecerf 1956.<br />
Exemples : On réservera coll. à « collection » et l’on abrégera « collaborateur » en collab. Si<br />
dém. abrège « démonstratif », il convient de trouver une forme différente si l’on souhaite abréger<br />
« démotique » ou « démographie » (démot., démogr.). Même remarque pour sc. (« scène » ou<br />
« science »). Isolé, chaque emploi est correct mais, dans un ouvrage, on n’en retiendra qu’un et<br />
l’on respectera ce choix jusqu’au point final.<br />
Exceptions. ≈ Associées à d’autres termes abrégés ou à des chiffres, certaines graphies<br />
conventionnelles peuvent prendre des significations différentes : p. abrège « page » et p. ex. abrège<br />
« par exemple ». Il n’y a aucune ambiguïté : p. ex. n’est pas composé de deux abréviations, c’est<br />
une abréviation.<br />
On peut bien sûr s’amuser à concocter ou à collecter des exemples désastreux. Ainsi n’est-il pas<br />
certain que [« j’en compte 17 p. 100 »] soit d’une absolue clarté (dix-sept pour cent ou dix-sept page<br />
cent ?). Ce n’est pas une raison suffisante pour « interdire » l’usage conjoint des formes<br />
conventionnelles p. (page) et p. (pour) : un soupçon de discernement dans leur emploi permet<br />
d’éviter les ambiguïtés. ⇒ Pourcentage.<br />
6. ••• Un mot ou un groupe de mots doit être abrégé sous une forme unique.<br />
Exemples : Si, dans un texte ou un ouvrage donné, « comptabilité » s’abrège comptab., on ne<br />
peut recourir subitement à compt. sous prétexte que la composition tomberait mieux. Si, dans un<br />
texte ou un ouvrage, bd abrège « boulevard », boul. (également correct) est exclu…<br />
= Greffier 1898, Vairel 1992.<br />
± Lefevre 1855 tolère « à la rigueur » des entorses exceptionnelles à cette règle.<br />
Si l’on abrège un mot, on ne reviendra à la forme complète dans aucune occurrence similaire<br />
(notes, légendes, bibliographie, etc.). ≈ Cela ne signifie pas que tel mot abrégé dans les notes ou<br />
les légendes devra l’être dans le corps du texte… Cette règle, qui a priori semble inutilement<br />
contraignante, est en vérité l’une des plus motivées : si dans des occurrences similaires l’on passe<br />
d’une forme abrégée, par exemple vx, à la forme complète (vieux), on court le risque faire croire<br />
au lecteur, qui est généralement moins bête que ne l’imagine le scripteur, que vx ne signifie pas<br />
vieux…<br />
7. ••• La signification de toutes les abréviations de circonstance, qui, par définition, n’ont de<br />
valeur que dans un texte donné, doit être précisée dans une table. Cette précaution d’emploi<br />
s’applique aux abréviations régulières (Acad. pour « Académie ») et aux abréviations<br />
o<br />
conventionnelles « spécialisées » (v pour « verso »). Il serait en revanche ridicule de « traduire » les<br />
o<br />
abréviations conventionnelles entrées dans l’usage courant (etc., M., n , etc.).<br />
8. •• La coupure des abréviations en fin de ligne est proscrite : [ad / verb., p. / ex.].<br />
Les règles générales de la coupure des mots n’introduisent ici aucune exception. Exemple (à ne<br />
pas suivre) : coupure après le trait d’union [av.- / pr.].<br />
Toutefois, dans quelques cas, un peu de souplesse s’impose, singulièrement dans les<br />
justifications très étroites. Couper [Hist. | nat.] est certes déconseillé, mais l’entorse sera toujours<br />
préférable à un espacement défectueux.<br />
= Frey 1857.<br />
9. ••• Fautes. Elles relèvent souvent de l’orthotypographie : [géog.] pour géogr. (géographie),<br />
[gram.] pour gramm. (grammaire) ; parfois de l’orthographe : [supl.] pour suppl. (supplément)…<br />
10. •• Abréviations « étrangères »<br />
Seules les abréviations de mots latins et de mots étrangers francisés ou admis dans notre langue<br />
sont tolérables dans un texte ou un ouvrage écrit en français : id. (idem).<br />
Ici, il convient de bien distinguer les sigles « étrangers », tout à fait admissibles, des<br />
abréviations « étrangères ». Épelés ou « lus au long », ceux-là s’intègrent sans peine à la phrase,<br />
voire au lexique français (V.S.O.P., laser). Devant être lues sous leur forme complète, celles-ci<br />
sont à proscrire, même sur les enveloppes. Par exemple, l’abréviation c/o, admise par Code typ.<br />
1993, Guéry 1996 et Larousse 1997, est « normalement » lue care of. Il suffit de le savoir ou d’être<br />
anglophone, ce qui, jusqu’à nouvel ordre, n’est une obligation pour personne. Quelques dizaines<br />
de milliers de francophones, habiles, transforment l’abréviation en symbole et lisent « aux bons<br />
soins de ». Des millions d’autres en font un sigle et, perplexes, lisent « c’est haut ».<br />
• Textes scientifiques et littéraires ⇒ Mots étrangers.<br />
11. ∞ L’emploi intempestif de l’abréviation n’est pas une nouveauté, tout paléographe en fait<br />
l’expérience quotidienne. Philippe le Bel tenta de limiter ses méfaits en des temps où elle<br />
bénéficiait pourtant de mobiles sérieux : économiser la peine du copiste et le parchemin, support<br />
3