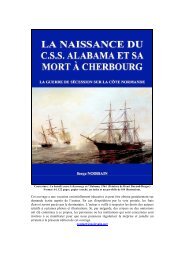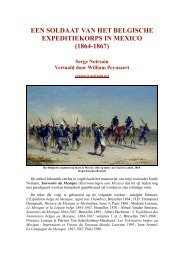UN FRANÇAIS EN LOUISIANE 1860-1862
Notes et observations d'un écrivain et géographe français pendant la guerre de Sécession en Louisiane
Notes et observations d'un écrivain et géographe français pendant la guerre de Sécession en Louisiane
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
68
les grosses filatures britanniques et française pour la fabrication de leurs plus délicates
étoffes. Grâce à l’exportation de cette précieuse denrée et au riz qu’ils faisaient pousser
en abondance, les propriétaires de l’archipel étaient devenus les plus riches de la Caroline
du Sud. L’affluence des étrangers qui, pendant la belle saison, venaient respirer la brise
de la mer, contribuait encore à grossir leur fortune. Aussi presque tous les planteurs
possédaient des centaines de Nègres assignés aux tâches domestiques et aux travaux des
champs. Sur les 40 000 habitants du comté, 33 000 étaient esclaves.
Les planteurs de l’archipel de Port-Royal firent preuve d’une complète unanimité dans
leurs sentimens de haine envers les gens du Nord et d’un dévouement absolu à la cause
qu’ils avaient embrassée. Appartenant à une caste de grands seigneurs qui se targuent
d’une noble origine et qui méprisent souverainement les classes ouvrières et mercantiles
de la Nouvelle-Angleterre, les habitants de Beaufort ne voulurent pas même se trouver en
contact avec leurs vainqueurs et s’empressèrent de quitter l’archipel, accompagnés de
leurs familles et de leur suite de Petits Blancs. En cette occasion, ils donnèrent un exemple
qui a été peu suivi dans les États esclavagistes conquis par les Fédéraux : ils mirent le feu
à leur coton, détruisirent tout ce qu’ils ne pouvaient pas emporter, commencèrent euxmêmes
à saccager leurs demeures, et s’ils laissèrent sur pied les récoltes de coton déjà
presque mûres, ce fut uniquement parce qu’ils n’eurent pas le temps de les ravager.
Toutefois il leur restait leur fortune vivante consistant en mulets, en bestiaux et surtout
en esclave. Avant l’arrivée de la flotte fédérale, des planteurs avaient déjà expédié sur le
continent une partie de leurs Nègres, d’autres en avaient prêté au gouvernement de l’État
pour la construction des remparts de Charleston. Mais la majorité des esclaves se
trouvaient encore dans l’archipel lorsque les forts de Port-Royal tombèrent entre les mains
des Yankees. Aussitôt les planteurs songèrent à la retraite. Choisissant d’abord leurs
esclaves les plus robustes et les plus adroits, ceux dont les bras ou l’intelligence
représentaient le plus fort capital, ils les poussèrent devant eux.
Plus d’une fois, si l’on en croit le témoignage unanime des Noirs, ils firent usage de
leurs carabines pour abattre les malheureux qui tâchaient de s’enfuir. Quoi qu’il en soit,
l’approche des troupes fédérales ne permit pas aux sécessionnistes d’emmener tous leurs
esclaves. La plupart des domestiques vieux ou infirmes et les enfants en bas âge, qui
n’avaient qu’une faible valeur monétaire furent abandonnés dans les cases. Parmi les
esclaves des champs, un grand nombre trouvèrent le moyen de se cacher et ne se
montrèrent qu’après le départ de leurs maîtres car ils leur racontaient que le seul but des
féroces Yankees était de les vendre à des planteurs cubains. Dans leur incertitude, les
malheureux préféraient rester sur les plantations, attendant leur destinée dans le voisinage
des cases qui constituaient leur unique foyer. Ils avaient au moins cette triste consolation,
que dans aucun cas les nouveaux venus ne leur imposeraient une condition plus dure que
celle de leur précédent esclavage. On évalue à quelque huit mille le nombre des Noirs qui
restèrent à Beaufort après la fuite de leurs propriétaires. Après avoir pris possession des
forts, William T. Sherman qui, à ce moment-là, commande les forces de l’Union en
Caroline du Sud, émit une proclamation destinée aux Blancs de cet État. Dans ce
manifeste, conçu dans des termes très modérés, il adopta un raisonnement purement
constitutionnel qui l’obligeait encore à ne pas nier la légalité de l’esclavage. Il déclara
donc qu’il ne voulait en aucune manière léser les droits et les privilèges des citoyens ou
de s’immiscer dans leurs institutions locales et sociales, et protesta de son dévouement
respectueux envers le grand État souverain de la Caroline du Sud. Néanmoins, Sherman
affirma aussi que le devoir constitutionnel de sauvegarder l’Union primait tous les autres,
et que le maintien des lois spéciales de l’État devait être subordonné aux nécessités
militaires créées par l’insurrection. En dépit de cette affirmation menaçante, il n’en reste
pas moins qu’il se croyait encore tenu de respecter la loi sur les esclaves fugitifs.