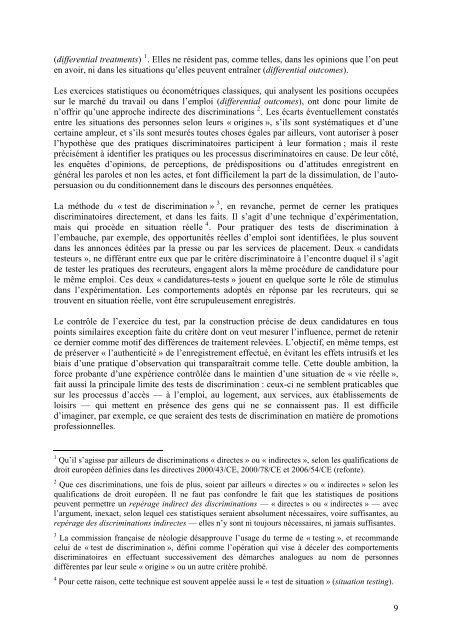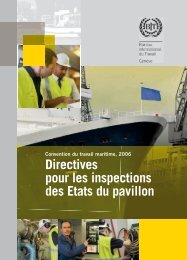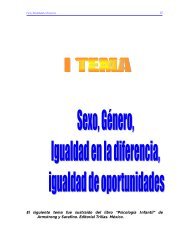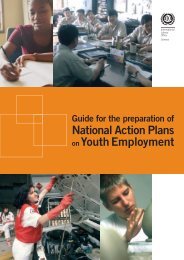testing - International Labour Organization
testing - International Labour Organization
testing - International Labour Organization
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(differential treatments) 1 . Elles ne résident pas, comme telles, dans les opinions que l’on peut<br />
en avoir, ni dans les situations qu’elles peuvent entraîner (differential outcomes).<br />
Les exercices statistiques ou économétriques classiques, qui analysent les positions occupées<br />
sur le marché du travail ou dans l’emploi (differential outcomes), ont donc pour limite de<br />
n’offrir qu’une approche indirecte des discriminations 2 . Les écarts éventuellement constatés<br />
entre les situations des personnes selon leurs « origines », s’ils sont systématiques et d’une<br />
certaine ampleur, et s’ils sont mesurés toutes choses égales par ailleurs, vont autoriser à poser<br />
l’hypothèse que des pratiques discriminatoires participent à leur formation ; mais il reste<br />
précisément à identifier les pratiques ou les processus discriminatoires en cause. De leur côté,<br />
les enquêtes d’opinions, de perceptions, de prédispositions ou d’attitudes enregistrent en<br />
général les paroles et non les actes, et font difficilement la part de la dissimulation, de l’autopersuasion<br />
ou du conditionnement dans le discours des personnes enquêtées.<br />
La méthode du « test de discrimination » 3 , en revanche, permet de cerner les pratiques<br />
discriminatoires directement, et dans les faits. Il s’agit d’une technique d’expérimentation,<br />
mais qui procède en situation réelle 4 . Pour pratiquer des tests de discrimination à<br />
l’embauche, par exemple, des opportunités réelles d’emploi sont identifiées, le plus souvent<br />
dans les annonces éditées par la presse ou par les services de placement. Deux « candidats<br />
testeurs », ne différant entre eux que par le critère discriminatoire à l’encontre duquel il s’agit<br />
de tester les pratiques des recruteurs, engagent alors la même procédure de candidature pour<br />
le même emploi. Ces deux « candidatures-tests » jouent en quelque sorte le rôle de stimulus<br />
dans l’expérimentation. Les comportements adoptés en réponse par les recruteurs, qui se<br />
trouvent en situation réelle, vont être scrupuleusement enregistrés.<br />
Le contrôle de l’exercice du test, par la construction précise de deux candidatures en tous<br />
points similaires exception faite du critère dont on veut mesurer l’influence, permet de retenir<br />
ce dernier comme motif des différences de traitement relevées. L’objectif, en même temps, est<br />
de préserver « l’authenticité » de l’enregistrement effectué, en évitant les effets intrusifs et les<br />
biais d’une pratique d’observation qui transparaîtrait comme telle. Cette double ambition, la<br />
force probante d’une expérience contrôlée dans le maintien d’une situation de « vie réelle »,<br />
fait aussi la principale limite des tests de discrimination : ceux-ci ne semblent praticables que<br />
sur les processus d’accès — à l’emploi, au logement, aux services, aux établissements de<br />
loisirs — qui mettent en présence des gens qui ne se connaissent pas. Il est difficile<br />
d’imaginer, par exemple, ce que seraient des tests de discrimination en matière de promotions<br />
professionnelles.<br />
1 Qu’il s’agisse par ailleurs de discriminations « directes » ou « indirectes », selon les qualifications de<br />
droit européen définies dans les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2006/54/CE (refonte).<br />
2 Que ces discriminations, une fois de plus, soient par ailleurs « directes » ou « indirectes » selon les<br />
qualifications de droit européen. Il ne faut pas confondre le fait que les statistiques de positions<br />
peuvent permettre un repérage indirect des discriminations — « directes » ou « indirectes » — avec<br />
l’argument, inexact, selon lequel ces statistiques seraient absolument nécessaires, voire suffisantes, au<br />
repérage des discriminations indirectes — elles n’y sont ni toujours nécessaires, ni jamais suffisantes.<br />
3 La commission française de néologie désapprouve l’usage du terme de « <strong>testing</strong> », et recommande<br />
celui de « test de discrimination », défini comme l’opération qui vise à déceler des comportements<br />
discriminatoires en effectuant successivement des démarches analogues au nom de personnes<br />
différentes par leur seule « origine » ou un autre critère prohibé.<br />
4 Pour cette raison, cette technique est souvent appelée aussi le « test de situation » (situation <strong>testing</strong>).<br />
9