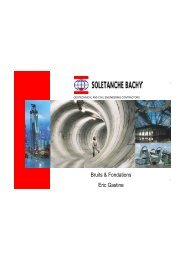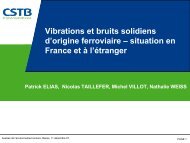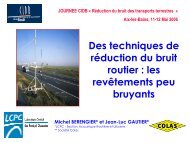Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Les points qui font débat<br />
Parmi les points abordés dans le gui<strong>de</strong>, un certain nombre<br />
doivent encore faire l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> discussions mais, bien<br />
évi<strong>de</strong>mment, dans la version 2005 du document, ces points<br />
auront trouvé réponse. Il s’agit, d’une part, <strong>de</strong> préciser ce<br />
qu’on entend par « la faça<strong>de</strong> la plus exposée ». Les cartes<br />
<strong>de</strong> bruit stratégiques doivent être évaluées sur la faça<strong>de</strong> la<br />
plus exposée <strong>de</strong>s bâtiments, mais la directive en donne une<br />
définition plutôt géométrique, à savoir « la faça<strong>de</strong> qui, au<br />
regard <strong>de</strong> l’infrastructure, est la plus proche <strong>de</strong> celle-ci ».<br />
Or, le groupe <strong>de</strong> travail a jugé qu’une définition acoustique<br />
serait plus adaptée <strong>et</strong> qu’il convenait <strong>de</strong> prendre la faça<strong>de</strong><br />
réellement exposée au niveau sonore le plus élevé. Le<br />
<strong>de</strong>uxième point <strong>de</strong> discussion concerne la localisation <strong>de</strong>s<br />
points d’évaluation. Que dit la directive ? Il faut évaluer les<br />
niveaux <strong>sonores</strong> sur la faça<strong>de</strong> la plus exposée en vue <strong>de</strong><br />
déterminer la population exposée par plages <strong>de</strong> niveaux<br />
<strong>sonores</strong>. Pour déterminer les faça<strong>de</strong>s calmes, il faut évaluer<br />
les niveaux <strong>sonores</strong> à 2 mètres en avant <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s. Pour<br />
évaluer les superficies <strong>de</strong>s espaces exposés, il faut évaluer<br />
les niveaux <strong>sonores</strong> en champ libre dans l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
espaces, indépendamment <strong>de</strong>s bâtiments. Autrement dit, si<br />
l’on s’en tient à la stricte lecture <strong>de</strong> la directive, pour<br />
évaluer le niveau sonore en chacun <strong>de</strong> ces points, il faut<br />
réaliser trois séries <strong>de</strong> calculs. Le groupe <strong>de</strong> travail, pour sa<br />
part, recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> ne faire qu’une seule série <strong>de</strong> calculs,<br />
mais en prenant en compte toutes les réflexions, pour<br />
l’évaluation <strong>de</strong>s niveaux <strong>sonores</strong> sur les faça<strong>de</strong>s les plus<br />
exposées <strong>et</strong> pour évaluer les niveaux à 2 m ; le groupe<br />
préconise enfin <strong>de</strong> r<strong>et</strong>irer 3 dB pour correspondre à un<br />
niveau sonore en champ libre <strong>et</strong> ainsi se conformer à<br />
l’indicateur L <strong>de</strong>n <strong>de</strong>mandé.<br />
On est aussi en plein débat sur l’estimation <strong>de</strong>s populations.<br />
Les populations sont réparties dans les bâtiments, lesquels<br />
occupent une superficie <strong>et</strong> un volume en trois dimensions.<br />
La directive <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’évaluer les niveaux <strong>sonores</strong> à<br />
laquelle la population est exposée. L’ennui, c’est qu’elle<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> ne considérer qu’un seul point récepteur, situé<br />
sur la faça<strong>de</strong> la plus exposée d’un bâtiment, à 4 m <strong>de</strong><br />
hauteur. Comment affecte-t-on une population à un<br />
récepteur unique, sachant que le bruit se propage dans<br />
l’espace ? Sur ce point, le groupe <strong>de</strong> travail suggère <strong>de</strong><br />
déterminer <strong>de</strong>s ratios <strong>de</strong> population par m 2 , ou d’utiliser <strong>de</strong>s<br />
ratios officiels <strong>de</strong> population par m 2 , puis d’appliquer ces<br />
ratios à la surface estimée <strong>de</strong> chaque bâtiment multipliée<br />
par le nombre d’étages.<br />
Un autre point <strong>de</strong> la directive qui est remis en question <strong>et</strong><br />
qui, c<strong>et</strong>te fois-ci, ne bénéficie pas encore <strong>de</strong><br />
recommandations, concerne les zones calmes. C’est un suj<strong>et</strong><br />
difficile qui a donné lieu à un premier rapport en 2003<br />
réalisé par un bureau d’étu<strong>de</strong> britannique. Faute <strong>de</strong><br />
définitions satisfaisantes émanant <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong>, il a été<br />
décidé <strong>de</strong> réaliser un bilan <strong>de</strong>s pratiques en matière <strong>de</strong><br />
définition <strong>et</strong> d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s zones calmes dans les pays<br />
ayant mis en œuvre c<strong>et</strong>te notion. Pour compléter ce travail,<br />
en 2004, une réunion entre le groupe WG-AEN <strong>et</strong> le groupe<br />
Santé <strong>et</strong> aspects socioéconomiques (WG-H & SEA) a permis<br />
d’élargir notre point <strong>de</strong> vue à <strong>de</strong>s considérations davantage<br />
teintées d’aspects socioéconomiques. Des idées<br />
intéressantes sont apparues <strong>et</strong> seront probablement reprises<br />
dans les recommandations que produira le groupe, mais,<br />
pour l’instant, aucune définition n’a émergé. Tout porte à<br />
croire que l’on s’oriente vers plusieurs définitions : l’une<br />
basée sur l’acoustique <strong>et</strong> l’autre sur l’usage <strong>de</strong>s espaces.<br />
Pour la définition acoustique, se posent notamment<br />
quelques interrogations. Faut-il recomman<strong>de</strong>r l’usage <strong>de</strong><br />
l’indicateur L <strong>de</strong>n ? Faut-il distinguer les trois pério<strong>de</strong>s — jour,<br />
soirée, nuit —, qui correspondraient à une occupation réelle<br />
<strong>de</strong> ces zones calmes ? Faut-il préconiser l’utilisation <strong>de</strong><br />
niveaux <strong>sonores</strong> absolus ? Ou plutôt recomman<strong>de</strong>r une<br />
émergence sonore par rapport au bruit ambiant, avec un<br />
dépassement <strong>de</strong> certains seuils pendant certaines pério<strong>de</strong>s ?<br />
Toutes ces questions restent encore en suspens.<br />
État d’avancement <strong>de</strong>s travaux<br />
Où en est le gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> bonne pratique ? Les travaux<br />
s’appuient d’ores <strong>et</strong> déjà sur l’enquête lancée en 2004. Une<br />
nouvelle étu<strong>de</strong>, lancée en octobre 2004 <strong>et</strong> dont<br />
l’achèvement est prévu pour février 2005, vise à compléter<br />
le gui<strong>de</strong>, d’une part, par <strong>de</strong> nouveaux outils couvrant les<br />
domaines non encore pris en compte <strong>et</strong>, d’autre part, à<br />
quantifier l’impact <strong>de</strong>s solutions proposées. L’idée consiste<br />
à évaluer la précision <strong>de</strong>s données d’entrée au moyen <strong>de</strong><br />
valeurs chiffrées, <strong>et</strong> non <strong>de</strong> simples signes +++ <strong>et</strong> ---.<br />
Parmi les éléments envisagés dans la nouvelle version du<br />
gui<strong>de</strong>, figurent <strong>de</strong>s outils relatifs à la prise en compte <strong>de</strong>s<br />
revêtements <strong>de</strong> chaussée. Il s’agit <strong>de</strong> préciser quelles sont<br />
les hypothèses à prendre quand on ne connaît pas les<br />
revêtements <strong>de</strong> chaussée, quand on connaît mal la<br />
topographie <strong>de</strong>s sites, quand on ne sait pas estimer les<br />
hauteurs d’écrans à proximité <strong>de</strong>s infrastructures ou quand<br />
on ne connaît pas précisément la pente <strong>de</strong> l’infrastructure<br />
étudiée. De fait, tous ces éléments influent sensiblement sur<br />
la propagation.<br />
Quel impact en France d’un tel document ?<br />
L’utilisation <strong>de</strong> ce gui<strong>de</strong> dans les différents Etats membres<br />
ne sera pas obligatoire. Néanmoins, il est envisagé d’adapter<br />
ce gui<strong>de</strong> européen au contexte national français, en y<br />
convoquant les données <strong>et</strong> recommandations dont on dispose<br />
sur les spécificités françaises. C<strong>et</strong>te adaptation serait<br />
intégrée dans un Gui<strong>de</strong> méthodologique pour la réalisation<br />
<strong>de</strong>s cartes <strong>de</strong> bruit stratégiques commandité par le<br />
ministère <strong>de</strong> l’Ecologie <strong>et</strong> du Développement durable.<br />
Destiné essentiellement aux collectivités locales, ce gui<strong>de</strong><br />
aura une portée large puisqu’il intègrera non seulement la<br />
prise en compte <strong>de</strong>s données d’entrée <strong>de</strong>s modèles mais<br />
également les métho<strong>de</strong>s envisageables, les outils disponibles<br />
pour m<strong>et</strong>tre en œuvre ces métho<strong>de</strong>s, <strong>et</strong> les<br />
recommandations sur la façon <strong>de</strong> produire les cartes. Tout<br />
ceci pour savoir répondre à la question suivante : quelles<br />
cartes fait-on, pour quels usages, comment les présente-t-on<br />
au public <strong>et</strong> comment les utilise-t-on pour élaborer les plans<br />
d’action ? Enfin, ce gui<strong>de</strong> sera complété par la présentation<br />
<strong>de</strong> quelques expériences existantes en France ou en Europe.<br />
Pour 2005, est donc prévue une nouvelle version du gui<strong>de</strong><br />
européen ; une première version du gui<strong>de</strong> français est<br />
prévue pour 2006.<br />
Le programme européen GIpSynoise : complémentarité entre calculs <strong>et</strong><br />
mesures ; stratégie <strong>de</strong> communication pour les cartographies du bruit<br />
Julie Vall<strong>et</strong> (Grand Lyon)<br />
Je suis en charge, au sein <strong>de</strong> la Communauté urbaine <strong>de</strong><br />
Lyon, du proj<strong>et</strong> GIpSynoise <strong>et</strong> <strong>de</strong> la cartographie du bruit sur<br />
l’agglomération lyonnaise. Sont également associés à ce<br />
proj<strong>et</strong> GIpSynoise, Jacques Lambert, <strong>de</strong> l’Inr<strong>et</strong>s, Christine<br />
Aujard, <strong>de</strong> la société 01dB-Métravib, Bruno Vincent, qui<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005 PAGE 113