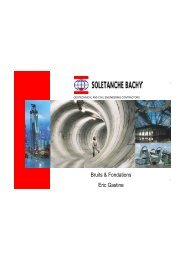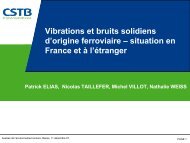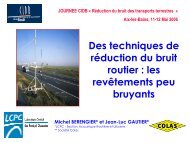Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
lyonnaise ; certains lundis, ces mesures révèlent <strong>de</strong>s<br />
amplitu<strong>de</strong>s étonnantes entre le jour <strong>et</strong> la nuit, <strong>de</strong> presque<br />
12 dB, alors que certains samedis, c<strong>et</strong> écart jour-nuit est à<br />
peine <strong>de</strong> 3 dB. On imagine bien, sur le plan <strong>de</strong> la perception,<br />
toute la variabilité <strong>de</strong> l’environnement sonore à laquelle<br />
peut être confronté un habitant d’un site <strong>de</strong> ce type.<br />
Pourtant, une cartographie basée sur <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> trafic<br />
moyen ne restituera qu’un indice moyen. C’st la raison pour<br />
laquelle le Grand Lyon a pris la décision <strong>de</strong> se doter d’un<br />
observatoire métrologique permanent.<br />
Vali<strong>de</strong>r <strong>et</strong> renforcer la légitimité <strong>et</strong> la précision <strong>de</strong>s<br />
calculs par la mesure<br />
Un tel observatoire présente plusieurs avantages. Il perm<strong>et</strong> :<br />
<strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> la variabilité temporelle <strong>et</strong><br />
contextuelle du bruit ; d’évaluer <strong>et</strong> d’envisager <strong>de</strong>s solutions<br />
aux bruits événementiels <strong>de</strong> type trafic ou chantier ; <strong>de</strong><br />
mener une exploitation épidémiologique, par le couplage,<br />
notamment, sur certains sites <strong>de</strong> l’agglomération, avec le<br />
réseau Coparly d’observation permanente <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong><br />
l’air à Lyon ; d’adopter une démarche “patrimoniale”<br />
consistant à suivre le bruit <strong>de</strong> fond <strong>et</strong> les ambiances <strong>sonores</strong><br />
sur le très long terme, afin <strong>de</strong> décrire l’existant <strong>et</strong> <strong>de</strong> le<br />
sauvegar<strong>de</strong>r ; <strong>de</strong> faciliter l’information <strong>et</strong> la communication<br />
avec le public, puisque nombre d’étu<strong>de</strong>s le disent plus<br />
sensible <strong>et</strong> confiant dans la mesure que dans le calcul.<br />
Les points <strong>de</strong> mesure r<strong>et</strong>enus se répartissent en trois<br />
familles. Les mesures permanentes sont réservées à <strong>de</strong>s<br />
zones urbaines dites “représentatives” : zones très<br />
dégradées (situations critiques), zones conflictuelles, zones<br />
sensibles (écoles, hôpitaux…), réserves <strong>de</strong> silence, zones<br />
calmes, parcs, lieux emblématiques. La <strong>de</strong>uxième famille<br />
correspond à <strong>de</strong>s mesures réalisées sur le long terme, en<br />
amont <strong>de</strong> proj<strong>et</strong>s d’aménagement ? Enfin, les mesures à<br />
court terme, sur une ou plusieurs semaines, s’adresseront à<br />
<strong>de</strong>s circonstances plus évènementielles : chantier,<br />
événement festif, ou expériences (journée sans voiture,<br />
zone « 30 », <strong>et</strong>c.).<br />
Reste évi<strong>de</strong>mment à définir l’articulation entre les données<br />
issues du proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> cartographie conforme à la directive<br />
européenne <strong>et</strong> celles fournies par le proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> réseau<br />
permanent <strong>de</strong> mesures du bruit.<br />
Les attentes du grand public en matière <strong>de</strong> cartographie<br />
du bruit<br />
Je vais présenter maintenant les résultats du vol<strong>et</strong><br />
communication du proj<strong>et</strong> GIpSynoise, qui a été<br />
principalement mené par l’Inr<strong>et</strong>s (je m’exprime ici en<br />
remplacement <strong>de</strong> Jacques Lambert, qui n’a pu être présent<br />
aujourd’hui).<br />
Il y a au moins trois bonnes questions à se poser quand on<br />
souhaite informer au moyen <strong>de</strong> cartes <strong>de</strong> bruit : sur quoi<br />
veut-on communiquer ? comment se faire comprendre ? avec<br />
quelle crédibilité ? Pour progresser sur ces questions, l’Inr<strong>et</strong>s<br />
s’est interrogé sur la nature, la présentation, la qualité <strong>et</strong><br />
les modalités <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong>s informations liées aux cartes<br />
<strong>de</strong> bruit stratégiques. Afin <strong>de</strong> tenter <strong>de</strong> décrypter les<br />
principales attentes du public, une enquête auprès <strong>de</strong><br />
citadins du Grand Lyon a été menée. Les entr<strong>et</strong>iens ont<br />
porté sur le contenu <strong>de</strong>s cartes, leur présentation,<br />
l’accessibilité à l’information, l’utilité <strong>de</strong>s cartes <strong>et</strong> les<br />
impacts <strong>de</strong> la publication <strong>de</strong>s cartes. Malgré une faible<br />
connaissance <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> supports, l’échantillon interrogé<br />
exprime un intérêt fort pour ce type d’information. Les<br />
résultats <strong>de</strong> l’enquête expriment une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sociale forte<br />
pour : <strong>de</strong>s cartes à zones dynamiques, incluant les plans<br />
d’actions ; <strong>de</strong>s cartes parlantes, claires <strong>et</strong> ludiques,<br />
comportant un nombre limité <strong>de</strong> couleurs mais <strong>de</strong>s légen<strong>de</strong>s<br />
explicatives précises <strong>et</strong> un lien avec les eff<strong>et</strong>s du bruit sur la<br />
santé ; <strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong> bruit exprimés à l’échelle <strong>de</strong> la ville,<br />
du quartier <strong>et</strong> <strong>de</strong> la rue ; <strong>de</strong>s cartes du bruit <strong>de</strong>s transports<br />
mais aussi <strong>de</strong> l’industrie <strong>et</strong> <strong>de</strong>s travaux publics ; <strong>de</strong>s cartes<br />
distinguant le jour, la soirée <strong>et</strong> la nuit.<br />
Autre enseignement <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te enquête, Intern<strong>et</strong> est pressenti<br />
comme un bon support, mais <strong>de</strong>s documents papiers en<br />
mairie, voire même en agence immobilière, <strong>et</strong> <strong>de</strong>s bornes<br />
interactives dans les bâtiments administratifs, seraient<br />
également appréciés. Il apparaît aussi que les personnes<br />
interrogées envisagent <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r leurs choix d’habitation <strong>et</strong><br />
<strong>de</strong> lieux <strong>de</strong> loisirs sur ces cartes <strong>de</strong> bruit. Enfin, <strong>de</strong>rnier<br />
élément, les personnes enquêtées soulignent l’impact d’une<br />
cartographie du bruit sur le marché immobilier local <strong>et</strong> sur<br />
l’augmentation <strong>de</strong> la prise <strong>de</strong> conscience du public, en tant<br />
qu’outil <strong>de</strong> pression sur les autorités locales.<br />
Julie Vall<strong>et</strong><br />
Quelles sont donc les gran<strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong> l’évaluation <strong>et</strong> <strong>de</strong> la<br />
gestion du bruit dans l’environnement, au sens <strong>de</strong> la<br />
directive ? Tout d’abord, évaluer la situation présente, en<br />
i<strong>de</strong>ntifiant notamment les zones calmes à protéger <strong>et</strong> les<br />
zones bruyantes à forte population. Puis, définir les<br />
scénarios, par <strong>de</strong>s simulations d’actions <strong>de</strong> prévention <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
résorption <strong>de</strong>s zones bruyantes à forte population. Définir<br />
ensuite les plans d’action, en hiérarchisant les actions. À ce<br />
sta<strong>de</strong>, la concertation s’impose : celle-ci suppose la<br />
présentation au public <strong>de</strong>s zones bruyantes à traiter <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />
scénarios d’action envisagés. Après prise en compte <strong>de</strong>s<br />
remarques du public, on réalise <strong>de</strong>s documents “partagés”<br />
<strong>de</strong> planification à un horizon <strong>de</strong> cinq ans. Enfin, si possible,<br />
il serait intéressant <strong>de</strong> réévaluer les actions pour<br />
éventuellement les faire repasser par les étapes du<br />
processus, s’il y a besoin <strong>de</strong> les compléter.<br />
Conclusions<br />
La démarche du Grand Lyon est résolument ancrée dans<br />
l’association simultanée <strong>de</strong>s mesures <strong>et</strong> du calcul. Un<br />
constat : la gestion du bruit urbain nécessite une<br />
coopération renforcée entre services (acousticiens,<br />
urbanistes, informaticiens, déplacement, communication). À<br />
Lyon, la communication sera programmée très en amont afin<br />
que la population soit prête à tirer parti <strong>de</strong>s cartes <strong>de</strong> bruit<br />
lorsque celles-ci seront diffusées.<br />
Une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> cartographie simplifiée adaptée à l’interurbain<br />
Francis Besnard (Service d’étu<strong>de</strong>s techniques<br />
<strong>de</strong>s routes <strong>et</strong> autoroutes)<br />
Les villes n’ont pas l’exclusivité <strong>de</strong>s nuisances <strong>sonores</strong>. En<br />
milieu rural, le long <strong>de</strong>s axes interurbains, le bruit est,<br />
hélas, bien présent. Mais, par rapport au milieu urbain, le<br />
problème est plus simple parce que la source est bien<br />
i<strong>de</strong>ntifiée. Cela offre <strong>de</strong>s possibilités d’imaginer <strong>de</strong>s<br />
approches spécifiques, dans la dimension transversale.<br />
Définition <strong>de</strong>s grands axes routiers<br />
Au sens <strong>de</strong> la directive <strong>de</strong> juin 2002, un grand axe routier est<br />
une route régionale, nationale ou internationale dont le<br />
trafic annuel est supérieur à 3 millions <strong>de</strong> véhicules. Ce qui<br />
représente une moyenne <strong>de</strong> 8200 véhicules par jour, ou <strong>de</strong> 8<br />
véhicules par minute en journée, soit l’ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong><br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005 PAGE 115