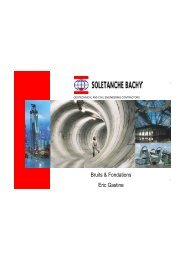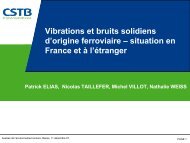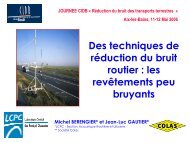Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
à travers la plate-forme pour atteindre le sol ; différents<br />
types <strong>de</strong> pose <strong>de</strong> voie sont à envisager ici. Ensuite, vient le<br />
calcul <strong>de</strong> l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> propagation. Enfin, on étudie le<br />
couplage entre le sol <strong>et</strong> le bâtiment, ainsi que la génération<br />
du bruit <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>ment.<br />
Pour aboutir à quelque chose <strong>de</strong> représentatif, il faudra sans<br />
doute développer un certain nombre <strong>de</strong> modèles. Pour<br />
l’heure, en revanche, rien ne perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> connaître le niveau<br />
<strong>de</strong> précision qui sera atteint au final.<br />
Les vibrations<br />
Pour faire bref, on distingue trois manières <strong>de</strong> poser <strong>de</strong>s<br />
voies. Avec la pose classique, le rail est fixé rigi<strong>de</strong>ment sur<br />
le sol par <strong>de</strong>s traverses, ce qui revient à une fixation directe<br />
dans le sol. La pose intermédiaire, dite à “-10 dBv”, consiste<br />
à intercaler un élément souple entre le rail <strong>et</strong> le sol. Que<br />
celui-ci se situe directement sous le rail ou sous la traverse,<br />
le gain avoisine les 10 dBv. La pause sur dalle flottante,<br />
enfin, repose sur le principe <strong>de</strong> la désolidarisation <strong>de</strong> la voie<br />
par rapport au sol : le rail est fixé rigi<strong>de</strong>ment sur une dalle<br />
lour<strong>de</strong>, massive, en béton armé, laquelle repose elle-même<br />
sur <strong>de</strong>s plots en élastomère. Le gain : 20 dBv.<br />
Dans le principe, le choix du type <strong>de</strong> pose dépend <strong>de</strong> la<br />
proximité <strong>de</strong>s bâtiments, les poses sophistiquées étant<br />
réservées aux cas les plus défavorables. Mais les règles<br />
guidant ces choix restent aujourd’hui extrêmement<br />
empiriques : à moins <strong>de</strong> 7 m d’une habitation, on utilise une<br />
dalle flottante ; entre 7 <strong>et</strong> 12 m, on adopte la pose<br />
intermédiaire ; au <strong>de</strong>là, on pose <strong>de</strong> manière classique. Ainsi,<br />
faute <strong>de</strong> modèle <strong>de</strong> prédiction ad hoc, on prend souvent trop<br />
<strong>de</strong> précautions, ce qui coûte cher à l’arrivée.<br />
De plus, le choix du type <strong>de</strong> pose <strong>de</strong> voie n’est pas sans<br />
conséquence sur le bruit aérien. En eff<strong>et</strong>, lorsqu’un rail est<br />
posé sur <strong>de</strong>s patins souples, les vibrations engendrées par le<br />
passage <strong>de</strong>s tramways se propagent plus longtemps <strong>et</strong> plus<br />
loin, ce qui augmente le bruit émis. A contrario, lorsque le<br />
rail est fixé rigi<strong>de</strong>ment, ce phénomène reste très limité <strong>et</strong> le<br />
bruit généré au passage diminue. Ce que l’on peut gagner<br />
d’un côté, on peut le perdre d’un autre.<br />
Synthèse<br />
Dernier acte <strong>de</strong> ce proj<strong>et</strong>, la synthèse tentera <strong>de</strong> répondre<br />
aux <strong>de</strong>ux objectifs déjà mentionnés : m<strong>et</strong>tre en évi<strong>de</strong>nce les<br />
situations susceptibles <strong>de</strong> créer une gêne chez les riverains ;<br />
en déduire <strong>de</strong>s recommandations <strong>de</strong>vant perm<strong>et</strong>tre aux<br />
déci<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> mieux intégrer la composante bruit <strong>et</strong><br />
vibrations dans leurs décisions.<br />
Les phénomènes physiques à la base <strong>de</strong> la génération du<br />
bruit sont variés <strong>et</strong> complexes. Pour l’heure, les<br />
connaissances se résument à quelques tendances : à faible<br />
vitesse, les sources <strong>sonores</strong> situées en toiture sont les plus<br />
importantes ; à vitesse plus élevée, domine le bruit <strong>de</strong><br />
roulement ; le type <strong>de</strong> revêtement <strong>et</strong> le type <strong>de</strong> pose<br />
influent à la fois sur le bruit aérien <strong>et</strong> sur le bruit solidien.<br />
Débat<br />
Optimisation <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s : <strong>et</strong> l’absorption ?<br />
Le débat a tout d’abord permis <strong>de</strong> clarifier la portée <strong>de</strong><br />
l’étu<strong>de</strong> présentée par Judicaël Picaut sur la réflexion diffuse<br />
<strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s. Il faut tout d’abord gar<strong>de</strong>r à l’esprit que c<strong>et</strong>te<br />
étu<strong>de</strong> avait pour unique ambition d’explorer les eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> la<br />
réflexion diffuse. Dans le modèle, les faça<strong>de</strong>s sont<br />
constituées <strong>de</strong> béton <strong>et</strong> <strong>de</strong> vitres, excluant donc toute prise<br />
en compte du phénomène d’absorption. Bien entendu, dans<br />
une démarche d’optimisation <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>, ce <strong>de</strong>rnier<br />
paramètre, qui influe sur la réverbération, doit être<br />
considéré. En tout état <strong>de</strong> cause, les résultats <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> sur<br />
la réflexion diffuse n’étaient pas, à la date <strong>de</strong> ces assises,<br />
directement exploitables par les architectes ou les<br />
urbanistes.<br />
À signaler, sur ce suj<strong>et</strong> <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong>s géométries <strong>de</strong><br />
balcons sur la propagation sonore, un travail <strong>de</strong> thèse que<br />
l’on doit à Hany Hossam-el-Dien (Cerma) : ce travail s’est<br />
concentré sur les gains d’atténuation apportés par la<br />
géométrie <strong>de</strong>s balcons, notamment sur <strong>de</strong>s hauteur<br />
importantes, <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> dix étages.<br />
Pourquoi les efforts, sur le plan <strong>de</strong> l’architecture extérieure,<br />
portent-ils essentiellement sur la géométrie <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s, <strong>et</strong><br />
non pas sur leurs coefficients d’absorption ? Les matériaux<br />
absorbants <strong>de</strong> type fibreux ou poreux posent un véritable<br />
problème d’entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> <strong>de</strong> dégradation. Les architectes<br />
savent bien que la pierre calcaire doit être rénovée tous les<br />
dix ans.<br />
Les témoignages ont confirmé que l’hypothèse <strong>de</strong> la<br />
réflexion diffuse, ou tout au moins une certaine forme <strong>de</strong><br />
diffusion, était ce qui convenait le mieux à la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong><br />
la réalité du “comportement sonore” <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s d’une rue,<br />
surtout dans les fréquences médiums <strong>et</strong> aigues.<br />
Les valeurs obtenues par J. Picaut au moyen <strong>de</strong> son modèle<br />
<strong>de</strong> réverbération ont montré une forte sensibilité aux<br />
différentes lois <strong>de</strong> réflexions testées. Une explication à<br />
cela : le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> calculs basé sur les particules <strong>sonores</strong> est<br />
fortement lié au nombre <strong>de</strong> particules qui sont insérées dans<br />
le milieu considéré. Fait important, pour s‘assurer <strong>de</strong> la<br />
validité <strong>de</strong>s résultats, un travail préliminaire d’optimisation<br />
<strong>de</strong>s paramètres du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul (pas <strong>de</strong> temps, nombre <strong>de</strong><br />
mailles, nombre <strong>de</strong> particules) <strong>et</strong> <strong>de</strong> validation <strong>de</strong> ce co<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> calcul a été mené préalablement à l’exploitation du<br />
modèle. Les résultats préliminaires ont été comparés à <strong>de</strong>s<br />
données issues <strong>de</strong> la littérature basées sur l’utilisation<br />
d’autres outils <strong>de</strong> simulations.<br />
Propagation à gran<strong>de</strong> distance : où s’arrêter,<br />
tant en distance qu’en fréquence ?<br />
La présentation <strong>de</strong> Fabrice Junker sur la propagation à<br />
gran<strong>de</strong> distance a soulevé une question relative aux limites<br />
adoptées pour l’étu<strong>de</strong>, tant en distance — pourquoi 1<br />
km seulement ? — qu’en fréquence — pourquoi se limiter à<br />
50 Hz ? En eff<strong>et</strong>, dans le domaine éolien notamment, l’étu<strong>de</strong><br />
d’impact doit porter sur <strong>de</strong>s distances bien plus élevées <strong>et</strong><br />
tenir compte <strong>de</strong>s très basses fréquences. Comment donc se<br />
justifie ce seuil <strong>de</strong>s 1 km adopté par l’équipe <strong>de</strong> recherche ?<br />
Tout d’abord par le niveau <strong>de</strong> précision visé : au <strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
1000 mètres, les prévisions sont immanquablement<br />
entachées d’une forte variabilité. Ensuite, avec les<br />
équations paraboliques, qui dit plus gran<strong>de</strong> distance, dit<br />
augmentation <strong>de</strong>s tailles <strong>de</strong> maillage <strong>et</strong> <strong>de</strong>s temps <strong>de</strong><br />
calculs. En outre, l’un <strong>de</strong>s credo associé à c<strong>et</strong>te démarche,<br />
c’est qu’une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sensibilité jusqu’à 1000 m contribuera<br />
déjà largement à améliorer la connaissance du<br />
comportement d’un nombre substantiel <strong>de</strong> paramètres. Il ne<br />
faut pas non plus perdre <strong>de</strong> vue que l’un <strong>de</strong>s buts poursuivis<br />
à travers ce proj<strong>et</strong>, c’est aussi d’alimenter le travail mené<br />
par les comités <strong>de</strong> normalisation. Enfin, dans les très basses<br />
fréquences, 20 Hz par exemple, les eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> sol <strong>et</strong> autres<br />
PAGE 62<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005