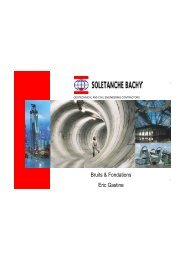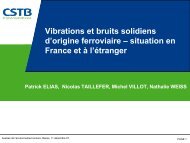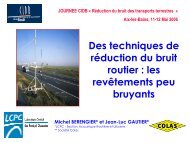Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
léger par exemple ? Dans certains cas, la pompe peut<br />
générer <strong>de</strong>s vibrations si la chaudière est, par exemple,<br />
fixée sur une paroi assez légère. Il est possible <strong>de</strong> trouver<br />
<strong>de</strong>s solutions <strong>de</strong> découplage <strong>de</strong> la chaudière pour la fixation<br />
sur la paroi.<br />
Michel Villot : Tout dépend <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> ces poses<br />
structurales. Il est évi<strong>de</strong>nt que, dans le cas d’une fixation<br />
standard qui ne laisserait pratiquement rien passer, il ne<br />
serait pas nécessaire <strong>de</strong> mesurer. Mais je tiens à préciser<br />
que le proj<strong>et</strong> actuel <strong>de</strong> norme est limité à <strong>de</strong>s poses sur<br />
parois relativement lour<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 100 kg/m 2 , même<br />
si les limites d’application sont en <strong>de</strong>çà <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te valeur. La<br />
norme <strong>de</strong> caractérisation sur <strong>de</strong>s parois légères, beaucoup<br />
plus difficile, se fera dans un <strong>de</strong>uxième temps. La métho<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> prévision, justement, précise comment adapter les<br />
résultats à <strong>de</strong>s parois plus minces, <strong>et</strong> prévient également<br />
qu’il ne faut aller trop bas.<br />
Mathias Meisser : La logique voudrait que l’on s’arrête à 150<br />
kg/m 2 . En eff<strong>et</strong>, si l’on considère le comportement <strong>de</strong> la<br />
paroi aux bruits aériens, la frontière entre une paroi lour<strong>de</strong><br />
<strong>et</strong> une paroi légère se situe à 150 kg/m 2 . L’avantage d’une<br />
telle norme correspondant à <strong>de</strong>s fixations sur parois<br />
relativement lour<strong>de</strong>s est d’inciter, lors <strong>de</strong> la conception, à<br />
ne pas placer ces matériaux sur <strong>de</strong>s parois plus légères. En<br />
attendant qu’on en sache plus.<br />
La caractérisation acoustique <strong>de</strong>s produits<br />
Quelle précision pour les caractéristiques <strong>de</strong>s<br />
produits ?<br />
Mathias Meisser : L’intervention <strong>de</strong> M. Villot a servi <strong>de</strong><br />
transition entre la prévision <strong>et</strong> la mesure <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques qui servent <strong>de</strong> données d’entrée aux<br />
métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prévision. D’ailleurs, dans le principe, les<br />
normes <strong>de</strong> prévision ne sont autres que le passage <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques <strong>de</strong>s produits vers les caractéristiques <strong>de</strong>s<br />
bâtiments. Pour caractériser les produits, on effectue donc<br />
<strong>de</strong>s tests en laboratoire, mais pas seulement, <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s<br />
statistiques existent également — je pense à la loi <strong>de</strong> masse<br />
qui est souvent utilisée. Les mesures en laboratoires portent<br />
sur <strong>de</strong>s éléments dont on connaît un certain nombre <strong>de</strong><br />
caractéristiques. Une paroi en béton <strong>de</strong> 16 cm, par exemple,<br />
aura, en laboratoire, un indice d’affaiblissement acoustique<br />
R W +C voisin <strong>de</strong> 56 dB. Mais, sur site, dans un bâtiment en<br />
fonction, c<strong>et</strong>te valeur connaît une certaine dispersion qui<br />
n’est pas maîtrisée.<br />
Michel Villot : Pour passer du laboratoire aux conditions in<br />
situ, on dispose tout <strong>de</strong> même <strong>de</strong> certains moyens <strong>de</strong><br />
maîtriser l’incertitu<strong>de</strong>. Par exemple, quand on teste une<br />
paroi en laboratoire, on mesure son temps <strong>de</strong> réverbération<br />
structurale, qui traduit les écoulements d’énergie <strong>de</strong> la<br />
paroi sur sa structure réceptrice. Sur site, le temps <strong>de</strong><br />
réverbération structurale mesuré in situ perm<strong>et</strong> également<br />
d’effectuer <strong>de</strong>s corrections.<br />
Mathias Meisser : Certes, mais la valeur laboratoire, compte<br />
tenu <strong>de</strong> tous ces éléments annexes, avec quelle précision<br />
est-elle connue ?<br />
Michel Villot : Cela dépend du laboratoire, du type <strong>de</strong><br />
produit, beaucoup d’éléments entrent en jeu.<br />
Mathias Meisser : J’ai toujours été étonné par le fait que les<br />
normes <strong>de</strong> mesure en laboratoire ou in situ ne font pas<br />
intervenir la notion d’incertitu<strong>de</strong> sur le résultat. Or, on n’est<br />
jamais certains d’avoir le bon résultat au décibel près. Qui<br />
plus est, compte tenu <strong>de</strong>s arrondis, un indice R W +C <strong>de</strong> 56 dB,<br />
ce peut aussi bien être 55,5 dB que 56,4 dB. Ces fameux<br />
arrondis sont eux aussi facteurs d’une incertitu<strong>de</strong>, qui,<br />
ajoutée à l’incertitu<strong>de</strong> sur les mesures, se traduit par une<br />
incertitu<strong>de</strong> globale qui est <strong>de</strong> l’ordre du décibel. Au final,<br />
les résultats <strong>de</strong>s logiciels <strong>de</strong> prévision s’en ressentent. Le<br />
reproche que je ferais aux normes <strong>de</strong> mesure, c’est qu’elles<br />
ne précisent pas les données d’incertitu<strong>de</strong>.<br />
De la salle : À l’époque du passage du R rose au R W +C, on s’est<br />
aperçus que, suivant le laboratoire, qu’il soit français,<br />
allemand ou anglais, on avait parfois 1 dB d’écart sur le<br />
terme correctif, celui-ci n’étant pas fixé dans la norme.<br />
Suivant la métho<strong>de</strong> mathématique, on n’obtenait pas le<br />
même résultat <strong>et</strong> on se r<strong>et</strong>rouvait avec 1 dB d’écart.<br />
Michel Villot : J’en profite pour élargir la question <strong>de</strong><br />
l’incertitu<strong>de</strong>. M. Meisser souligne la nécessité <strong>de</strong> pouvoir<br />
connaître l’incertitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong>s performances<br />
acoustiques. À ce problème, s’ajoute celui <strong>de</strong> la limite <strong>de</strong><br />
validité <strong>de</strong>s résultats, qui est fonction <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong><br />
mise en œuvre. Un exemple : les doublages sont testés en<br />
laboratoire sur <strong>de</strong>s parois d’épaisseurs bien déterminées. Il<br />
conviendrait <strong>de</strong> connaître dans quelle gamme d’épaisseurs<br />
<strong>de</strong> paroi la performance mesurée du doublage est encore<br />
valable. Cela vaut aussi pour les revêtements <strong>de</strong> sols<br />
flottants. Connaissant c<strong>et</strong>te fourch<strong>et</strong>te d’épaisseur, si on est<br />
en <strong>de</strong>hors, soit on remesure, mais cela risque <strong>de</strong> coûter<br />
cher, soit on conçoit un modèle qui donne la correction à<br />
apporter en fonction <strong>de</strong> l’épaisseur.<br />
Les cloisons en plaque <strong>de</strong> plâtre sur ossature métallique : limitation <strong>de</strong> la<br />
transmission par l’ossature<br />
Francis Bénichou (Lafarge Plâtres)<br />
Le comportement acoustique <strong>de</strong>s cloisons en plaque <strong>de</strong><br />
plâtre sur ossature métallique est bien connu <strong>de</strong>puis un<br />
certain nombre d’années. On peut classer ces systèmes en<br />
<strong>de</strong>ux, voire trois, catégories : les cloisons en plaques <strong>de</strong><br />
plâtre sur simple ossature (plaques vissées <strong>de</strong> part <strong>et</strong> d’autre<br />
d’une même ossature avec, ou sans, laine minérale) ; les<br />
cloisons acoustiques composées <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux contre cloisons<br />
indépendantes, ceci pour éviter les liaisons entre les<br />
parements opposés ; les systèmes <strong>de</strong> cloisons séparatives <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> hauteur, pourvus <strong>de</strong> liaisons acoustiques, l’objectif<br />
étant <strong>de</strong> réaliser un compromis entre comportement<br />
mécanique <strong>et</strong> performances acoustiques. Depuis trente ou<br />
quarante ans que les cloisons en plaque <strong>de</strong> plâtre existent, il<br />
restait un domaine qui n’avait pas été exploré <strong>de</strong> façon<br />
suffisamment approfondie : celui <strong>de</strong> la limitation <strong>de</strong> la<br />
transmission acoustique par l’ossature elle-même. Ces<br />
ossatures sont généralement <strong>de</strong>s profils en C, la plupart du<br />
temps en tôle mince d’acier galvanisé. La question pour<br />
nous était la suivante : y a-t-il ou non la place pour une<br />
nouvelle catégorie <strong>de</strong> cloisons, intermédiaire entre les<br />
cloisons <strong>de</strong> distribution à simple ossature <strong>et</strong> les cloisons<br />
séparatives à double ossature ? Les prescripteurs nous<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005 PAGE 87