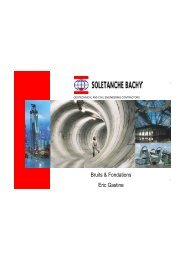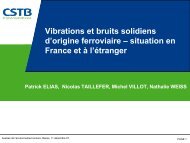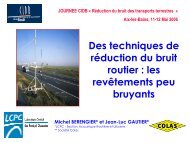Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
conditions que celles ayant permis leur obtention. Résultat :<br />
<strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> référence incompatibles qui empêchent la<br />
comparaison <strong>et</strong> l’uniformisation <strong>de</strong>s différents modèles<br />
nationaux. Qui plus est, en cas d’évolution technologique<br />
majeure, l’ensemble <strong>de</strong> la procédure doit être révisée.<br />
Dans le proj<strong>et</strong> Harmonoise, chaque source est découpée en<br />
sources élémentaires ayant chacune un mécanisme propre<br />
<strong>de</strong> génération <strong>de</strong> bruit. Dans la perspective <strong>de</strong> la mise en<br />
œuvre <strong>de</strong>s plans d’actions, c<strong>et</strong>te approche offre un avantage<br />
indéniable : il sera alors possible d’évaluer, à moindre<br />
effort, les eff<strong>et</strong>s <strong>et</strong> l’efficacité <strong>de</strong>s différentes actions<br />
envisageables <strong>et</strong> ceci séparément pour chaque composant<br />
entrant dans la génération <strong>et</strong> la propagation du bruit, sans<br />
pour autant négliger les interactions complexes entre les<br />
composants.<br />
Considérons l’exemple du bruit d’origine ferroviaire. Il se<br />
décompose en bruit <strong>de</strong> roulement, bruit <strong>de</strong> traction <strong>et</strong> bruit<br />
d’origine aérodynamique. Une maintenance contrôlée <strong>de</strong>s<br />
rails peut perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> réduire le bruit <strong>de</strong> roulement, qui<br />
est déterminé par la rugosité combinée du rail <strong>et</strong> <strong>de</strong>s roues.<br />
Mais ceci ne vaut que pour les roues relativement lisses.<br />
D’où la difficulté à évaluer l’efficacité <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te mesure<br />
particulière sans prendre en compte les autres paramètres<br />
du problème. Le modèle <strong>de</strong> sources proposé par le proj<strong>et</strong><br />
Harmonoise rend c<strong>et</strong>te évaluation aisée <strong>et</strong> rapi<strong>de</strong>, non<br />
seulement pour un train particulier (ce que l’on aurait pu<br />
obtenir à moindre coût par une mesure acoustique<br />
spécifique) mais pour l’ensemble du trafic sur la ligne<br />
concernée. Le modèle perm<strong>et</strong> également l’évaluation <strong>de</strong>s<br />
actions conjointes telles que la maintenance du rail <strong>et</strong> le<br />
remplacement <strong>de</strong> certains types <strong>de</strong> roues. A partir d’une<br />
telle évaluation, il <strong>de</strong>vient possible d’optimiser <strong>de</strong>s plans<br />
d’actions en termes <strong>de</strong> coûts (investissement global) <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
bénéfices (réduction du nombre <strong>de</strong> personnes gênées).<br />
Principes <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> Harmonoise<br />
Par le passé, plusieurs métho<strong>de</strong>s ont été qualifiées<br />
« d’intégrées », dans le sens où elles étaient basées sur un<br />
p<strong>et</strong>it nombre <strong>de</strong> formules simplifiées, obtenues par<br />
intégration explicite <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s phénomènes étudiés.<br />
Ces métho<strong>de</strong>s visaient avant tout une exploitation<br />
simplifiée, masquant la complexité réelle <strong>de</strong>s problèmes, se<br />
prêtant bien aux calculs manuels ou sur calculatrice. Dans le<br />
contexte du proj<strong>et</strong> Harmonoise, le terme « modèle intégré »<br />
désigne, au contraire, une approche modulaire. La métho<strong>de</strong><br />
d’ingénierie intègre la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la source sous forme<br />
d’un modèle indépendant, qu’il partage avec les métho<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> référence. Comme dans les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> référence, la<br />
propagation est décrite dans un module indépendant.<br />
Deux modèles <strong>de</strong> propagation<br />
En principe, les modèles <strong>de</strong> référence <strong>et</strong> le modèle<br />
d’ingénierie partagent la même <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la source ; <strong>de</strong><br />
légères différences étant liées à la prise en compte <strong>de</strong>s<br />
conditions météorologiques. La principale différence entre<br />
les <strong>de</strong>ux approches se situe au niveau <strong>de</strong> la modélisation <strong>de</strong>s<br />
eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> propagation. La métho<strong>de</strong> d’ingénierie vise un outil<br />
opérationnel pour l’utilisation à gran<strong>de</strong> échelle <strong>et</strong> favorise<br />
<strong>de</strong> ce fait <strong>de</strong>s calculs rapi<strong>de</strong>s au détriment d’une incertitu<strong>de</strong><br />
plus gran<strong>de</strong> ; les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> référence fournissent un outil<br />
complexe <strong>de</strong> haute précision, à l’usage d’experts,<br />
perm<strong>et</strong>tant une calibration <strong>et</strong> une validation rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
métho<strong>de</strong>s approchées, éliminant <strong>de</strong> ce fait le recours<br />
systématique à <strong>de</strong> larges (<strong>et</strong> coûteuses) campagnes <strong>de</strong><br />
mesure. La campagne <strong>de</strong> mesures effectuée dans le cadre du<br />
proj<strong>et</strong> Harmonoise visait en premier lieu la validation<br />
expérimentale <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s numériques. A son tour, le<br />
modèle <strong>de</strong> propagation dans la métho<strong>de</strong> d’ingénierie a été<br />
développé <strong>et</strong> validé en prenant en compte les avancées <strong>et</strong><br />
les résultats <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> référence. Les incertitu<strong>de</strong>s<br />
dues aux approximations ont été évaluées systématiquement<br />
par comparaison avec les résultats numériques.<br />
Les principaux modules du modèle<br />
d’ingénierie :<br />
• <strong>de</strong>scription d’un véhicule isolé : distribution spectrale du<br />
niveau <strong>de</strong> puissance <strong>et</strong> directivité en fonction <strong>de</strong>s<br />
paramètres <strong>de</strong> fonctionnement ;<br />
• transformation d’un flot <strong>de</strong> véhicules en une ligne <strong>de</strong><br />
source équivalente ; le niveau <strong>de</strong> puissance équivalent prend<br />
en compte, <strong>de</strong> manière statistique, la composition du flot <strong>et</strong><br />
la variabilité <strong>de</strong>s paramètres <strong>de</strong> fonctionnement ;<br />
• recherche <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong> propagation entre l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s éléments source <strong>et</strong> un récepteur donné, y compris <strong>de</strong>s<br />
chemins réfléchis sur les obstacles verticaux (murs, écrans<br />
<strong>et</strong> bâtiments) ;<br />
• modélisation <strong>de</strong> la propagation dans un chemin <strong>de</strong><br />
propagation en prenant en compte la diffraction (multiple)<br />
par les obstacles (écrans, bâtiments, terrain naturel) <strong>et</strong> les<br />
réflexions sur le sol sous <strong>de</strong>s conditions météorologiques<br />
représentatives ;<br />
• classification <strong>de</strong>s conditions météorologiques dans un<br />
nombre limité <strong>de</strong> situations typiques <strong>et</strong> représentatives ;<br />
• calcul <strong>de</strong>s indicateurs L <strong>de</strong>n <strong>et</strong> L night , effectué à partir <strong>de</strong>s<br />
niveaux <strong>sonores</strong> partiels obtenus sous différentes conditions<br />
météorologiques représentatives, pondérés suivant leur<br />
fréquence d’occurrence sur une année « moyenne » en<br />
termes climatologiques.<br />
Les résultats obtenus par le proj<strong>et</strong> Harmonoise<br />
Des métho<strong>de</strong>s applicables aux plans d’actions<br />
Le modèle générique décrit l’émission sonore <strong>de</strong>s véhicules<br />
routiers ou ferroviaires sous forme d’un nombre limité <strong>de</strong><br />
sources ponctuelles. Chaque source élémentaire peut être<br />
définie à partir <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> l’infrastructure (par<br />
exemple, le revêtement <strong>de</strong> chaussée), <strong>de</strong>s caractéristiques<br />
du véhicule (par exemple, le nombre d’essieux <strong>et</strong> le type <strong>de</strong><br />
pneus) <strong>et</strong> <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> fonctionnement (par exemple :<br />
la vitesse, l’accélération, le rapport <strong>de</strong> boîte). Chaque<br />
source ponctuelle, caractérisée par un spectre <strong>de</strong> puissance<br />
acoustique en tiers d’octaves <strong>et</strong> par une directivité<br />
spécifique, représente un mécanisme particulier <strong>de</strong><br />
génération <strong>de</strong> bruit. Par exemple, dans l’émission sonore<br />
d’un véhicule routier, bruit <strong>de</strong> traction <strong>et</strong> bruit <strong>de</strong><br />
roulement sont considérés distinctement. Une telle<br />
<strong>de</strong>scription fine présente l’avantage d’une adaptation plus<br />
aisée du modèle aux différences régionales <strong>et</strong> aux évolutions<br />
futures du parc roulant. De surcroît, elle perm<strong>et</strong> une<br />
estimation plus réaliste <strong>et</strong> plus efficace <strong>de</strong> l’impact <strong>de</strong>s<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005 PAGE 81