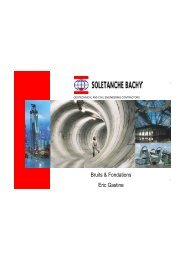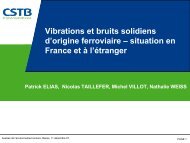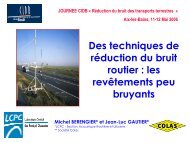Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Les autoroutes “apaisées”<br />
Certaines collectivités ont commencé à réfléchir à la<br />
transposition <strong>de</strong> ces réflexions aux axes autoroutiers.<br />
L’objectif ? Réintégrer ce type d’infrastructure dans le tissu<br />
urbain <strong>et</strong> dans la vie locale, en supprimant l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
coupure, en réduisant la vitesse en permanence, <strong>et</strong> pas<br />
seulement aux heures <strong>de</strong> pointe, en supprimant les<br />
nuisances, <strong>sonores</strong> bien sûr, mais aussi paysagères, <strong>de</strong><br />
pollution atmosphérique. Réflexions ambitieuses mais qui<br />
méritent d’être suivies. L’agglomération grenobloise, à<br />
travers l’agence d’urbanisme <strong>de</strong> Grenoble <strong>et</strong> la DDE <strong>de</strong><br />
l’Isère, s’intéresse à <strong>de</strong> tels aménagements.<br />
La bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’on peut “faire<br />
d’une pierre <strong>de</strong>ux coups” : en réduisant la vitesse <strong>et</strong> en<br />
assurant la fluidité du trafic, on réduit le bruit <strong>et</strong> on<br />
améliore la sécurité routière.<br />
L’impact acoustique <strong>de</strong>s aménagements <strong>de</strong> voirie<br />
En 2002, le laboratoire régional <strong>de</strong>s Ponts-<strong>et</strong>-Chaussées <strong>de</strong><br />
Blois a étudié une trentaine d’aménagements —<br />
aménagements isolés, zones 30, carrefours giratoires,<br />
entrées <strong>de</strong> ville, traversées d’agglomérations.<br />
Les aménagements isolés <strong>de</strong> type dos d’âne ou coussins, en<br />
cas <strong>de</strong> changement d’allure marquée, s’accompagnent d’une<br />
augmentation <strong>de</strong> 1 à 2 dB(A). Les carrefours giratoires,<br />
ponctuellement, c’est-à-dire au droit du carrefour, ont un<br />
eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> 1 à 3 dB(A) mais, sur l’ensemble <strong>de</strong> la<br />
structure, ils sont acoustiquement transparents. Quant aux<br />
zones 30, les résultats sont variables selon les zones. Bien<br />
aménagées, elles peuvent faire gagner 2 dB(A). Les entrées<br />
<strong>de</strong> ville, à condition d’assurer une réduction progressive <strong>de</strong>s<br />
vitesses, sont plutôt efficaces, avec <strong>de</strong>s gains <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 2<br />
à 4 dB(A). Les traversées d’agglomérations peuvent faire<br />
gagner 2 dB(A) mais, pour cela, il faut absolument maintenir<br />
la vitesse réduite.<br />
Une remarque néanmoins sur les étu<strong>de</strong>s avant-après : il<br />
n’est pas toujours facile <strong>de</strong> distinguer l’apport du<br />
revêtement moins bruyant ou <strong>de</strong> l’aménagement, ou <strong>de</strong>s<br />
nombreux autres paramètres qui sont modifiés à l’occasion<br />
d’un aménagement <strong>de</strong> voirie.<br />
Régulation <strong>de</strong> vitesse <strong>et</strong> bruit en milieu urbain : le cas <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s vertes<br />
modérantes<br />
Gérard Horvath (ville <strong>de</strong> Clermont-Ferrand)<br />
Gérard Horvath est directeur du service <strong>de</strong> circulation à la<br />
ville <strong>de</strong> Clermont-Ferrand. Comme l’a souligné<br />
précé<strong>de</strong>mment M. Prat, la régulation <strong>de</strong> la vitesse en ville a<br />
pour principal but la sécurité routière, mais l’influence <strong>de</strong> la<br />
régulation du trafic sur le bruit n’est pas négligeable. C<strong>et</strong>te<br />
intervention s’attache à présenter les modalités <strong>de</strong> mise en<br />
place d’une on<strong>de</strong> verte modérante, <strong>et</strong> les conséquences sur<br />
la vitesse <strong>et</strong> le bruit qu’on peut raisonnablement en<br />
attendre.<br />
Un p<strong>et</strong>it rappel utile : la capacité d’un réseau urbain est<br />
celle <strong>de</strong>s carrefours, <strong>et</strong> notamment <strong>de</strong>s carrefours à feux. En<br />
d’autres termes, conduire vite en ville n’est pas utile, car la<br />
vitesse moyenne d’un véhicule particulier en ville, compte<br />
tenu <strong>de</strong>s arrêts aux feux tricolores <strong>et</strong> <strong>de</strong>s encombrements,<br />
se situe aux alentours <strong>de</strong> 25 à 28 km/h. En transports<br />
collectifs, seulement la moitié du temps d’un déplacement<br />
est consacré au roulage.<br />
Bénéfices <strong>et</strong> limites<br />
Pour m<strong>et</strong>tre en place une coordination d’itinéraire, la<br />
condition indispensable est la présence rapprochée <strong>de</strong> feux<br />
sur un ou plusieurs axes du réseau. Le décalage dans<br />
l’apparition du feu vert d’un carrefour à l’autre perm<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
générer <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> circulation privilégiés, l’objectif étant<br />
la diminution du nombre <strong>et</strong> <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong>s arrêts. Les<br />
bénéfices <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s vertes ? Plus <strong>de</strong> confort pour l’usager<br />
motorisé, plus <strong>de</strong> crédibilité <strong>de</strong>s feux, plus <strong>de</strong> sécurité, par<br />
homogénéisation <strong>de</strong> la vitesse, <strong>et</strong> moins <strong>de</strong> nuisances.<br />
En revanche, l’on<strong>de</strong> verte a ses limites. Elle n’augmente pas<br />
la capacité d’écoulement <strong>de</strong> la voirie (à moins d’un eff<strong>et</strong><br />
dynamique dans certaines conditions). La durée <strong>de</strong> cycle<br />
doit être commune, ce qui réduit considérablement la marge<br />
<strong>de</strong> manœuvre pour optimiser chacun <strong>de</strong>s carrefours. En<br />
régime saturé, l’on<strong>de</strong> verte ne fonctionne pas. Elle est<br />
souvent incompatible avec les priorités à donner aux<br />
transports en commun. Elle pose problème pour les<br />
carrefours à trois phases <strong>et</strong>, dans le cas <strong>de</strong>s voies à double<br />
sens, c<strong>et</strong>te mesure est très difficile à optimiser.<br />
En milieu urbain <strong>de</strong>nse, la présence <strong>de</strong> carrefours à feux<br />
espacés <strong>de</strong> 250 à 300 mètres constitue la condition optimale<br />
pour réaliser une coordination. En milieu urbain non<br />
perturbé, c<strong>et</strong>te distance est <strong>de</strong> 500 mètres.<br />
Les différentes métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> coordination<br />
La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> la minimisation <strong>de</strong>s r<strong>et</strong>ards s’adresse plutôt<br />
au réseau maillé exempt d’eff<strong>et</strong> d’itinéraire. Son intérêt<br />
collectif est certain, mais il exige <strong>de</strong> puissants outils<br />
informatiques. L’on<strong>de</strong> verte, quant à elle, est conseillée<br />
pour les itinéraires suivis ne comportant ni trop d’apports<br />
<strong>de</strong>s voies adjacentes ni trop <strong>de</strong> sorties. L’on<strong>de</strong> verte<br />
modérante, enfin, une évolution <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> verte, vise à<br />
augmenter la sécurité <strong>et</strong> à diminuer les nuisances en<br />
régulant la vitesse.<br />
La coordination d’une on<strong>de</strong> verte unidirectionnelle se fait au<br />
moyen d’un diagramme où l’axe vertical représente les<br />
différentes positions <strong>de</strong>s feux tricolores, où l’axe horizontal<br />
indique le temps, <strong>et</strong> où l’inclinaison <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s du<br />
diagramme correspond à la vitesse du trafic. La ban<strong>de</strong><br />
passante correspond à la durée <strong>de</strong> feu vert minimale<br />
commune à tous les carrefours. Le principe du “calage à<br />
l’ouverture” correspond à la situation où l’ouverture du<br />
premier carrefour déci<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ouvertures <strong>de</strong>s carrefours<br />
suivants. Ce système fonctionne bien en cas d’apport faible<br />
<strong>de</strong>s transversales. Le calage à la ferm<strong>et</strong>ure, quant à lui, est<br />
à privilégier, car il n’incite pas à la vitesse. En eff<strong>et</strong>, il<br />
empêche toute tentative <strong>de</strong> “remontée <strong>de</strong> la zone verte”,<br />
ce comportement dangereux consistant à accélérer pour<br />
passer tous les feux au vert.<br />
L’on<strong>de</strong> verte modérante<br />
Dans le cas <strong>de</strong> l’on<strong>de</strong> verte modérante, on s’efforce <strong>de</strong><br />
diminuer autant que possible la ban<strong>de</strong> passante. Le feu vert<br />
est ainsi réduit à la durée minimale réglementaire<br />
d’ouverture d’un feu, soit le temps minimum nécessaire à la<br />
traversée d’un piéton sur une voie transversale. Ce système<br />
a un eff<strong>et</strong> très dissuasif sur la vitesse, car il interdit<br />
pratiquement toute tentative d’accélération pour<br />
“remonter” la zone verte. Le but <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s vertes<br />
modérantes, bien entendu, est la modération <strong>et</strong><br />
PAGE 46<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005