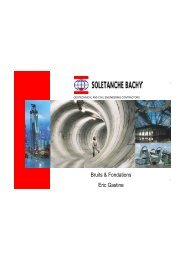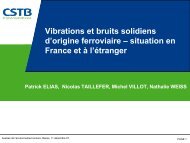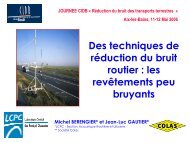Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
voies bruyantes ont été transmises aux préf<strong>et</strong>s dès 1998.<br />
Quant à la cartographie <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> bruits critiques, elle a<br />
été réalisée sur l’ensemble du réseau ferré national classé,<br />
<strong>et</strong> diffusée, dans le courant <strong>de</strong> l’année, à l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
DRE, DIREN, DDE <strong>et</strong> services <strong>de</strong> tutelle. On notera que,<br />
contrairement au réseau routier, où la cartographie est<br />
plutôt départementalisée, le principe, en matière<br />
ferroviaire, est <strong>de</strong> cartographier l’ensemble du réseau<br />
classé.<br />
La résorption <strong>de</strong>s points noirs bruit<br />
Au chapitre <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> lutte contre les “points noirs<br />
bruit”, en janvier 2005, 56 étu<strong>de</strong>s étaient en cours, pour<br />
environ 70 communes concernées, en Rhône-Alpes,<br />
Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Alsace, Lorraine,<br />
Bourgogne, Nord-Pas-<strong>de</strong>-Calais <strong>et</strong> Ile-<strong>de</strong>-France. Lancées<br />
dans le sillage <strong>de</strong> la circulaire <strong>de</strong> 2001, ces opérations<br />
commencent à se concrétiser. Sur <strong>de</strong>ux sites, à Aix-les-Bains<br />
<strong>et</strong> Montereau-Fault-Yonne, les travaux sont réalisés ou en<br />
voie <strong>de</strong> l’être. Sur une dizaine <strong>de</strong> sites, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s d’avant<br />
proj<strong>et</strong> sont en cours, tandis que <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s acoustiques<br />
préalables sont réalisées sur une trentaine <strong>de</strong> sites. Côté<br />
financement, le coût <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>et</strong> <strong>de</strong>s opérations est pour<br />
moitié supporté par l’État <strong>et</strong> RFF, l’autre moitié revenant<br />
aux collectivités. À noter que l’Ile-<strong>de</strong>-France a prévu un<br />
programme <strong>et</strong> un budg<strong>et</strong> pour la lutte contre les point noirs<br />
bruit dans le cadre d’un contrat <strong>de</strong> plan État-Région.<br />
Pour accompagner la montée en puissance <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te politique<br />
<strong>de</strong> lutte contre les points noirs bruit, l’État <strong>et</strong> RFF ont<br />
mobilisé <strong>de</strong>s financements pour la protection à la source. En<br />
2004, ces financements ont totalisé 1 million d’euros ; pour<br />
2005, ces financements étaient évalués à 13,8 M€ ; pour<br />
2006, à 24,5 M€ ; pour 2007, à 15,4 M€.<br />
La protection <strong>de</strong> faça<strong>de</strong> est quant à elle financée par une<br />
subvention du ministère <strong>de</strong> l’Écologie <strong>et</strong> du Développement<br />
durable (MEDD) correspondant à une enveloppe <strong>de</strong> 11,9<br />
millions d’euros.<br />
L’exemple <strong>de</strong> la commune d’Aix-les-Bains illustre bien la<br />
difficulté qu’il y a à mobiliser l’ensemble <strong>de</strong>s financements<br />
nécessaires aux opérations <strong>de</strong> résorption <strong>de</strong>s points noirs. Le<br />
proj<strong>et</strong> aura en eff<strong>et</strong> mis près <strong>de</strong> 9 ans à être réalisé.<br />
En 1997, un groupe <strong>de</strong> pilotage constitué <strong>de</strong> la Ville d’Aixles-Bains,<br />
<strong>de</strong> la DDASS 73, <strong>de</strong> la mission bruit du MEDD, <strong>de</strong> la<br />
SNCF <strong>et</strong> <strong>de</strong> RFF a été lancé afin d’engager le proj<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
résorption <strong>de</strong> ce point noir bruit. Il s’agit du principal axe <strong>de</strong><br />
fr<strong>et</strong> ferroviaire France-Italie (axe Dijon-Culoz-Modane). En<br />
1998, une étu<strong>de</strong> acoustique préalable, cofinancée par le<br />
MEDD, le conseil régional, le conseil général, la Ville <strong>et</strong> la<br />
SNCF a permis d’i<strong>de</strong>ntifier dix sites homogènes d’exposition.<br />
Après une étu<strong>de</strong> complémentaire ayant porté sur les trois<br />
sites les plus affectés, une solution technique a été arrêtée :<br />
1370 m <strong>de</strong> mur antibruit <strong>de</strong> 1,20 à 2 m <strong>de</strong> haut, complétés<br />
par <strong>de</strong>s isolations <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>. Le coût <strong>de</strong>s écrans a été évalué<br />
à 4 M€ (25% État, 25% RFF, 12,5% Région, 5% Département,<br />
32,5% Ville), celui <strong>de</strong>s isolations <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>s à 1 M€<br />
(subvention du MEDD). La maîtrise d’ouvrage <strong>de</strong>s écrans a<br />
été confiée à RFF, la maîtrise d’œuvre technique à la SNCF,<br />
l’insertion paysagère <strong>et</strong> la concertation étant assurées par la<br />
Ville. Le 3 mai 2004, une convention travaux était signée, le<br />
début <strong>de</strong>s travaux étant prévu pour fin 2005.<br />
Sans doute peut-on espérer que la mise en place progressive<br />
<strong>de</strong>s observatoires du bruit à l’échelon départemental<br />
perm<strong>et</strong>tra d’accélérer ces opérations.<br />
Les dispositifs <strong>de</strong> protection<br />
On peut distinguer <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> protection :<br />
les dispositifs opérationnels <strong>et</strong> maîtrisés, <strong>et</strong> les dispositifs<br />
expérimentaux.<br />
Dans la première catégorie, la conception technique du<br />
proj<strong>et</strong> constitue le premier niveau <strong>de</strong> protection. Il convient<br />
en eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> ne pas oublier que l’acoustique fait partie<br />
intégrante <strong>de</strong>s proj<strong>et</strong>s d’infrastructure ferroviaire. Par le<br />
choix du tracé, la conception du profil en long, on s’efforce<br />
<strong>de</strong> limiter le bruit. Deuxième niveau d’intervention,<br />
l’infrastructure : les longs rails soudés, les traverses bétons<br />
sont <strong>de</strong>ux exemples <strong>de</strong> dispositifs propres à l’infrastructure<br />
qui perm<strong>et</strong>tent d’en améliorer l’acoustique. Viennent<br />
ensuite les dispositifs <strong>de</strong> protection à la source (écrans,<br />
merlons, …) <strong>et</strong> les dispositifs complémentaires (protections<br />
<strong>de</strong> faça<strong>de</strong>s).<br />
Côté dispositifs expérimentaux, trois grands programmes <strong>de</strong><br />
recherche, réalisés en partenariat avec la SNCF, sont en<br />
cours. L’un <strong>de</strong> ces programmes porte sur la diminution du<br />
bruit <strong>de</strong>s ponts métalliques. Ce sont <strong>de</strong>s ouvrages très<br />
bruyants qui sont à l’origine <strong>de</strong> bon nombre <strong>de</strong> points noirs<br />
du bruit. Pourtant, leur prise en compte dans les logiciels <strong>de</strong><br />
simulation acoustique est assez limitée. Le programme<br />
s’était fixé quatre objectifs : modéliser les phénomènes<br />
vibro-acoustiques pour en déduire les éléments du pont<br />
étant à l’origine <strong>de</strong>s principales émissions <strong>sonores</strong> (en <strong>de</strong>çà<br />
<strong>de</strong> 300 Hz le platelage serait le principal élément entrant en<br />
jeu, au-<strong>de</strong>là, ce seraient les rails) ; rechercher <strong>de</strong>s solutions<br />
<strong>de</strong> réduction du bruit <strong>et</strong> les évaluer par la simulation ;<br />
expérimenter les solutions les plus prom<strong>et</strong>teuses par<br />
combinaison itérative (pour les hautes fréquences,<br />
absorbeurs sur rails, renforcement <strong>de</strong> la rai<strong>de</strong>ur rail-pont,<br />
pose d’écrans fixes ; pour les basses fréquences, absorbeurs<br />
sur platelage, tôle « sandwich » en élastomère) ; enfin,<br />
procé<strong>de</strong>r à l’homologation <strong>de</strong> ces procédés.<br />
Un autre <strong>de</strong> ces programmes <strong>de</strong> recherche consiste à étudier<br />
l’utilisation <strong>de</strong>s absorbeurs sur rail, solution assez<br />
prom<strong>et</strong>teuse dont les gains espérés sont <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 3 à 5<br />
dB(A). La SNCF a tout d’abord réalisé une étu<strong>de</strong> sur l’état <strong>de</strong><br />
l’art en la matière, puis, <strong>de</strong>ux prototypes d’absorbeur<br />
différents ont été réalisés. Ils font l’obj<strong>et</strong> d’essais en voies<br />
(acoustique, sécurité) à Pierrelatte <strong>de</strong>puis avril 2004.<br />
Enfin, la limitation du bruit <strong>de</strong>s triages, notamment <strong>de</strong>s<br />
freins <strong>de</strong> voies, fait également l’obj<strong>et</strong> d’un programme <strong>de</strong><br />
recherche. Lors du freinage, un dépôt par microsoudure <strong>de</strong>s<br />
particules d’usure peut se traduire par un bruit<br />
extrêmement stri<strong>de</strong>nt (4000 Hz) pouvant atteindre, à<br />
proximité immédiate, un niveau sonore dangereux, <strong>de</strong><br />
l’ordre <strong>de</strong> 130 à 150 dB(A). Pour limiter le bruit causé par le<br />
frottement entre le rail freineur <strong>et</strong> la roue, plusieurs<br />
solutions ont été testées. À Hourca<strong>de</strong> <strong>et</strong> Saint-Jory, les tests<br />
ont porté sur <strong>de</strong>s écrans acoustiques <strong>de</strong> 1,20 m <strong>de</strong> haut<br />
encadrant les freins <strong>de</strong> voie. C<strong>et</strong>te solution comporte<br />
plusieurs inconvénients : manque <strong>de</strong> visibilité sur le frein <strong>de</strong><br />
voie, nécessité <strong>de</strong> démonter les écrans pour intervenir sur<br />
les freins <strong>de</strong> voie, détérioration en cas <strong>de</strong> déraillement sur<br />
le triage. Une autre solution repose sur l’injection d’un<br />
mélange spécial lubrifiant avec détecteur <strong>de</strong> présence <strong>de</strong><br />
roue, intégré au système <strong>de</strong> freins <strong>de</strong> voie. À partir <strong>de</strong> 2005,<br />
ce système doit être testé au triage <strong>de</strong> Drancy. Enfin, une<br />
<strong>de</strong>rnière expérimentation, consistant en un rail rainuré en<br />
acier, est testée à Achères.<br />
Pascal Fodiman (SNCF)<br />
En dix ans, entre les TGV oranges <strong>et</strong> les versions duplex, 10<br />
décibels ont été gagnés. Ainsi, un train à gran<strong>de</strong> vitesse<br />
actuel produit, à 300 km/h, une énergie sonore comparable<br />
à celle d’un train corail circulant à 160 km/h. Se pose<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005 PAGE 51