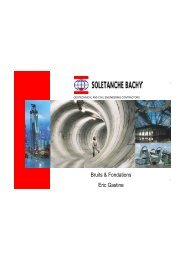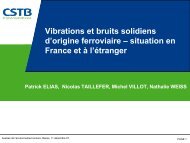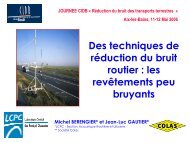Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Quels sont les phénomènes jouant un rôle dans la<br />
propagation du bruit considérés dans le cadre <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te<br />
étu<strong>de</strong> ? La hauteur <strong>de</strong> la source, du récepteur <strong>et</strong> la distance<br />
qui les sépare. La dissipation par absorption atmosphérique,<br />
dont la contribution sera facile à estimer (cf. norme<br />
ISO 9613). Ce paramètre est à prendre en compte dans les<br />
calculs ; il constitue même une opportunité <strong>de</strong> s’affranchir<br />
<strong>de</strong> certains calculs coûteux, notamment en haute fréquence,<br />
pour les gran<strong>de</strong>s distances. Les eff<strong>et</strong>s <strong>de</strong> sol : hypothèse est<br />
faite d’un sol homogène, mais dont la résistance au passage<br />
<strong>de</strong> l’air est variable. Enfin, <strong>de</strong>rnier paramètre considéré, les<br />
eff<strong>et</strong>s micro-métérologiques : leur incorporation se fait au<br />
moyen <strong>de</strong> plages <strong>de</strong> profils <strong>de</strong> célérité effective, basés sur<br />
<strong>de</strong>s profils <strong>de</strong> vent <strong>et</strong> <strong>de</strong> température issus d’observations<br />
météorologiques. La turbulence atmosphérique est aussi<br />
prise en compte. L’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong>s obstacles, le plus souvent<br />
tridimensionnel, est en revanche mis <strong>de</strong> côté pour le<br />
moment dans c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong>.<br />
Le déroulement <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
Quelles sont les hypothèses <strong>de</strong> travail ? Une source<br />
ponctuelle, omnidirectionnelle, dont on fera varier la<br />
hauteur ; un sol plan, homogène, en présence d’eff<strong>et</strong>s<br />
micro-métrologiques ; un récepteur, situé à une distance <strong>et</strong><br />
une hauteur variables. Quelques spectres typiques <strong>de</strong>s<br />
sources routières, ferroviaires <strong>et</strong> industrielles, une dizaine<br />
tout au plus, vont être considérés.<br />
Fait important, les plages <strong>de</strong> paramètres sont choisies <strong>de</strong><br />
telle façon qu’une précision <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> +/- 1 dB(A) soit<br />
obtenue sur l’ensemble <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sources. Compte tenu<br />
<strong>de</strong> la complexité <strong>de</strong>s cas concr<strong>et</strong>s, c<strong>et</strong> ordre <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s<br />
variations est tout à fait satisfaisant.<br />
La métho<strong>de</strong> consiste donc à définir les plages pour chaque<br />
paramètre, en cohérence les +/- 1 dB(A) <strong>de</strong> variation définis<br />
sur <strong>de</strong>s cas « enveloppe », <strong>et</strong> à réduire notablement le<br />
nombre <strong>de</strong> cas à prévoir (ou à mesurer). Deuxième acte <strong>de</strong><br />
la métho<strong>de</strong> : réaliser <strong>de</strong>s calculs <strong>et</strong> <strong>de</strong>s mesures définis pour<br />
l’ensemble <strong>de</strong> ces plages <strong>de</strong> paramètres, <strong>et</strong> (ou) <strong>de</strong>s mesures<br />
couvrant l’ensemble <strong>de</strong>s cas possibles, <strong>de</strong> manière couplée<br />
avec <strong>de</strong>s modèles plus ou moins évolués, selon les<br />
phénomènes considérés.<br />
Les limites adoptées pour la hauteur <strong>de</strong> la source sont<br />
comprises entre 5 cm (bruit routier), <strong>et</strong> 50 m (bruit<br />
industriel). Six hauteurs <strong>de</strong> référence ont d’ores <strong>et</strong> déjà été<br />
arrêtées : 5 cm ; 1 m (hauteur équivalente côté récepteur) ;<br />
2 m ; 4 m (hauteur imposée par la directive bruit ambiant) ;<br />
10 m (hauteur intéressante pour les calculs météo) <strong>et</strong> 50 m<br />
(à compléter en interaction avec les résultats d’une étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> sensibilité réalisée pour l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> sol). Côté récepteur,<br />
les hauteurs limites sont comprises entre 1 <strong>et</strong> 10 mètres. La<br />
distance entre la source <strong>et</strong> le récepteur, elle, varie entre<br />
une vingtaine <strong>de</strong> mètres <strong>et</strong> mille mètres. Le but étant<br />
d’obtenir les classes <strong>de</strong> distance correspondant à une<br />
variation <strong>de</strong> +/- 1 dB(A), avec un eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> sol <strong>de</strong> type<br />
herbeux (eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> décroissance maximum au centre du<br />
spectre <strong>et</strong> donc en dB(A)). Des gains significatifs peuvent<br />
être ainsi obtenus sur le nombre <strong>de</strong> calculs, pour peu que les<br />
paramètres soient fixés à l’avance.<br />
pour chaque tiers d’octave, le nombre <strong>de</strong> valeurs <strong>de</strong><br />
fréquence considérées pour le calcul, tout en restant<br />
compatible avec la précision <strong>de</strong> l’ordre du décibel fixée<br />
initialement. Ce principe a été validé par une étu<strong>de</strong> menée<br />
sur les phénomènes <strong>de</strong> lissage. Classiquement, l’examen <strong>de</strong><br />
la littérature montre qu’une moyenne <strong>de</strong> 10 points est<br />
considérée par tiers d’octave. Avec c<strong>et</strong>te approche<br />
optimisée, le gain sur le nombre <strong>de</strong> calculs à réaliser est<br />
d’un facteur <strong>de</strong>ux ou trois.<br />
Il en va <strong>de</strong> même pour la délimitation du domaine spatial :<br />
jusqu’à quelle fréquence <strong>et</strong> à quelle distance arrêter les<br />
calculs ? Pour répondre à c<strong>et</strong>te question, l’examen <strong>de</strong>s<br />
courbes d’absorption atmosphérique suffit. Il en ressort une<br />
faible influence <strong>de</strong>s hautes fréquences à gran<strong>de</strong> distance :<br />
typiquement, à partir <strong>de</strong> 1000 mètres <strong>de</strong> distance, toutes les<br />
fréquences supérieures à 1600 Hz peuvent être négligées.<br />
Sans que l’exigence <strong>de</strong> précision <strong>de</strong> 1 dB(A) sur l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s types <strong>de</strong> sources ne soit remise en cause. C<strong>et</strong>te<br />
simplification constitue un gain sur le nombre <strong>de</strong> calculs à<br />
réaliser, gain qui, c<strong>et</strong>te fois, est <strong>de</strong> facteur 10.<br />
Pour l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> sol, phénomène sur lequel les travaux <strong>de</strong><br />
l’équipe sont moins aboutis, l’unique paramètre considéré<br />
est la résistance au passage <strong>de</strong> l’air σ. Les valeurs <strong>de</strong> σ sont<br />
comprises entre 100 kNsm - 4 (sol très absorbant) <strong>et</strong> 20 000<br />
kNsm - 4 (sol très réfléchissant). Là encore, les plages <strong>de</strong><br />
σ sont déterminées par <strong>de</strong>s calculs relativement<br />
conservatifs : un premier calcul est réalisé en conditions<br />
homogènes (calculs analytiques), puis un test <strong>et</strong> une<br />
correction éventuelle <strong>de</strong>s plages obtenues sont effectués en<br />
conditions favorables.<br />
Concernant enfin l’influence <strong>de</strong> la météorologie, le registre<br />
<strong>de</strong> vent adopté s’inscrit dans la plage <strong>de</strong> vitesses [0 ;10<br />
m/s], pour une hauteur <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> 10 m. À ce sta<strong>de</strong>, il<br />
convient <strong>de</strong> considérer <strong>de</strong>s plages <strong>de</strong> profils réalistes, en<br />
termes <strong>de</strong> température notamment. Une consultation <strong>de</strong><br />
météorologues a été menée dans l’intention <strong>de</strong> définir les<br />
types <strong>de</strong> profils possibles, étant données <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong><br />
vent <strong>et</strong> d’humidité fixées. Quand bien même <strong>de</strong>s plages <strong>de</strong><br />
profils <strong>de</strong> célérité effective (lin-log) peuvent ainsi être<br />
déterminées, il faut gar<strong>de</strong>r à l’esprit que la direction du<br />
vent peut influer. L’influence <strong>de</strong> la turbulence n’est bien<br />
entendu pas occultée, mais faute <strong>de</strong> pouvoir mener <strong>de</strong>s<br />
calculs pour chaque valeur <strong>de</strong> ce paramètre, on s’en tiendra<br />
à <strong>de</strong>s ordres <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur s’appuyant sur <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong><br />
diffusion simplifiés, associés à quelques calculs <strong>de</strong> référence<br />
avec l’équation parabolique.<br />
Enfin, la limite basse associée aux niveaux calculés est fixée<br />
à 25 dB(A), soit le bruit résiduel propre à une zone assez<br />
calme. Pour ce faire, <strong>de</strong>s spectres <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> bruit<br />
résiduel sont intégrés au modèle, afin <strong>de</strong> pouvoir écarter les<br />
situations qui, pour une fréquence donnée, correspondraient<br />
à un niveau inférieur à 25 dB(A).<br />
Autre choix important, la gamme <strong>de</strong> fréquence, pour les<br />
mesures comme pour les calculs, s’étend quant à elle <strong>de</strong> 50<br />
Hz à 4 kHz. Mais avec un principe systématique : optimiser,<br />
La campagne d’essai sera réalisée sur le site <strong>de</strong> recherche<br />
atmosphérique <strong>de</strong> Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Ce site<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005 PAGE 57