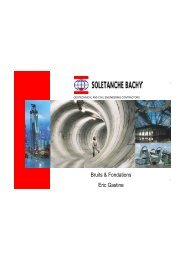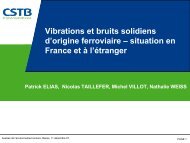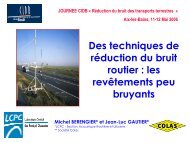Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
trafic d’une route moyenne. L’ordonnance <strong>de</strong> transposition<br />
<strong>de</strong> novembre 2004, par rapport à la définition <strong>de</strong> la<br />
directive, a introduit une modification du critère <strong>de</strong><br />
qualification <strong>de</strong>s axes : seul le critère du seuil <strong>de</strong> trafic est<br />
conservé, celui <strong>de</strong> la fonctionnalité — qui distinguait les<br />
routes régionales, nationales <strong>et</strong> internationales — étant<br />
abandonné. D’un côté, cela apporte une simplification : on<br />
s’affranchit ainsi <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> définir, en France, ce<br />
qu’est une route régionale ; mais, <strong>de</strong> l’autre, la<br />
conséquence est qu’une route relativement locale sur le<br />
plan, disons, fonctionnel, mais qui dépasse les 8200<br />
véhicules/jour, <strong>de</strong>vra être cartographiée. Autre<br />
conséquence : dans une agglomération <strong>de</strong> 99 000 habitants<br />
qui, normalement, n’est pas concernée par les cartes <strong>de</strong><br />
bruit stratégiques, si une avenue dépasse les 8200<br />
véhicules/jour, une carte spécifique pour c<strong>et</strong>te avenue<br />
<strong>de</strong>vra être établie.<br />
Le linéaire concerné<br />
Pour les routes nationales, on peut dire qu’environ la moitié<br />
du linéaire dépasse le seuil <strong>de</strong> trafic <strong>de</strong> 8200 véhicules/jour.<br />
Pour les autoroutes, 90% <strong>de</strong>s 10 000 km <strong>de</strong> linéaire<br />
autoroutier sont concernés. En revanche, pour les routes<br />
départementales (RD) <strong>et</strong> les voies communales (VC), on est,<br />
pour l’heure, incapables d’estimer le linéaire concerné par<br />
ce seuil <strong>de</strong> trafic. Le pourcentage est certainement assez<br />
faible, mais quelques pourcents <strong>de</strong> 360 000 km (RD) ou<br />
610 000 km (VC) ne sont pas forcément négligeables. Pour le<br />
réseau routier national, le linéaire à cartographier atteint<br />
donc 23 000 km. Pour les routes départementales, une<br />
hypothèse <strong>de</strong> 3% du linéaire représenterait 10 000 km<br />
environ. Quant aux voies communales, l’estimation est par<br />
trop hasar<strong>de</strong>use.<br />
Intéressons-nous maintenant à la distance transversale à<br />
l’axe routier sur laquelle la cartographie doit porter. La<br />
carte doit représenter les zones exposées à un niveau sonore<br />
L <strong>de</strong>n supérieur à 55 dB(A). Sur site dégagé, dans certains cas<br />
<strong>de</strong> trafic élevé, ce niveau peut être atteint à 600 m <strong>de</strong> l'axe<br />
routier. Par conséquent, pour les sites dont on ne connaît<br />
pas a priori la topographie, le recueil <strong>de</strong> données <strong>de</strong>vra<br />
porter sur une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> c<strong>et</strong> ordre <strong>de</strong> chaque côté <strong>de</strong> la<br />
route. Si l’on applique c<strong>et</strong>te valeur aux 23 000 km<br />
d’autoroutes <strong>et</strong> <strong>de</strong> routes nationales, on aboutit à une<br />
superficie maximum à cartographier <strong>de</strong> 25 000 km 2 . Même si<br />
c<strong>et</strong>te zone ne doit pas nécessairement être étudiée<br />
finement, la collecte <strong>de</strong> données sur une telle zone<br />
représente pour le moins un travail conséquent.<br />
Démarche préconisée par la directive<br />
Pour réaliser ce travail, lorsque l’État membre ne dispose<br />
pas <strong>de</strong> métho<strong>de</strong> nationale approuvée, la directive<br />
recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> recourir à la métho<strong>de</strong> NMPB-Routes-96, la<br />
métho<strong>de</strong> française développée pour les étu<strong>de</strong>s d’impact <strong>de</strong><br />
proj<strong>et</strong>s d’infrastructures <strong>et</strong> le dimensionnement <strong>de</strong><br />
protections acoustiques. L’avantage <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te métho<strong>de</strong> est sa<br />
précision, son inconvénient, sa complexité (temps <strong>de</strong> calculs<br />
importants, nécessité d’une <strong>de</strong>scription très détaillée <strong>de</strong>s<br />
sites). Recueillir <strong>de</strong>s données très détaillées prend du temps<br />
<strong>et</strong> coûte cher. Qui plus est, <strong>de</strong> telles données ne sont pas<br />
toujours disponibles. Le traitement <strong>de</strong>s données est lourd <strong>et</strong><br />
très onéreux même lorsqu'une <strong>de</strong>scription détaillée <strong>de</strong>s sites<br />
est disponible. On peut certes appliquer la NMPB-Routes sans<br />
données d’entrée détaillées, mais alors, à quoi bon utiliser<br />
un outil complexe ? Certes, les systèmes <strong>de</strong> bases <strong>de</strong><br />
données géographiques se répan<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> plus en plus, mais,<br />
malheureusement, elles sont moins répandues pour le milieu<br />
rural que pour le milieu urbain. Même si les prévisions sont<br />
optimistes, il faut s’attendre à ce que l’objectif d’une<br />
couverture <strong>de</strong> l’ensemble du territoire français pour 2007 ne<br />
soit pas atteint.<br />
Rappels <strong>de</strong> la directive sur le contenu <strong>de</strong>s cartes<br />
Tout d’abord, la directive <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s calculs à<br />
4 m au-<strong>de</strong>ssus du sol <strong>et</strong> <strong>de</strong> caractériser chaque bâtiment par<br />
le niveau sonore <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> la plus exposée. Il ne s’agit ni<br />
<strong>de</strong> donner le niveau sonore à chaque fenêtre, ni en faça<strong>de</strong><br />
arrière du bâtiment, ni au dixième étage, quand celui-ci<br />
comporte dix étages, mais <strong>de</strong> représenter l’exposition au<br />
bruit <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s habitants du bâtiment par un seul<br />
point d’évaluation. Un raccourci réducteur mais nécessaire,<br />
compte tenu du linéaire important à traiter. D’autant que<br />
les cartes stratégiques, telles qu’elles sont définies dès le<br />
premier article <strong>de</strong> la directive, visent trois objectifs<br />
principaux : informer la population <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong>s<br />
nuisances <strong>sonores</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’exposition <strong>de</strong> la population ;<br />
fournir à la Commission une base pour établir <strong>de</strong>s<br />
propositions d’action <strong>de</strong> l’Union européenne ; fournir aux<br />
autorités locales une base pour l’établissement <strong>de</strong>s plans<br />
d’action. Or, quelle est la démarche usuelle d’élaboration<br />
d’un plan d’action, adoptée notamment par les<br />
observatoires du bruit ? On réalise en premier lieu un<br />
diagnostic, afin d’i<strong>de</strong>ntifier les situations répondant aux<br />
critères d’intervention préalablement fixés (seuil <strong>de</strong> niveau<br />
sonore, type <strong>de</strong> population, type d’activité). On définit<br />
ensuite <strong>de</strong>s priorités d’intervention, car, naturellement,<br />
tous les sites i<strong>de</strong>ntifiés ne peuvent être traités d’un coup.<br />
Pour c<strong>et</strong>te première étape, une métho<strong>de</strong> simplifiée suffit.<br />
Dans un <strong>de</strong>uxième temps, pour les situations répondant aux<br />
priorités, les mesures techniques à appliquer sont définies,<br />
en ayant là recours à une précision relevant <strong>de</strong> la démarche<br />
<strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> d’impact. En d’autres termes, ce n’est que dans<br />
un <strong>de</strong>uxième temps que <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s précises sont requises. À<br />
l’étape n°1, une métho<strong>de</strong> simplifiée, non seulement suffit,<br />
mais est nécessaire, pour alléger les coûts d’étu<strong>de</strong>.<br />
Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité d’une métho<strong>de</strong> simplifiée <strong>de</strong><br />
cartographie du bruit <strong>de</strong>s routes interurbaines<br />
Ce constat effectué, le S<strong>et</strong>ra a engagé une étu<strong>de</strong>, à laquelle<br />
participent un certain nombre <strong>de</strong> centres d'étu<strong>de</strong>s<br />
techniques <strong>de</strong> l'Équipement (CETE <strong>de</strong> l'Est, <strong>de</strong> Lyon,<br />
Méditerranée, Nord-Picardie, du Sud-Ouest). L’objectif ?<br />
Tester l’intérêt <strong>de</strong> diverses sources <strong>de</strong> données disponibles,<br />
<strong>de</strong> sources <strong>de</strong> données géographiques notamment <strong>et</strong>,<br />
surtout, évaluer la faisabilité d’une métho<strong>de</strong> simplifiée <strong>de</strong><br />
cartographie <strong>de</strong>s routes interurbaines qui pourrait être<br />
utilisée en l'absence <strong>de</strong> données <strong>de</strong> site détaillées, ou<br />
lorsque <strong>de</strong>s données détaillées sont disponibles mais que<br />
leur traitement est jugé trop lourd. C<strong>et</strong>te métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>vrait<br />
bien entendu conserver un niveau <strong>de</strong> précision acceptable.<br />
La démarche a consisté à considérer une douzaine <strong>de</strong> sites,<br />
chacun d’une longueur moyenne <strong>de</strong> 1,5 km, ayant fait<br />
l’obj<strong>et</strong> d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s CETE. Pour chacun <strong>de</strong>s sites,<br />
une <strong>de</strong>scription précise, s’appuyant sur <strong>de</strong>s relevés<br />
géométriques <strong>et</strong> topographiques, était disponible. Dans le<br />
choix <strong>de</strong>s sites, l’on a recherché une gran<strong>de</strong> variété<br />
typologique, tant du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la topographie que du<br />
type <strong>de</strong> bâti, <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité, du profil en travers <strong>de</strong> la route<br />
ou <strong>de</strong> la présence d’écrans acoustiques.<br />
Dans une première phase, <strong>de</strong>s cartes strictement conformes<br />
à la directive ont été établies, en appliquant la métho<strong>de</strong><br />
NMPB-Routes-96. Les calculs n’ont pas été directement<br />
réalisés en L <strong>de</strong>n , mais en niveau équivalent L Aeq , moyennant<br />
donc une équivalence grossière, mais, l’idée étant <strong>de</strong> tester<br />
une faisabilité, il n’importait pas tant <strong>de</strong> travailler<br />
directement sur les L <strong>de</strong>n . Pour chacun <strong>de</strong>s sites, ont été<br />
évaluées les surfaces <strong>de</strong> L <strong>de</strong>n dépassant les seuils fixés par la<br />
directive, soit 55, 65 <strong>et</strong> 75 dB. Le nombre <strong>de</strong> bâtiments<br />
exposés a également été déterminé, par classe <strong>de</strong> 5 dB.<br />
L’idée était <strong>de</strong> fixer <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> référence, auxquels<br />
pourraient ensuite être comparée l’information obtenue au<br />
moyen <strong>de</strong> diverses métho<strong>de</strong>s simplifiées.<br />
PAGE 116<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005