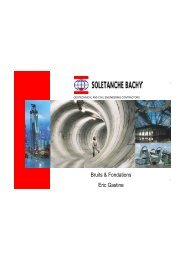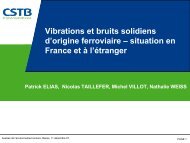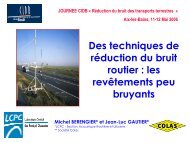Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Nuisances sonores aéroportuaires - Centre d'information et de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dans c<strong>et</strong>te étu<strong>de</strong>, le choix a porté sur <strong>de</strong>s estimateurs<br />
capables <strong>de</strong> calculer le niveau sonore en dB. Eu égard aux<br />
indices européens qui ont émergé ces <strong>de</strong>rniers temps, c<strong>et</strong>te<br />
particularité est en eff<strong>et</strong> avantageuse. Quel est le principe<br />
d’élaboration <strong>de</strong> tels estimateurs <strong>de</strong> type signal ? Le son<br />
passe tout d’abord à travers l’un <strong>de</strong>s trois filtres A, B <strong>et</strong> C<br />
correspondant aux trois courbes isosoniques (niveaux 40 dB,<br />
70 dB <strong>et</strong> 100 dB). Puis, l’énergie <strong>de</strong> ce son est calculée, avec<br />
trois options <strong>de</strong> temps d’intégration possibles : Slow<br />
(constante <strong>de</strong> 1 secon<strong>de</strong>), Fast (125 millisecon<strong>de</strong>s) <strong>et</strong><br />
Impulse (35 millisecon<strong>de</strong>s). Afin <strong>de</strong> représenter<br />
graphiquement le niveau sonore en fonction du temps, c’est<br />
le logarithme <strong>de</strong> l’énergie obtenue qui est considéré. Pour<br />
attribuer à ce son un niveau fixe, on fait alors le choix d’un<br />
point caractéristique <strong>de</strong> la courbe (moyenne, niveau<br />
équivalent, maximum, …). Ici, c’est le niveau maximum qui<br />
a été r<strong>et</strong>enu.<br />
Un autre estimateur a également fait l’obj<strong>et</strong> d’une<br />
évaluation : l’estimateur normalisé ISO 532B proposé par<br />
Zwicker, principalement basé sur <strong>de</strong>s modèles perceptifs.<br />
Comment est-il élaboré ? À partir d’un son stationnaire, on<br />
effectue sa transformée <strong>de</strong> Fourier moyenne. L’énergie est<br />
ensuite regroupée par ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> bark. Un coefficient A0,<br />
correspondant grosso modo à la réponse en fréquence <strong>de</strong><br />
l’oreille, est alors r<strong>et</strong>ranché. De cela, est extrait ce que<br />
Zwicker appelle la “sonie <strong>de</strong> cœur”, soit la sonie à<br />
l’intérieur d’une ban<strong>de</strong> due à l’énergie à l’intérieur même<br />
<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te ban<strong>de</strong>. À l’étape suivante, on extrait ce que<br />
Zwicker appelle la “sonie <strong>de</strong> flan”, soit la sonie à l’intérieur<br />
d’une ban<strong>de</strong> due à une ban<strong>de</strong> adjacente. En d’autres<br />
termes, la sonie <strong>de</strong> flan correspond à la composante prenant<br />
en compte le masquage fréquentiel. Enfin, pour obtenir une<br />
sonie unique, c’est l’intégrale <strong>de</strong> la courbe obtenue qui est<br />
considérée.<br />
Problème : la transformée <strong>de</strong> Fourier moyenne supprime<br />
toute prise en compte <strong>de</strong>s fluctuations temporelles. Or, qui<br />
dit son non stationnaire, dit fluctuations temporelles. C’est<br />
c<strong>et</strong>te carence du modèle initial qui a poussé Zwicker a<br />
proposer, en 1977, une amélioration reflétant c<strong>et</strong>te fois les<br />
fluctuations temporelles. À partir d’un son, l’évolution <strong>de</strong> la<br />
sonie en fonction du temps est calculée, à partir <strong>de</strong> la sonie<br />
<strong>de</strong> fenêtres temporelles espacées <strong>de</strong> ∆t. Divers filtres<br />
prennent également en considération le masquage temporel.<br />
Un point particulier <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te courbe est alors choisi. Ici,<br />
comme pour le niveau sonore, c’est le maximum <strong>de</strong> la<br />
courbe d’évolution <strong>de</strong> la sonie avec le temps qui est choisi.<br />
Protocole d’évaluation<br />
Face à la foule d’estimateurs existants, pour certains<br />
éminemment complexes, l’adoption d’un certain nombre <strong>de</strong><br />
critères d’évaluation s’impose. En premier lieu, dans le<br />
registre quantitatif, l’estimateur est éprouvé selon<br />
différentes expériences, avec <strong>de</strong>s stimuli <strong>et</strong> <strong>de</strong>s suj<strong>et</strong>s<br />
différents. Ceci pour s’éviter le biais trop souvent r<strong>et</strong>rouvé<br />
dans la littérature, à savoir le manque “d’universalité” d’un<br />
estimateur uniquement testé à l’aune <strong>de</strong>s critères ayant<br />
servi à son élaboration.<br />
Au chapitre <strong>de</strong>s critères qualitatifs c<strong>et</strong>te fois, tout<br />
paramètre arbitraire est à proscrire. De plus, le protocole<br />
doit faire la part belle à une certaine pertinence perceptive<br />
<strong>et</strong> se montrer robuste vis-à-vis <strong>de</strong>s divers paramètres, tels<br />
que la fréquence d’échantillonnage.<br />
Quatre indicateurs ont, au final, été r<strong>et</strong>enus pour<br />
l’évaluation <strong>de</strong>s estimateurs : M.A.R., Rmax, Rmean <strong>et</strong> Rstd.<br />
La façon la plus intuitive d’évaluer un estimateur donné est<br />
<strong>de</strong> prendre la valeur absolue <strong>de</strong> l’écart entre la mesure (le<br />
niveau d’isosonie estimé au cours d’une expérience psychoacoustique)<br />
<strong>et</strong> son calcul (le niveau d’isosonie calculé), puis<br />
<strong>de</strong> calculer une moyenne. C’est ce principe qui correspond à<br />
l’indicateur M.A.R. (pour Mean Absolute Residual).<br />
Cependant, c<strong>et</strong> indicateur présente l’inconvénient<br />
d’atténuer l’importance d’erreurs grossières. C’est la raison<br />
pour laquelle il faut également considérer l’indicateur RMax,<br />
qui correspond à la valeur absolue <strong>de</strong> l’erreur maximum.<br />
Enfin, afin <strong>de</strong> pouvoir rendre compte <strong>de</strong> l’éventualité d’une<br />
erreur systématique, il faut considérer la moyenne <strong>de</strong><br />
l’écart (Rmean) <strong>et</strong> l’écart type <strong>de</strong> l’erreur (Rstd).<br />
Résultats <strong>de</strong> l’évaluation<br />
Pour différents types <strong>de</strong> stimuli, cinq estimateurs ont été<br />
évalués selon les quatre indicateurs décrits précé<strong>de</strong>mment.<br />
Au nombre <strong>de</strong>s différents stimuli exploités, on trouve : <strong>de</strong>s<br />
sons purs à une fréquence <strong>de</strong> 1 kHz ; <strong>de</strong>s sons purs, <strong>de</strong><br />
fréquence comprise entre 125 Hz <strong>et</strong> 10,5 kHz, <strong>de</strong> durée<br />
comprise entre 10 <strong>et</strong> 500 ms, <strong>et</strong> <strong>de</strong> niveau compris entre 55<br />
<strong>et</strong> 95 dB ; <strong>de</strong>s bruits blancs <strong>de</strong> niveau 72,5 dB, <strong>de</strong> durée<br />
comprise entre 10 <strong>et</strong> 500 ms ; <strong>de</strong>s stimuli naturels<br />
stationnaires (sons <strong>de</strong> l’environnement) <strong>et</strong> <strong>de</strong>s stimuli<br />
naturels non stationnaires (bruits <strong>de</strong> chantiers). Les cinq<br />
estimateurs évalués sont : le Max DBB Slow (estimateur en<br />
dB avec une fenêtre temporelle d’une secon<strong>de</strong>) ; le Max DBB<br />
Fast (fenêtre temporelle <strong>de</strong> 125 millisecon<strong>de</strong>s), le Max DBB<br />
Impulse (fenêtre temporelle <strong>de</strong> 35 millisecon<strong>de</strong>s) ; le<br />
modèle ISO S532B <strong>de</strong> Zwicker adapté à la sonie <strong>de</strong>s sons<br />
stationnaires ; le modèle <strong>de</strong> Zwicker <strong>de</strong> 1977 adapté à la<br />
sonie <strong>de</strong>s sons non stationnaires. Les trois pondérations A, B<br />
<strong>et</strong> C ont également été comparées.<br />
Conclusions<br />
Les niveaux pondérés A, B <strong>et</strong> C restent insuffisants pour<br />
estimer correctement la sonie <strong>de</strong>s sons naturels. Le<br />
temporel <strong>de</strong> Zwicker <strong>de</strong> 1977 estime correctement la sonie<br />
<strong>de</strong>s sons stationnaires mais le besoin d’un nouvel estimateur<br />
adapté aux sons impulsionnels est confirmé. C’est<br />
précisément l’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière étape <strong>de</strong> ce proj<strong>et</strong>, qui<br />
est en cours.<br />
Bruit <strong>et</strong> vibration <strong>de</strong>s tramways : caractérisation <strong>de</strong>s sources <strong>et</strong> évaluation<br />
<strong>de</strong> la perception<br />
Thierry Legouis (SerdB)<br />
Ce proj<strong>et</strong> <strong>de</strong> recherche est mené conjointement par cinq<br />
partenaires : SerdB, l’Inr<strong>et</strong>s, l’Ecole Centrale <strong>de</strong> Nantes, la<br />
société CDM (entreprise spécialisée notamment dans la<br />
fourniture <strong>de</strong> matériel pour la pose <strong>de</strong> voies anti-vibratiles)<br />
<strong>et</strong> la Société d’économie mixte <strong>de</strong>s transports <strong>de</strong> la<br />
agglomération nantaise (SEMITAN), qui gère le tramway<br />
nantais. L’étu<strong>de</strong> ayant démarré au début 2005, les résultats<br />
communiqués ici sont issus d’étu<strong>de</strong>s antérieures.<br />
L’obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> ce proj<strong>et</strong> est d’évaluer l’intérêt d’intégrer, dans<br />
les <strong>de</strong>scripteurs acoustiques <strong>de</strong> la gêne instantanée, la<br />
contribution <strong>de</strong>s différentes sources <strong>de</strong> bruit élémentaires<br />
que sont le roulement, la motorisation, les équipements<br />
électriques <strong>et</strong> le bruit solidien. Deuxième objectif <strong>de</strong> ce<br />
proj<strong>et</strong> résolument tourné vers l’opérationnel : formuler <strong>de</strong>s<br />
recommandations quant à l’usage <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>scripteurs pour<br />
les futurs exploitants.<br />
On déplore un manque criant <strong>de</strong> recommandations en<br />
matière d’étu<strong>de</strong>s d’impacts <strong>de</strong>s tramways. Ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
PAGE 60<br />
Actes <strong>de</strong>s 4 es Assises <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’environnement sonore — Avignon — 18, 19 <strong>et</strong> 20 janvier 2005